La question de la liberté pour l’individu de disposer librement de son patrimoine par testament a fait l’objet de longs débats à partir de la Révolution Française et, sinon dans le détail, du moins dans l’esprit, il semble que le « Code Napoléon » ait défini une bonne fois pour toutes ce qui allait être la philosophie du Droit français en la matière.
En somme, on est passé d’une situation dominée par le droit d’aînesse à une situation où la règle est (principalement, sinon exclusivement) le partage égal entre les héritiers définis par la loi.
L’ancien droit était régi par le souci de ne pas diviser le patrimoine, et ce qui nous apparaît aujourd’hui comme une injustice se comprend quand on conçoit que la valeur fondamentale était la famille, considérée comme supérieure aux individus, se perpétuant à travers les générations en imposant à ses membres successifs des devoirs autant ou plus qu’elle ne leur donnait des droits. L’héritier, en somme, recevait la charge de perpétuer, avec le nom, le statut, le rang, la fortune qu’il avait reçue en partage. Depuis le Code Napoléon, il s’agit au contraire de favoriser le droit des individus-héritiers, de sorte que l’on ne puisse pas priver un de ses enfants, par exemple, d’un legs auquel, estime-t-on, il a droit.
Il est remarquable, du reste, que le Droit français du début du XIXe siècle semble être revenu à un esprit (le partage égal des biens du défunts entre ses enfants) qui était celui des lois de « nos ancêtres les Gaulois », à la fois contre le Droit Romain et contre les institutions germaniques introduites par les Francs et qui ont dominé par la suite.
La conception d’Ancien Régime est trop éloignée de nous, culturellement, pour pouvoir encore être défendue. Elle serait désespérante, d’ailleurs, pour tous les individus qui, pour une raison ou pour une autre, ne sont pas amenés à avoir eux-mêmes des enfants. Toutefois, la conception actuelle est tout aussi désespérante : il y a quelque chose de triste à penser que nos biens, si nous en avons, pourraient être échus soit à des enfants ingrats, soit à des neveux et nièces pour qui nous n’avons peut-être pas toute la tendresse que nous aurions pour nos propres enfants.
Je pense, tout en ayant conscience du caractère choquant de l’idée tant pour la gauche (qui fait mine d’être ennemie des héritages, mais n’y a jamais sérieusement porté la main) que pour la droite (qui craindrait de voir ainsi attaquée la famille) que nous devrions défendre la liberté intégrale de disposer de nos biens par testament comme bon nous semble, à la réserve près d’éventuelles taxes.
La transmission des biens est, en fait, très souvent le support d’une transmission culturelle, morale — laisser après soi quelqu’un à qui l’on confie le soin de poursuivre ce que l’on a commencé, ce n’est pas une simple question d’argent…
Il me semble que cette solution est paradoxalement le moyen le plus sûr de renforcer l’institution de la famille tout en la combinant avec le respect de la propriété privée et de la liberté absolue des individus.
Sur le premier point, on nous opposera que l’orientation proposée serait destructrice de la famille au sens où elle permettrait aux parents de déshériter leurs enfants à leur guise, au risque que le vieux père préfère sa maîtresse à ses enfants, par exemple. À quoi nous répondons qu’au contraire, ce dispositif, parce qu’il rendrait volontaire et libre ce qui n’est aujourd’hui qu’imposé par la loi, obligerait les enfants à une plus grande mesure de piété filiale, tout en rendant, ce qui est peut-être plus important, les pères et les mères responsables du choix d’une transmission qui serait dès lors une élection, un don, c’est-à-dire aussi le choix de successeurs pour continuer une lignée.
L’idée de parents privant leurs enfants de toute succession ne nous choque pas : d’ailleurs, aujourd’hui, on hérite à l’âge où l’on arrive à la retraite. Autrement dit, l’héritage est bien plus souvent, aujourd’hui, une affaire de transmission symbolique — de filiation — que de transmission d’un patrimoine matériel, qui n’est le plus souvent que le support de la transmission symbolique. Du reste, il est à signaler que le dispositif que nous proposons permettrait aussi bien aux grands-parents de choisir parmi leurs petits-enfants, « par-dessus la tête de leurs enfants », des héritiers à leur convenance. C’est ainsi que l’on pourrait, en somme, régler aussi la question de la génération des soixante-huitards qui se caractérise souvent par son refus de la transmission — refus d’accepter de reprendre les traditions, illusion de s’être fait soi-même en bon « libéral-libertaire », contre ses devanciers, et surtout, refus de transmettre à la génération suivante ce dont on aura « joui sans entrave », bien illustrée par la formule : « Après moi, le déluge ».
Cette réflexion est partie d’une expérience personnelle : Pour ma part, je ne me sens aucun droit sur les biens de mes parents, par exemple ; mais, quand ma grand-mère paternelle, en mourant, a choisi de me léguer certains objets précis, je les ai reçus un peu comme une mission autant que comme un cadeau. Un héritage est un ensemble de devoirs plutôt que de droits, et c’est aussi le principe du nationalisme : ce que j’hérite (la qualité de Français) non seulement me détermine, mais me gouverne à bien des égards (je suis possédé par mes Morts, dirait Barrès). Ce sens de la transmission volontaire, élective, est le seul moyen de rétablir un sens de la tradition dans une société individualiste sans restreindre la liberté des individus, mais au contraire en l’accroissant.
Je me rends compte à quel point j’ai été, comment dire, « rattrapé » par mon appartenance familiale, mon enracinement dans ma famille, quand j’ai hérité, l’année dernière, de ces quelques objets que ma grand-mère avait choisis pour moi (elle a légué ce qu’elle avait en valeurs à ses enfants, mais quelques beaux objets qu’elle avait rassemblés durant sa vie à ses petits-enfants). J’ai vraiment reçu ces quelques objets comme un message extrêmement personnel qu’elle m’adressait, comme une mission, en quelque sorte, plus que comme un cadeau, comme une idée géniale qu’elle avait eue, peut-être sans la penser jusqu’au bout, mais avec une intuition très pénétrante, pour faire un pont au-dessus de la rupture de transmission de la génération 68 (celle de mes parents).
Une des dimensions de notre propos, par lequel il pourrait prêter le flanc à la critique, c’est qu’il implique un retour à une forme de propriété qui est dans l’esprit de l’Ancien Régime, celle qui s’exprime dans l’adage : « Noblesse oblige ». En effet, la transmission quasi-intégrale du patrimoine familial, le cas échéant, à un héritier choisi (pas nécessairement le fils aîné, comme dans nos vieilles institutions : nous insistons sur la liberté de choix, c’est-à-dire sur l’introduction de l’élément individuel dans ces vieilles institutions qui faisant primer les « corps intermédiaires » sur les droits de l’individu) serait de nature à recomposer des noyaux familiaux relativement riches et puissants, tout en corroborant considérablement l’allégeance à la famille comme valeur. Au lieu du simple devoir de « gérer son patrimoine en bon père de famille », l’individu réapprendrait à se percevoir comme un maillon d’une chaîne appelée à continuer bien après lui, à l’égard de laquelle il aurait autant ou plus de devoirs que de droits.
Le danger serait surtout dans la combinaison de ce principe avec l’état actuel de l’économie : que faire du danger qu’il y aurait à voir, à la faveur de telles dispositions, se renforcer encore une oligarchie industrielle et surtout financière, relevant le plus souvent de ce qu’on appelait autrefois le « capital apatride » ? Bref, de contribuer fatalement, par cette mesure visant à renforcer la famille, traditions et transmissions, à l’aggravation d’un état de choses économique et social qui dissout fatalement la famille et toutes les traditions en réduisant l’individu au rang de simple consommateur ?
C’est ici qu’il faut introduire un élément marxiste dans la réflexion et mettre un coin dans ce qui constitue le nœud de la problématique de la transmission du patrimoine.
Sous cet intitulé, en effet, on entreprend de traiter d’une seule venue à la fois la transmission de la petite propriété privée (fruit et récompense légitime du travail personnel et support de la transmission symbolique qui est l’axe même de la tradition) et la transmission du capital, autrement dit de la propriété privée des (grands) moyens de production économique. La première est juste et nécessaire, à la fois socialement, moralement et surtout pour la construction psychologique des individus. La seconde est infiniment pernicieuse. Mais comment en sortir, sinon en proclamant clairement que, si la petite propriété privée doit être protégée par les lois, la propriété privée du capital, en revanche, ne devrait pas l’être au même titre ? Et quel sens donner à cette formule trop abstraite, si ce n’est que nous proposons nécessairement une économie encadrée par l’Etat, voire, l’expropriation, la socialisation des grands moyens de production économique ? Mais c’est un autre débat (quoique les questions soient organiquement liées).
Faudrait-il se scandaliser de ce qu’un parent frustre ses enfants de « leur part d’héritage » et se choisisse un successeur hors de la famille, et considérer à ce titre que la formule que nous proposons serait finalement destructrice de l’institution de la famille ?
Nous assumons ce danger et considérons, au fond, que les liens spirituels, affectifs, « affinitaires » doivent aussi, le cas échéant, pouvoir primer sur les liens du sang, quand les parents n’ont pas réussi par l’éducation à transmettre à leurs enfants les valeurs qui leur étaient chères. Car, au fond, s’il n’y a pas d’hommes (ni peut-être de femmes) sans pères, combien d’entre nous n’ont-il pas trouvé hors de leur famille de vrais pères — des maîtres, des guides, des inspirateurs qui nous ont réinsérés dans une filiation symbolique rompue par nos pères biologiques, soixante-huitards égoïstes et jouisseurs ? Et si nous avions des enfants aussi décevants que le sont nos parents, ne préférerions-nous pas, au terme de notre vie, pouvoir choisir celui ou celle à qui nous aurions le sentiment d’avoir passé le flambeau de nos convictions et de nos valeurs, plutôt qu’à des individus sans âme qui nous auraient été tristement adjoints par les hasards de la biologie ?
Ce sont là, en tout état de cause, des cas très marginaux : tout le monde tend à préférer ses enfants à des étrangers à la famille ; mais nous pensons ainsi, du moins, avoir répondu à une objection que l’on n’aurait pas manqué de nous faire.
Car enfin il s’agit avant tout pour nous de travailler sur les moyens de résoudre la crise culturelle de la société française actuelle, que nous voyons largement comme une crise de la transmission, c’est-à-dire autant de la volonté des générations précédentes à donner ce qu’elles ont reçu que de la disposition des générations suivantes à recevoir ce qu’on voudrait leur donner — le « matériel », encore une fois, n’étant pas nettement dissociable du « symbolique » : est-ce que je me vis, oui ou non, comme un maillon d’une chaîne qui commence bien en amont de moi et doit se poursuivre bien après ma mort ? Et pourrais-je vivre sans cela, malgré ce dont le nihilisme soixante-huitard a essayé de nous persuader… ?
S.A












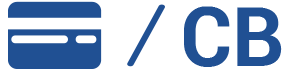
 et
et  !
!
