« Ce grand penseur qui a analysé le premier la forme valeur, ainsi que tant d’autres formes, soit de la pensée, soit de la société, soit de la nature : nous avons nommé Aristote. »
Un Aristote juif ? C’est ce que prétend le rabbin Yechiel Halperin, auteur du Seder Hadorot, un livre d’histoire juive classique. Alors qu’aucun biographe ne s’était rendu compte de cette qualité extraordinaire, nous proposons de participer à l’éclaircissement de ce mystère en rappelant ce qu’Aristote dit de l’économie.
I. L’économie antique
Au Vème siècle avant J.-C., Athènes est emblématique de l’activité commerciale dans le monde antique. Sa plaque tournante est le port du Pirée. Son atout par rapport aux autres cités grecques est non seulement ce grand port mais aussi son développement monétaire. Divers auteurs se font écho de cette supériorité économique (notamment par rapport à Sparte, cité plus militaire, admirée par Socrate et Platon, qui résista longtemps à l’utilisation des monnaies d’or et d’argent ; la légende, d’ailleurs, lui fait utiliser une monnaie de fer). Parmi eux, Xénophon, contemporain de Socrate, considère ce développement monétaire comme la cause de cette ascendance (Revenus de l’Attique, 3) car elle permet d’échanger de lourdes cargaisons contre de l’argent facilement transportables. La prospérité commerciale qui s’ensuit va à son tour accélérer les échanges monétaires et l’enrichissement des particuliers comme de l’Empire athénien. Cyrus (Cyrus II, dit « Cyrus Le Grand » : 559-529, celui qui autorisa le retour des exilés judéens à Jérusalem), fondateur de l’Empire perse, méprise au contraire ce commerce au nom de valeurs plus nobles (Hérodote, Histoires, I, 153). Il faut savoir que ce dédain du commerce est partagé par les meilleurs philosophes grecs au nom de la hiérarchie des biens (biens spirituels, biens corporels, biens extérieurs).
Les historiens pensent que les premières pièces de monnaie frappées à Athènes datent du VIème siècle. Cette monnaie athénienne est en argent issu des mines du Laurion. À partir de Philippe II de Macédoine (382-336 : père d’Alexandre le Grand), le choix est porté sur l’or du mont Pangée. Dés cette époque, une organisation bancaire s’est développée à Athènes et certains spéculent déjà sur le blé. Cette hégémonie grandissante de l’argent dans les échanges déplaît aux grecs des masses populaires (agriculteurs, artisans) qui déplorent l’émergence des « actes d’achat » au détriment du troc ancien (cf. Aristophane, Les Acharniens, 32-36). Ces agriculteurs traditionnels, en effet, vivaient en autarcie et n’avaient pas grand besoin de cet intermédiaire qui engendre des fortunes parasitaires. Théognis (de Mégare, VIème siècle, chantre l’aristocratie propriétaire, dénonçait déjà ces « marchands qui commandent » (vers 677). Sophocle (495-406), dans Antigone (vers 295-299), dénoncera aussi la culture de mort de l’argent :
« Aucune mauvaise institution, en effet, n’a germé
Chez les hommes comme l’argent. Les villes,
Il les saccage, il chasse les hommes de leurs maisons,
Il imprègne et détraque les esprits honnêtes
Des mortels, et les incite aux honteuses entreprises. »
Les meilleurs des Grecs, du moins ceux qui ont réfléchi un petit peu, constatent donc que l’argent peut accélèrer la dissolution sociale et l’esprit communautaire, étant propriété privée. Marx s’en fera l’écho dans Le Capital (chapitre I). La corruption des esprits est telle que dans l’opinion commune, « noble » devient synonyme de « riche »… Tout comme maintenant, malheureusement jusque dans le catholicisme, le terme « respectable » devient synonyme d’« établi »… De nombreux historiens avancent que le métier de manieur d’argent était très méprisé dans l’Athènes antique. Certains, cependant, et il y en a toujours, ne se posaient pas trop de question et s’enrichissaient sans scrupules. Un certain capitalisme (c’était l’opinion de Gustave Glotz) était en effet présent dans l’Athènes antique.
II. L’évaluation d’Aristote
Quand Aristote propose une analyse rationnelle de la vie économique chez l’homme, il faut considérer ces faits comme lui-même les voyait. L’amour de l’argent, jusqu’à l’idolâtrie, est constant dans l’histoire des hommes. Et d’ailleurs, dans les relations humaines, il a toujours existé un certain commerce. Mais nous sommes là en face des premières créations monétaires : certains, les plus malicieux, les plus rusés, se rendent compte qu’ils peuvent « faire de l’argent » en ne faisant pas grand-chose. C’est le début de la généralisation de la marchandisation des rapports humains. Comme d’habitude, Aristote analyse ce fait social en considérant le réel. Il est métèque, non pas citoyen athénien (il n’a jamais joui du « droit de cité »), et les métèques, ne pouvant pas être propriétaire sur le territoire athénien, étaient contraints au commerce. Aristote a donc certainement été au courant des us et coutumes des commerçants dans la zone d’influence athénienne.
Il est un point de la biographie d’Aristote sur lequel on insiste peu mais qui peut éclairer sa réflexion sur l’économie et la place de l’argent. Lorsque Platon meurt, en 348, Aristote est invité avec plusieurs autres membres de l’Académie à la cours du roi d’Atarnée (actuellement en Turquie, côte ouest de l’Anatolie), Hermas, disciple de Platon. Or, cet Hermas a succédé à Euboulos dont il était un ancien employé de la banque selon plusieurs témoignages (dont W. Jaeger). Aristote a très probablement été « sensibilisé » aux problèmes économiques et financiers de son temps à travers ces rencontres et d’autres encore (notamment Lycurgue, alors au pouvoir à Athènes). Il faut savoir en outre que les écrits de Théophraste, premier successeur d’Aristote au Lycée, constituent les textes plus détaillés sur les modalités des échanges commerciaux dans l’antiquité grecque classique. Cette histoire n’est pas inconnue de Jacques Attali qui la rappelle dans son livre Phares, 24 destins (Fayard, 2010).
Il ne faut pas considérer ce qu’on pourrait appeler le « droit commercial » grec d’alors comme identique à notre droit actuel, issu en grande partie du droit romain. À l’époque règne la coutume du cash : la propriété est acquise par le seul versement effectif du prix et non la signature d’un contrat. Cette précision est essentielle pour comprendre l’économie ancienne. Dans la vente, ce qui est déterminant ici est la chose extérieure et l’argent qui peut fonctionner comme un intermédiaire alors que dans le droit commercial moderne issu des Latins, c’est la volonté subjective des deux parties qui fait le contrat de vente. On pourrait dire que ce droit commercial est moins « objectif ». Par ailleurs, l’obligation de remboursement est issu chez les Grecs d’une certaine bonne volonté alors que le contrat romain oblige dés la signature. Nous ne sommes pas dans le même monde économique. Les historiens nous disent que ce fondement trop subjectif explique la méfiance des philosophes antiques envers le prêt à intérêt.
Car Aristote, comme on va le voir, ne semble pas condamner ce prêt à intérêt pour des raisons proprement morales mais plutôt pour des motifs « rationnels » : ce prêt n’est pas naturel. Car en effet l’échange naturel a pour conséquence qu’un produit soit cédé immédiatement contre son équivalent en monnaie. Le prêt à intérêt, au contraire, diffère la restitution et l’argent prêté n’est le substitut de rien. L’absence de contrat chez les Grecs est l’indice de leur réalisme : on préfère le concret tangible des marchandises et de l’argent-monnaie réel aux jeux d’écriture. Les actes conjugués d’achat et de vente sont constitués, aux yeux de tous, par l’échange réel de deux réalités visibles et objectives (argent-monnaie concret, marchandise, etc) et non de deux subjectivités qui se mettent d’accord sur papier. Les Grecs ne formalisaient donc pas en droit civil un bon vouloir introduit plus tard par les Latins.
La vente grecque n’est donc pas un contrat au sens du droit romain. Aristote, donc, dira qu’un contrat passé entre deux parties qui y consentent peut être injuste : affirmation incompréhensible dans le droit commercial issu du monde romain. Aristote l’affirme pourtant car pour un Grec de cette époque l’échange n’est pas constitué par le simple accord de gré mais par l’exécution effective ou le début d’exécution du paiement du prix contractuel.
Aristote constate ainsi que dans certains pays les lois positives interdisent des actions en justice concernant les accords simplement volontaires (Éthique à Nicomaque, IX, 1, 1164b 13) : car ces ententes subjectives ne sont pas concrétisées (ou commencent seulement à l’être, par des arrhes par exemple) objectivement au moment de l’accord mais se fondent exclusivement sur la confiance qu’on accorde à quelqu’un. Nous y voilà ! Car cette confiance est subjective et n’est pas constitutive pour la psychologie grecque d’un engagement réel fondé sur les choses mêmes.
Par ailleurs, nous voyons Aristote affirmer que le prix d’une chose doit être fixé par l’acheteur et non par le vendeur (Éthique à Nicomaque, IX, 1, 1164b 12)... La vision romaine dira le contraire et va engendrer la théorie du « juste prix ». Car la justice, dans la transaction, est évaluée chez Aristote non pas en vertu d’un accord volontaire préalable mais de la proportion réelle des choses échangées. Quand Aristote parle donc d’injustice dans les transactions, il ne le fait pas en fonction de la violation d’un accord consensuel mais dans l’équivalence des choses réelles. Il est évident que cette équivalence n’est pas inscrites dans les choses mêmes mais résulte d’une évaluation subjective. Aristote nous dit qu’elle est jaugée surtout sous la pression du besoin (Éthique à Nicomaque, V, 8, 1133a 26) autrement dit la nécessité naturelle et non un libre choix.
Avec Aristote la philosophie n’est pas l’enregistrement, la justification de tout ce qui se produit dans la vie sociale. Car le réel ne coïncide pas intégralement avec l’empirique : c’est la réalité pleine, la nature épanouie, l’essence saturée, qui donne la mesure sur laquelle il convient de se régler. Il invite ainsi à faire le tri entre le normal et l’aberrant.
Il commence par constater les faits sociaux humains. Toute cité est ainsi une communauté qui a atteint un certain niveau de développement économique et qui présente une division du travail. Cette différenciation des tâches, en fonction des aptitudes naturelles de chacun, est nécessaire : pourrait-on vivre dans une cité habitée uniquement par des mécaniciens ? Cette communauté pratique des échanges : ce que l’un produit est échangé avec ce que l’autre produit. On cherche alors à équivaloir les deux produits, à les rendre égaux d’une certaine façon. Mais comment rendre égaux les produits et les producteurs ? Aristote répond : les hommes l’ont fait par la monnaie (Éthique à Nicomaque, V, 8, 1133a 20).
III. La monnaie chez Aristote
La monnaie, création humaine, a donc un rôle d’intermédiaire utile. Avant la création de la monnaie, les hommes échangeaient quand même (Éthique à Nicomaque, 1133b 26). Ce troc cherchait une égalité dans les échanges (un tas de bois contre telle quantité d’eau). C’est le développement quantitatif des échanges, à grande échelle (en gros du village à la communauté de villages), qui a conduit à cette « nécessité » de créer l’argent (Politique, I, 9, 1257a 33). On passa donc du troc à la monnaie métallique, sans doute par cette étape intermédiaire que constituait la tête de bétail (estimation présente chez Homère).
Aristote est moins méfiant que l’aristocrate Platon vis-à-vis de la monnaie (dans les Lois, 742a -743d, Platon interdit dans son programme politique les monnaies d’or et d’argent). Werner Jaeger explique le fait : « La puissance de l’ancienne aristocratie se fondait sur la richesse foncière et elle avait été fort ébranlée par l’apparition de la monnaie comme nouveau moyen d’échange » (Paideia).
Pour comprendre la place de la monnaie chez Aristote, on peut la comparer au système de signes à quoi toute chose se réfère dans la communication humaine. Aristote lui-même indique cette analogie (Histoire des Animaux I, 6, 491a 20). Or, Aristote appelle ce signe linguistique « symbole ». Et, à l’origine, ce terme « symbolon » désignait précisément une pièce de monnaie fracturée dont deux personnes prenaient justement la moitié pour se reconnaître plus tard. La pièce est ici encore un moyen de se mettre d’accord. Le problème reste celui de l’équivalence entre deux choses différentes. On retrouve cette problématique dans la nature de la définition chez Aristote (opération intellectuelle fondamentale dans tous les sens du terme). Car une définition doit dire la même chose que le défini sans pour autant se répéter tautologiquement. On ne peut pas définir l’homme est disant que c’est un homme : on emploie d’autres termes différents. Dans l’échange, de façon semblable, le juste cherche à équivaloir les objets : qu’ils aient la même valeur (établie d’un commun accord).
L’échange se définit en effet par le don mutuel d’objets différenciés. Pour mémoire, les pères du relativisme, et parmi eux Antisthène (444-365 : né d’une mère juive pharisienne, disciple du sophiste Gorgias et à la fin de sa vie de Socrate), véritable précurseur du nominalisme, estiment que l’esprit humain ne peut affirmer que des tautologies : Socrate est Socrate, par exemple. Car définir, c’est prédiquer une chose d’une autre, comme on vient de le voir. Or, il n’y a pas d’équivalence rigoureuse entre des termes différents, qui désignent des choses différentes. C’est une vieille histoire, toujours d’actualité. Aristote corrige cette errance logique : il ne s’agit pas d’échanger l’identique à l’identique, mais l’équivalent à l’équivalent. Ce qui permet d’ailleurs aux définitions d’être adéquates et au langage humain de signifier les choses de façon satisfaisante.
Bref, la monnaie est un intermédiaire entre deux choses (marchandises) et aussi une certaine mesure qui cherche à équivaloir ces choses distinctes dans un rapport mathématique. Par le moyen du nombre, en effet, les choses hétérogènes que l’on cherche à évaluer sont rendues « égales » : une proportion est ainsi établie. Cette commensurabilité estimée par l’homme permettra l’échange. Aristote prend des exemples de son temps (une maison, une somme d’argent en mines, des lits, avec des prix fantaisistes d’ailleurs) mais la signification est intemporelle (Éthique à Nicomaque, V, 8, 1133b 23). Transposons ces exemples dans notre monde (ou plutôt celui de l’hyper-classe mondialisée) : une maison est nommée A ; 10 M€ est nommé B ; une voiture est nommée C. Alors A est la moitié de B si la maison vaut 5 M€ ; et la voiture est la dixième partie de B : on voit ainsi combien de voiture équivalent à une maison : à savoir 5. On voit ainsi que la transposition mathématique des choses en échelle monétaire permet une équivalence. Karl Marx explicitera : « Les marchandises se disent dans leur nom d’argent ce qu’elles valent » (Le Capital, I, 110, Éditions Sociales).
Que constate-t-on dans ces opérations d’équivalence ? Une plus grande précision, une évaluation plus perfectionnée, plus sophistiquée, plus absconse, plus abstraite. Nous rentrons dans les jeux d’esprits mathématiques. Ici, la quantité travestit la qualité : nous ne sommes plus en face des choses réelles mais de leur mesure. C’est ce qu’observe Aristote : « La monnaie, dés lors, jouant le rôle de mesure, rend les choses commensurables entre elles et les amènent ainsi à l’égalité » (Éthique à Nicomaque, 1133b 17). Mais il n’y a pas adéquation substantielle entre le nombre et la chose comptée, entre une maison et son prix (qui peut changer). Autrement dit l’argent n’est pas constitutif des choses : c’est seulement un mode de représentation. C’est pourquoi Aristote va souligner le caractère subsidiaire de la monnaie : sa dimension conventionnelle. L’argent est une création humaine et non un être naturel. Aristote évoque à ce sujet l’étymologie du terme « nomisma » (qui donnera numismatique) et le fait dériver de « nomos », la loi (Éthique à Nicomaque, 1133a 30).
Aristote est lucide sur la variabilité de cette monnaie : « La monnaie, il est vrai, est soumise aux mêmes fluctuations que les autres marchandises, car elle n’a pas toujours un égal pouvoir d’achat » (Éthique à Nicomaque, V, 8, 133b 12). Car l’Antiquité a connue des dévaluations de monnaie. Le Stagirite en évoque une à l’initiative de Solon (640-558) dans La Constitution d’Athènes.
Cette nature conventionnelle de la monnaie fonde le refus de toute vénération excessive et évidemment d’idolâtrie, démesure vicieuse qui ne convient pas. Cette monnaie, certes, est amenée à « mesurer toutes choses » (Éthique à Nicomaque, 1133a 21) mais en aucune façon cela signifie chez Aristote qu’elle doit être « mesure de toutes choses » au sens où l’entendait le relativiste Protagoras (la chose n’est pas son prix « en acte » mais seulement « en puissance »). Non, il veut simplement rappeler que dans l’échange économique, pas mauvais en soi, on ne pourra trouver une équivalence totale entre les choses et la monnaie, car la chose vaut bien plus que sa traduction financière. Cette évaluation économique, finalement temporaire, car dictée par l’urgence du besoin, ne peut dire toute la richesse de la chose. Aristote rappelle en effet qu’on ne peut pas tout mesurer en argent. La science est une de ces choses, si bien que la valeur de l’enseignement philosophique « n’est pas mesurable en argent » (Éthique à Nicomaque, 1164b 3).
Le réalisme d’Aristote lui fait voir l’unité et l’ordre de la nature. L’argent, en effet, joue chez lui, dans le circuit M-A-M le rôle du moyen-terme (méson) dans le syllogisme. On sait que ce moyen-terme met en relation pour les unir les deux extrêmes (prédicat et sujet) et finit par s’effacer dans la conclusion. L’argent, de même, met en relation deux marchandises et s’efface dans la conclusion en permettant l’échange. Ainsi, dans l’échange, il doit avoir, comme dans le syllogisme, trois termes et non deux seulement. Aristote n’a évidemment pas plaqué ses modes logiques sur les faits économiques. Fidèle à son intention profonde, Aristote se sert du bon usage de la raison pour mettre à jour l’armature du réel. Contrairement au mode platonicien ou pythagoricien, hypothético-déductif, il n’est pas formaliste et refuse absolument de plaquer sur le réel des schémas préconçus.
IV. Les anglo-saxons contre Aristote
Thomas Hobbes (1588-1679 : protestant anglais, positiviste, cherchera à légitimer la toute-puissance de l’ordre établi au détriment du bien objectif et de la vérité objective) va railler l’analyse d’Aristote car celle-ci, bien comprise, limite l’expansion du commerce dans son principe. Dans le Leviathan (chap. 15), l’anglais dénonce ainsi ces auteurs (dont Aristote fait partie) « qui placent la justice commutative dans l’égalité de valeur des choses échangées par contrat… Comme s’il y avait injustice à vendre plus cher que nous n’achetons. » Car enfin Aristote critique certaines activités commerciales à cause d’un souci éthique, loin des critères de ruses. Cette orientation pose problème à de nombreux commentateurs, surtout Modernes, il faut le dire. Car pour Aristote, celui qui se contente d’acheter bon marché pour revendre plus cher, sans aucune activité productrice ni aucun service, est plutôt blâmé.
Mais il faut ici être nuancé : il s’agit de celui qui limite son action (son œuvre : son ergon) à l’achat minimum des mains mêmes du producteur et à une revente démesurée au consommateur. Il peut exister un travail intermédiaire louable (entrepôt, conservation, protection, mise à disposition, etc). Mais un simple revendeur ne produit aucune œuvre : Aristote le dénonce comme parasite des échanges. Il faut savoir qu’au temps d’Aristote, ces intermédiaires sont peu nombreux : on achète souvent directement au producteur. Mais Aristote reste réaliste : il ne condamne pas tout commerce. Il en fait même le reproche à Platon (Politique, 1265a 20).
Aristote propose donc autre chose que l’économie de marché qui ne prend en compte que les produits de façon horizontale. En effet, il insiste sur la considération des producteurs eux-mêmes (Éthique à Nicomaque, 1133a 33). De plus, dans l’économie de marché, on a tendance à produire pour la vente elle-même et non pour un besoin réel. Or, Aristote, dans Politique, I, dénonce cette intention absurde. Car, en effet, Aristote commence son analyse par les besoins naturels à l’homme, et non aux lois établies du marché ici et maintenant.
Pour commenter correctement les pages d’Aristote sur l’économie, il faut sans doute rappeler que pour lui la valeur essentielle de toute activité n’est pas dans l’activité elle-même – le temps passé – mais dans le résultat et son rapport au Bien Commun. Aristote ne juge donc pas une œuvre, fruit d’activités (voir la distinction dans Éthique à Nicomaque, I, 1, 1094a 4), sur la peine subie ou le temps passé dans ces activités, mais sur l’œuvre finale elle-même. Pour prendre un exemple, vous n’êtes pas méritant à passer votre carrière à être l’agent de structures d’injustice, même si vous y avez passé vos journées en altérant votre vie de couple et de famille : il faut évaluer le bien objectif réalisé. Car on peut être plus méritant à l’avoir refusé.
Bref, c’est toute la différence avec une conception, disons matérialiste du travail comme le définit Karl Marx, lequel nie la finalité dans la nature à la suite d’Héraclite. C’est peut-être l’obsession finalisante d’Aristote qui le pousse à ne considérer que les choses achevées : il voit les choses dans leur perfection ultime, ce qu’elles peuvent être. Et non simplement, nous dirions positivement, ce qu’elles sont ici et maintenant. Ainsi reprocher à Aristote de négliger le « temps de travail » puisque de toute façon c’étaient surtout les esclaves qui produisaient, c’est oublier que les hommes qui opèrent les échanges dans sa conception de l’économie sont bien des hommes libres.
Aristote ne néglige pas l’utile mais l’on ne doit pas oublier que cet utile n’est qu’un moyen pour les biens de l’âme. Mais l’élévation de notre âme vers son bien propre suppose, entre autres, le solide socle des choses utiles car si ces biens métaphysiques sont premiers dans l’ordre de l’être, ils doivent être précédés chronologiquement par les choses utiles.
Nos besoins, en effet, nous rivent au réel et nous rappellent constamment au « principe de réalité ». Un passage des Topiques est significatif à ce sujet :
« Quelquefois cependant les choses meilleures ne sont pas les plus désirables ; car de ce qu’elles sont meilleures, elles ne sont pas pour cela nécessairement préférables ; ainsi philosopher vaut mieux que s’enrichir, mais ce n’est pas là une chose préférable pour celui qui manque du nécessaire » (Topiques, III, 2, 118b 21).
Ces lignes sont à l’origine de l’adage fameux : « primum vivere, deinde philosophari » transmis par la scolastique. L’usage des choses est bon pour l’homme : il le rend réaliste.
V. La définition de la chrématistique
Aristote va distinguer l’art naturel d’acquérir des richesses (cet art est légitime car l’homme a des besoins) et l’art d’acquérir dans l’échange mercantile (cet art est plutôt blâmé car antinaturel) : il existe ainsi un bonne et une mauvaise chrématistique. La difficulté des textes concernés (Politique I, 8-9 et Éthique à Nicomaque V, 8) vient des différents sens dont use Aristote, sachant que parfois il emploie le terme dans un sens très général qui recouvre les deux premières significations.
Dans la Politique, Aristote, suite à la lecture d’Hérodote (Histoires, I, 94) fait un rappel historique du passage du troc à la monnaie, et de la monnaie au commerce en vue du gain. Au départ, la monnaie est une création utile qui favorise les échanges. Mais la pratique de la revente va pervertir son usage. C’est à ce moment, en effet, qu’il précise une distinction qui va devenir célèbre : celle entre la valeur d’usage et la valeur d’échange.
Aristote distingue donc une bonne économie (acquisition naturelle) et une mauvaise pratique qu’on pourra nommer pour simplifier chrématistique (avec toutes les réserves vues plus haut).
1° Valeur d’usage et valeur d’échange
Toute chose possédée peut être utilisée de manière différente. Une maison peut être habitée par son propriétaire (valeur d’usage) mais aussi louée ou vendue à un autre (valeur d’échange). Dans ce second cas, la maison est évaluée en valeur d’échange, traduite en argent. De ces deux valeurs, « l’une est propre à la chose, l’autre non » (1257a 8). La valeur d’usage est propre à la chose selon sa nature, tandis que la valeur d’échange est conventionnelle et peut varier au fil du temps et selon les lieux. Ici, la chose devient marchandise, objet d’échange. Marx citera ce passage en précisant que la chose devient avec le marchand instrument d’échange, et seulement cela (Capital, Éditions Sociales, Tome I, p. 96).
Les principaux auteurs de l’Antiquité rappellent le primat de l’usage sur l’échange. Une chose en effet se définit par sa valeur d’usage et non sa valeur d’échange. Autrement dit la valeur réelle d’une chose (et encore moins d’un être humain) ne se réduit pas à sa transcription économique sous forme monétaire. Aristote rappelle à ce sujet la légende du roi Midas (1257b 14 ss) qui demanda à Dionysos la faculté de transformer en or tout ce qu’il touchait. Incapable de manger et de boire, il supplia le dieu de reprendre son présent. Dionysos lui ordonne alors de se laver les mains dans les eaux du Pactole, dont le sable se change en or. Cette légende explique le caractère aurifère du Pactole, auquel la Phrygie doit une bonne partie de son empire.
Identifier absolument richesse et monnaie, c’est inverser les valeurs d’usage et d’échange. Le réalisme aristotélicien privilégie la valeur d’usage sur la valeur d’échange. Les Modernes vont faire l’inverse, à la suite des auteurs anglo-saxons. Si bien que l’importance de l’homme moderne a tendance à être mesurée selon la procession des objets usagés qu’il laisse derrière lui. La dictature des objets trouve son origine dans des théories philosophiques modernes, surtout anglaises, qui sont venues légitimer les appétits égoïstes.
2° La perversion économique
L’art d’acquérir des richesses est donc un véritable bien, car il est naturel (1256b 37) mais sa perversion est artificielle (1257a 5). C’est encore Karl Marx qui va commenter ce passage (Capital, Livre I, 2ème Section) et en donner une lecture éclairante. On peut en effet distinguer deux formes de circulation : immédiate (Marchandise-Argent-Marchandise) et dérivée (Argent-Marchandise-Argent). Dans la première, l’Argent est un intermédiaire, dans la seconde, le commencement et la fin (cf. blague de Jacques Attali).
Dans le premier cas, l’argent est un intermédiaire transitoire destiné à disparaître car il est totalement dépensé. Dans le second cas, c’est la marchandise qui est une figure momentanée et l’argent est simplement avancé. Dans le circuit M-A-M, l’argent est utilisé comme il convient en tant que monnaie passagère ; dans le circuit A-M-A, il devient capital. La première circulation est dominée par la valeur d’usage. La seconde, par la valeur d’échange.
Pour Aristote, donc, la monnaie est une création qui permet un perfectionnement du troc (M-M). Quand on manipule les termes de la circulation (1257b 22-23), on pervertit l’échange car on donne l’initiative à l’argent. On voit ainsi l’argent se soumettre la marchandise alors que dans l’ordre naturel, c’est la marchandise qui doit se soumettre l’argent. C’est ainsi qu’Aristote parle de « violence » (Éthique à Nicomaque, 1096a 6) : la mauvaise chrématistique est en effet une activité contre-nature ; elle engendre donc de la violence sociale en pervertissant l’échange.
Par ailleurs, comme l’acheteur de la marchandise (A-M) la revend (M-A) avec ce qu’on appelle une « plus-value », nous devons convertir le schéma de circulation : A-M-A’ (A’ - A = plus-value). Cette circulation aurait-elle engendré de la « valeur » ? Selon Aristote, c’est une illusion. Cet accroissement n’est pas réelle, substantiel (1257b 21) mais permet la simple circulation sans production réelle. Il y a seulement circulation. Car la revente ne produit rien : il n’y a pas de plus-value réelle. Aristote précise : « Elle n’est pas naturelle, mais pratiquée par les uns aux dépends des autres » (1258b 1-2).
Mais si l’excédent de valeur est acquis aux dépends d’autrui, les choses échangées ne sont plus équivalentes et je suis en présence d’une injustice. L’injustice de l’échange consiste en effet dans ce que A est inférieur à A’. Aristote condamne donc l’usage de l’argent comme capital. Ce n’est donc pas la monnaie en tant que tel qui pervertir l’économie mais un mauvais usage de cette monnaie. On voit ainsi Aristote, au IVème siècle avant Jésus-Christ, dénoncer la pure spéculation ayant pour but exclusif le profit. Selon lui, la stabilité politique qui assure la paix sociale est fondée sur les classes moyennes. Or, cet idéal du profit altère l’influence sociale de ces classes moyennes en augmentant la richesse des riches et en appauvrissant toujours plus les pauvres (Politique, III, 8, 1279b 27-28). Il analyse ainsi cette dissolution politique : « On obtient ainsi un État de maîtres et d’esclaves mais non d’hommes libres, les uns pleins de mépris et les autres d’envie » (Politique, IV, 11, 1295b 14-23).
Pour le réaliste Aristote, la juste mesure est également à observer quant à la richesse de l’État. On voit ainsi Aristote rappeler les travers de Sparte : ploutocratie, militarisme et matriarcat (Politique, 1269b 23-26 et 1270 a 12-15).
3° Pourquoi cette condamnation chez Aristote ?
La mauvaise gestion, en mettant l’argent à la place de la marchandise en début de chaîne, en fait une chose alors qu’elle n’est qu’un symbole : ce n’est pas un être naturel mais conventionnel. L’erreur de cette gestion, qui en fait d’ailleurs une activité non-naturelle, est de faire comme s’il s’agissait d’un être réel alors que la monnaie n’est qu’une mesure conventionnelle. L’ennemi de la pensée réaliste est justement la chosification de l’abstrait. Le symbole est pris pour le réel : alors se développe le virtuel qui singe le réel, la vie. La matérialité du symbole, la pièce de monnaie, ne doit pas induire en erreur : cette pièce de monnaie n’est qu’une représentation arbitraire.
Cette gestion perverse des échanges se traduit concrètement par des aberrations qui sortent des limites fixées par nos besoins naturels et font croire à l’utopie de l’accroissement sans fin des gains. Nous ne sommes pas loin d’un Calliclès qui se fourvoyait dans la fuite en avant. Calliclès, en effet, dans le Gorgias de Platon, défend une morale d’assouvissement des plaisirs sensibles. Il deviendra l’opposant classique à la réflexion socratique. Mais alors que Calliclès est plutôt le bon vivant qu’aucune morale universelle ne peut contenir, le marchand entretient une volonté froide d’accaparement pour la sécurité matérielle. Cette orientation terrestre ne va pas sans un ascétisme. Aristote a bien vu qu’il s’agit là d’une soif irrationnelle (Politique, 1257b 37-38). Il désapprouve ceux qui recherchent la richesse « à l’excès sans limite » (1323a 38). On peut en effet accumuler de l’argent au-delà de ses besoins naturels. Aristote rappelle sans cesse qu’on ne doit pas confondre ici-bas le moyen et la fin.
Aristote ne condamne pas tout commerce, en quoi il se sépare de Platon (Lois, IV, 704a). Il critique surtout le commerce de revente, celui qui ne rachète que pour revendre plus cher sans opérer aucune œuvre utile. Il vise là certains intermédiaires, ces parasites sociaux qui handicapent les échanges.
VI. Aristote et l’usure (obolostatikè)
Le chapitre 10 du Livre I de la Politique traite de l’usure. Les commentateurs médiévaux constateront que son enseignement correspond à la Révélation. Les Modernes, cependant, tel Turgot que nous verrons plus bas, y verront un frein à leur conception de la « loi naturelle », entendue dans un sens anglo-saxon, disons darwinien.
Certains théologiens, même catholiques, ont avancé l’idée que l’usure ne désignait finalement qu’un prêt à intérêt (le terme change) à un taux excessif. Le moyen-terme évoqué est la différence entre l’économie médiévale « statique » et l’économie moderne « dynamique ». On ne condamne plus la pratique elle-même. Cette distinction contredit de façon manifeste l’enseignement constant de l’Église catholique sur la question. Le père Pamphile Akplogan a largement traité du problème dans son livre paru dans l’indifférence générale en 2010, L’Enseignement de l’Église catholique sur l’usure et le prêt à intérêt (L’Harmattan).
Aristote rejoignait là une réprobation commune chez les philosophes sérieux, tel son maître Platon, qui à ce sujet contredisaient le grand Solon (Lysias, Discours, X, Contre Théomnestos, §18) qui était pourtant conscient de l’avidité humaine (cf. Werner Jaeger, Paideia, commentaire du fragment I, 71sq).
Aristote constate que ce prêt à intérêt est le fruit d’une gestion malsaine. Car la circulation A-M-A’ a tendance à devenir A-A’, qui définit justement l’usure. Ici, en effet, l’argent (A) produit un supplément d’argent (A’), pratique que Marx va analyser en argumentant avec Aristote : « argent qui s’échange contre plus d’argent, ce qui est en contradiction avec sa nature et inexplicable au point de vue de la circulation des marchandises » (Capital, livre I, IIème section, chapitre 5).
Certains intermédiaires sont authentiquement utiles et Aristote reconnaît le bienfait de ceux qui, par exemple, approvisionnent la Cité en blé. Mais il dénonce surtout ceux qui ne font « travailler » que leur propre argent.
Dans le cadre de l’obolostatikè, les bénéfices proviennent de la monnaie elle-même et non plus de la finalité utile de cette monnaie. Cette forme de chrématistique, mercantile, se sépare de la bonne gestion du père de famille qui ne veut pas s’avilir à amasser de l’argent de façon malhonnête :
« Dans ces conditions, ce qu’on déteste avec le plus de raison, c’est la pratique du prêt à intérêt parce que le gain qu’on en retire provient de la monnaie elle-même et ne répond plus à la fin qui a présidé la création. Car la monnaie a été inventée en vue de l’échange, tandis que l’intérêt multiplie la quantité de monnaie elle-même. C’est même là l’origine du mot “intérêt” : car les êtres engendrés ressemblent à leurs parents, et l’intérêt est une monnaie née d’une monnaie. Par conséquent, cette dernière façon de gagner de l’argent est de toutes la plus contraire à la nature. » (Politique, I, 10, 1258b 2).
Aristote dénonce ici une violation de la nature. Il y voit même une sorte de monstruosité : un être symbolique engendré en se comportant comme un être vivant. C’est là détruire l’ordre des choses, l’ordre naturel. Car dans le circuit A-A’, l’argent perd sa position normale de médiété,
« car elle n’est pas conforme à la nature, mais elle provient du bénéfice des échanges réciproques. C’est avec beaucoup de raison qu’on a une grande aversion pour l’usure, parce qu’elle produit une richesse provenant de la monnaie elle-même, et qui n’est plus appliquée à l’emploi pour lequel on se l’était procurée. On ne l’avait créée que pour les échanges, tandis que l’usure la multiplie elle-même : c’est de là que l’usure a pris son nom, parce que les êtres produits sont semblables à ceux qui leur donnent la naissance. L’intérêt est l’argent de l’argent. C’est de toutes les acquisitions la plus contraire à la nature » (ibid.).
Aristote dénonce donc fermement cette usure qui « ne se fait pas en effet selon la nature des choses, mais sur le dos des autres ». La blague de Jacques Attali prend ici tout son sens.
Dans le cadre de l’usure, en effet, l’articulation M-A-M manifeste une différence qualitative du facteur Marchandise : une maison n’est pas une voiture. Mais dans le système usurier, A est de même nature que A’ et les deux facteurs ne diffèrent qu’en quantité.
Là réside dans le texte d’Aristote la distinction entre choses fongibles (qui appartiennent à un même genre : l’argent, le blé, l’huile ou le vin ; ces choses fongibles peuvent être remplacées par n’importe quelle chose du même genre - la monnaie est également fongible) et choses non-fongibles. Ces distinctions seront associées au texte d’Aristote surtout par des jurisconsultes tel Robert-Joseph Pothier (1699-1772) qui reprend une distinction de saint Thomas d’Aquin (1224-1274).
Saint Thomas, en effet, opérait une distinction entre les choses dont l’usage engendre leur destruction (blé, vin, huile, etc) et les choses non-détruites par cet usage (maison, etc). L’argent fait partie de ces choses fongibles et il est permis de demander un loyer pour une maison mais pas pour de l’argent. Car louer de l’argent avec de l’argent, c’est désunir l’argent de son usage originel. Or, l’usage de l’argent et l’argent ne sont pas séparables en réalité. Si bien que demander un intérêt pour une somme d’argent prêtée, c’est finalement vendre « ce qui n’existe pas » (Thomas d’Aquin, Somme théologique, I-IIae, qu. 78, a. 1, conclusion).
Aristote condamne vraiment l’usure par des arguments éthiques car rationnels. Et si les Pères de l’Église (cf. Akplogan) dénoncent l’usure sans s’inspirer d’Aristote, c’est parce qu’ils vivent dans un certain fidéisme qui sépare la foi de la raison.
Aristote ne condamne pas l’économie en tant que telle mais certains vices liés à l’économie. Le bonheur humain, en effet, s’accompagne d’un cortège de biens extérieurs :
« S’il n’est pas possible sans l’aide des biens extérieurs d’être parfaitement heureux, on ne doit pas s’imaginer pour autant que l’homme aura besoin de choses nombreuses et importantes pour être heureux : ce n’est pas, en effet, dans un excès d’abondance que résident la pleine suffisance et l’action, et on peut, sans posséder l’empire de la terre et de la mer, accomplir de nobles actions, car même avec des moyens médiocres on sera capable d’agir selon la vertu » (Éthique à Nicomaque, X, 9).
VII. Les Modernes s’attaquent à la vertu aristotélicienne
Turgot (1727-1781) a identifié l’ennemi de l’usure. Dans son Traité de l’usure, il s’en prend à ceux qui réfléchissent trop à ce sujet :
« Où nos raisonneurs ont-ils vu qu’il ne fallait considérer dans le prêt que le poids du métal prêté et rendu et non la valeur ou plutôt l’utilité dont il est pour l’époque du prêt entre une somme possédée actuellement et une somme égale qu’on rendra à une époque éloignée ? »
Turgot s’en prend ici, comme Hume en matière spéculative, aux replis les plus sûrs de l’ennemi : sa théorie de la justice.
« L’égalité de valeur dépend uniquement de l’opinion des deux contractants (…). L’injustice ne pourrait donc être fondée que sur la violence, la fraude, la mauvaise foi, mais jamais sur une prétendue inégalité métaphysique entre la chose donnée et la chose reçue. »
Turgot, dès sa nomination aux finances, s’était mis au travail pour établir le libre-échange dans le domaine des grains (suppression du droit de hallage), mais son décret (13 septembre 1774) rencontre une forte opposition auprès des conseillers du roi. Le préambule de ce décret, exposant les doctrines sur lesquelles il est fondé, lui gagne l’éloge des Lumières. Avec l’aide de son conseiller, le banquier suisse Isaac Panchaud, il prépare à la fin de son mandat la création de la Caisse d’escompte, ancêtre de la Banque de France, qui a pour mission de permettre une baisse des taux d’intérêt des emprunts commerciaux, puis publics. Cet organisme n’avait cependant pas pouvoir de battre monnaie. Elle fut le point de départ des grandes spéculations boursières sous Louis XVI. Le banquier Panchaud, théoricien de l’amortissement et admirateur de la révolution financière britannique, en compagnie du comte Thomas Sutton de Clonard (riche marchand jacobite bordelais et syndic de la compagnie des Indes), a par ailleurs racheté en 1777 à Abel-François Poisson de Vandières la verrerie du bas-Meudon, qui deviendra la verrerie de Sèvres, et qu’il revendra quinze mois plus tard pour 1,05 million de livres avec une plus-value de 31 %.
David Hume (1711-1776) s’opposera également à Aristote en réduisant l’échange à un affrontement entre deux termes : la masse monétaire d’un côté et les produits de l’autre (De la circulation monétaire). « C’est la proportion entre l’argent en circulation et les marchandises sur le marché qui détermine le prix. » Le mercantilisme dénature la position de l’argent, au départ simple intermédiaire.
Si l’économie a son correspondant dans le langage humain, c’est la sophistique. « La sophistique, d’ailleurs, n’est qu’une sorte de chrématistique » (Réfutations sophistiques, XI, 171b 28). Car dans la mauvaise économie, l’argent-symbole prend la place des choses-marchandises, tout comme dans la sophistique, les mots remplacent les choses. Le nominalisme économique a pour maître Protagoras.
Conclusion
Un Aristote juif… Comme souvent de nos jours, on ne sait pas trop s’il faut en rire ou en pleurer. Il s’agit là, comme d’habitude, de nourrir une désinformation autour d’Aristote, auteur qui indique les grandes lignes de l’ordre naturel. Retrouver l’authentique Aristote, c’est contribuer à rétablir la vérité sur les finalités de la vie humaine et permettre ainsi le discernement des voies qui conduisent au bonheur humain, autant qu’un homme peut en goûter ici-bas.
« On se rassasie de tout le reste, (…) mais de toi (Ploutos), jamais personne ne s’en est lassé… »












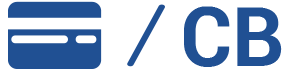
 et
et  !
!




