Pour juger de l’état de santé d’une société, il convient de cerner les actions et les valeurs qui lui servent de moteur. Un groupe de personnes qui n’avance pas stagne par définition, et alors commence la lente déliquescence des fondements sur lesquels il s’est établi. Au contraire, les progrès réalisés par un autre ensemble d’individus en constante évolution se mesurent à l’aune de la nature du mouvement qui le pousse en avant. Par conséquent, lequel des deux rôles pouvons-nous attribuer respectivement aux positions qui consistent à se demander « Que va-t-il arriver ? » et « Que puis-je faire ? ». Laquelle de ces deux interrogations est la plus citoyenne ?
Il paraît évident que la première embrasse une attitude passive face aux événements qui surviennent dans notre société, qu’ils soient futurs ou présents. Elle consiste à tenter de prévoir cyniquement un avenir devant lequel on se sent impuissant, ce qui mène à l’angoisse et au pessimisme caractéristiques de ceux qui subissent la vie et sont incapables de la dominer. La deuxième interrogation résulte, au contraire, d’une réelle démarche citoyenne, imbibée de la notion de responsabilité dans l’action au sens large. Ceux qui adhérent à cette philosophie sont les instigateurs du changement de demain, les protagonistes de la construction d’un monde meilleur. C’est sur eux que la société peut compter, du fait de leur dynamique engagée et enthousiaste. On attend de ces gens-là qu’ils fassent preuve d’abnégation, voire d’altruisme, en acceptant de porter le poids de problèmes et de difficultés à résoudre qui sont enracinés dans la société, mais que d’autres qu’eux ont causés. C’est ainsi que fonctionnent les choses dans une société qui permet l’intégration, l’expression libre et la reconnaissance, entre d’autres valeurs humanistes, de chaque individu qui la constitue dans des conditions optimales. Il reste à se demander si notre société remplit ces critères.
Malheureusement, il existe de nombreux idéalistes, inventeurs de génie et héros potentiels auxquels notre société échoue à donner les moyens de se rendre utiles. Une évidence s’impose : la compréhension de l’importance des valeurs échappe de plus en plus à nos dirigeants et devient l’apanage d’une minorité de braves gens dont la voix atteint rarement les oreilles des tenants du pouvoir, et touche encore moins fréquemment leurs cœurs. Le poids d’acteurs économiques a fini par surpasser celui des hommes politiques. Les deuxièmes deviennent effectivement, en toute logique, bien démunis lorsque les moyens par lesquels leur influence se manifeste sont détenus par des possesseurs de géantes entreprises et industries privées. Ces dernières, lorsqu’elles se rendent aussi indispensables qu’à l’heure actuelle, exercent des pressions colossales sur les représentants politiques élus au suffrage universel. Ceux-ci n’ont plus l’autorité suffisante pour contraindre les libéraux les plus débridés à respecter des contrôles stricts fixés par l’État. Cet état de fait a conduit à l’abandon du modèle keynésien qui a été appliqué à partir de 1933 de sorte à éviter une nouvelle Grande Dépression. Or, sous prétexte de la fin des Trente Glorieuses, il a laissé place, à l’aube des années 1980, à un nouveau système renouant avec le libéralisme sauvage d’avant 1929, engendrant un immense accroissement de la richesse de quelques-uns aux détriments de l’écrasante majorité de la population qui a subi des crises à répétition, dont l’actuelle est l’aberration la plus aboutie.
À titre d’exemple éloquent montrant l’étendue de la domination du secteur privé sur le secteur public, considérons le fait que les 500 plus importantes multinationales américaines détiennent plus de 75% du PIB des Etats-Unis. Le mécanisme est le même dans nos pays européens, indissociablement liés au modèle capitaliste américain et à sa société de consommation. Les pans coûteux et non rentables de l’économie sont laissés en guise de miettes à l’État. De leur temps, les présidents Wilson, Eisenhower et Kennedy avaient mis la population en garde contre les risques de dérives des banques privées et du complexe militaro-industriel. Ces craintes se sont concrétisées, et notre époque est l’âge d’or de ces dernières. Cette situation est grave dans le sens où le secteur public a davantage tendance à veiller au bien-être des compatriotes, car il s’agit de la mission qu’il est censé poursuivre. Les acteurs du secteur privé, eux, ne recherchent que le profit, qu’ils n’hésitent pas à générer par les moyens les plus douteux comme la spéculation irrationnelle, le blanchiment de l’argent de la drogue ou la vente d’armes, et ne connaît ni patrie ni frontières. C’est pourquoi l’avènement de celui-ci au niveau de premier rôle dans l’exercice du pouvoir ne peut marquer une ère de bien-être généralisé des citoyens engendrée par une quelconque prospérité sociale.
La crise actuelle et la prolifération des guerres menées par les États-Unis et appuyées par une large majorité de pays européens montrent la folle nature de ce système. Longtemps après avoir mené une guerre aussi longue que meurtrière au Vietnam, de nouveaux conflits sont survenus en masse à partir de la fin des années 80’, coïncidant avec la nouvelle politique de libéralisme immoral. La liste est longue : le Nicaragua, le Panama, l’Irak, l’Afghanistan et la Somalie sont les pays où une intervention militaire américaine a été menée récemment. Malgré sa promesse de rupture avec son prédécesseur conservateur, le prix Nobel de la paix, Barack Obama, s’est engagé à aller au bout de cette logique, envisageant même de nouvelles guerres au Yémen et en Somalie. Ce n’est pas comme si le président démocrate avait réellement le choix : il est prisonnier des mécanismes du capitalisme mafieux dont il a, en apparence seulement, pris la tête. La sécurité nationale n’est qu’une raison parmi d’autres de mener ces guerres : la plus importante semble être la cupidité de quelques pilleurs internationaux.
Tout cela pour dire qu’un système verrouillé qui s’obstine dans ses errances ne peut profiter pleinement de la contribution de chacun. Une ploutocratie a succédé à notre démocratie, et notre société ne pourra réellement changer que lorsque ses propres contradictions l’auront amenée mécaniquement au bord du gouffre. Face à ce constat, deux choix s’imposent. Le premier consiste à être le chantre inconditionnel du système, et à l’approuver aveuglément dans ses moindres faits et gestes, sous prétexte que c’est en son sein que l’on est né et que l’on ne connaît pas de meilleur ordre des choses. Le deuxième implique de défendre des valeurs, d’être objectif et critique vis-à-vis de tout ce qu’une société propose, qu’il s’agisse de la nôtre ou d’une autre, et de s’opposer à toute forme d’impérialisme. J’opte pour ce dernier choix, avec la conviction qu’il s’agit de la position la plus patriote tandis que la première est lâche et imbécile, que c’est avec la généralisation d’un tel état d’esprit qu’une nouvelle donne peut être lancée, et que la réalité de la liberté et du respect des droits de l’homme puisse alors attribuer toute sa beauté à un nouveau système émergent.












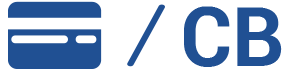
 et
et  !
!

