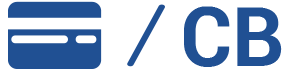Soral contemple le monde avec l’œil dur de celui qui a trop vu. Il a voyagé, il a comparé, il a jugé. Et ce qu’il a vu en Corée du Nord l’a frappé. Non pas les uniformes, non pas les statues, mais les corps. Ces silhouettes sèches, taillées par le manque et la rigueur. Ces hommes droits, tendus, fonctionnels, presque militaires jusque dans la chair. Il les a regardés avec une forme d’admiration. Non pas une admiration politique, mais une fascination corporelle, virile, brutale. Ce corps nord-coréen est un manifeste. Il dit : je ne cède pas. Il dit : je résiste.
Et face à cela, l’Occident se traîne. Un gros bonhomme occidental, suant dans son t-shirt trop court, respirant comme un moteur encrassé. Une masse sans forme, sans ligne, sans retenue. Ce corps-là est une démission. Il dit : j’ai cédé. Il dit : je prends sans fin, je consomme sans mesure. Il est le fruit moisi de la liberté transformée en caprice. Soral n’a pas eu besoin de grands discours. Il a vu, et ce qu’il a vu lui a suffi. Il a opposé deux visions du monde, incarnées dans la chair.
Je ne prends pas parti. Je ne flatte ni la maigreur disciplinaire ni la graisse permissive. Je regarde. Je jauge. Je mesure le poids des corps comme on évalue le prix des âmes. Car il n’existe, en vérité, que deux types d’hommes : ceux dont le corps est une forteresse, et ceux dont il est une capitulation. L’un oppose sa forme au chaos. L’autre épouse sa mollesse. Je n’ai pas besoin d’aimer. J’observe. Et quand vient le moment, je tranche. Car juger n’est pas une émotion, c’est un droit. Et ce droit s’exerce sans bruit, sans appel, sans pardon.