Au vu de l’enlisement de l’OTAN, « il est clair désormais qu’il nous faut repenser la question des buts comme celle des alliances, » constate Jacques Sapir, qui suggère de rechercher une implication des puissances voisines, la Russie, la Chine et l’Iran, dans la résolution du conflit, mouvement qui selon lui pourrait préfigurer un rapprochement entre l’Alliance Atlantique et l’Organisation de Coopération de Shanghaï. Cette redéfinition des objectifs et de la stratégie requiert que le « scénario de cette guerre ne [soit] écrit uniquement, ou même principalement, par les Etats-Unis ». « La principale faute du gouvernement français et de son Président actuel ne fut pas de rejoindre le commandement intégré de l’OTAN mais de ne pas avoir usé de ce prétexte pour forcer les Américains à discuter de ces questions, dans notre intérêt comme dans le leur », estime Jacques Sapir, qui s’interroge : la France fera-t-elle preuve du courage nécessaire pour impulser ces remises en cause ?
La seconde guerre d’Afghanistan dure maintenant depuis plus de sept ans. C’est l’age de la maturité, mais c’est aussi celui des bilans. C’est une guerre discrète, qui a le bon goût de ne pas venir envahir la une de nos quotidiens ni des journaux télévisés, sauf en cas de pertes importantes, comme en 2008. C’est une guerre que l’on pourrait presque oublier. D’ailleurs, à ne voir que les images que l’on veut bien nous montrer, l’Afghanistan n’est présent dans notre quotidien que très épisodiquement, et sous la forme d’un hôpital que l’on inaugure un jour en présence de personnalités du monde des arts et du spectacle, d’une ferme modèle ou d’une école un autre jour.
Qui croirait que dans cette guerre se jouent des équilibres internationaux ? Le retour de la France au sein du commandement intégré de l’OTAN a pourtant été justifié par ce conflit. C’est dire tout le mérite de ce livre et de ses auteurs, qui ont remis sur le devant de la scène cette guerre pour tenter d’en tirer les leçons avant qu’il ne soit trop tard. Car, cette guerre, nous pourrions bien la perdre, et avec elle l’ensemble de notre crédibilité de « démocratie occidentale ».
Qui parle de guerre dit les morts et les blessés, les estropiés et les victimes civiles, ici bien plus nombreuses que les victimes militaires. Il n’est pas de guerre sans victimes, en dépit de ce que l’on veut nous faire croire. Faire la guerre implique de tuer, souvent, et de mourir, parfois. On ne fait donc pas la guerre innocemment, et l’on ne la fait pas par hasard ; du moins ne le devrait-on pas.
Pourtant, cette guerre a quelque chose de clandestin. C’est une guerre faite en fraude, par une alliance, l’OTAN, dont ce n’était ni le but ni la fonction, et qui a été véritablement détournée de son objectif premier. Elle ne devait pas prendre d’ailleurs la figure d’une guerre initialement, tout au plus d’une mission de maintien de l’ordre faisant suite à l’offensive américaine de l’hiver 2001-2002.
Alors, nous l’oublions, jusqu’à ce qu’un événement, en général tragique, la propulse pour un instant à la première page. Nous avons alors droit à des discours, mi-ronflants mi-larmoyants, sur la nécessité de cette guerre et sur l’indispensable union nationale qu’elle devrait impliquer. Puis, toute cette émotion retombe et l’on oublie l’Afghanistan jusqu’au prochain incident, à la prochaine catastrophe. Est-ce parce que nous ne savons pas vraiment pourquoi sommes-nous en Afghanistan ? Est-ce par ce que notre présence est inadéquate ? Est-ce enfin parce que cette guerre que nous menons sans la diriger, et dont nous avons honte dans certains milieux, est une guerre que nous sommes en train de perdre ? Ces questions dérangent, mais il faut les poser.
Les interventions militaires des puissances occidentales semblent aujourd’hui provoquer plus de chaos que d’ordre. Il faut s’interroger sur ce paradoxe. L’application de la force armée devait nous donner plus de sécurité. Elle n’a réussi qu’à étendre l’insécurité, à contaminer un autre pays (le Pakistan), tout comme il y a quelques années de cela une autre intervention contre le pouvoir des « tribunaux islamiques » de Somalie a donné un nouveau développement à la Piraterie sur la façade est de l’Afrique. Est-ce parce que ces guerres sont inutiles ou parce qu’elles sont mal menées ?
Plus profondément, c’est la question de la « guerre à distance » qui est posée. Cette théorie de la guerre est en train de gagner progressivement tous les pays occidentaux, à l’imitation des Etats-Unis. Mais, la « guerre à distance », avec sa promesse de pertes nulles (du moins pour celui qui la pratique...), s’avère un piège redoutable qui se referme sur celui qui s’y abandonne.
Dans le même temps, on assiste à un retour du concept de guerre « anti-insurrectionnelle ». Ce dernier, plus réaliste en apparence, n’est pas non plus sans défauts. Il oblige dans tous les cas à repenser l’articulation des moyens militaires et des moyens civils (parfois mis en oeuvre par des militaires ou d’anciens militaires) nécessaire pour que ces opérations apportent une sécurité durable.
Enfin, se pose la question de l’ordre que nous voulons établir. Comment créer un Etat alors que nous sommes en train, au nom de l’idéologie néo-libérale, partout de les affaiblir et de les démanteler ? Cela est vrai aussi en Afghanistan où des sociétés de sécurité privées, avec leurs propres règles d’engagement, se développent et prolifèrent en parallèle à l’action publique, et où l’on a voulu imposer de toutes forces la privatisation d’une agriculture aux dépens des structures collectives qui existaient dans les villages.
On aboutit à reformuler le paradoxe par lequel nous avons commencé. Cherchons-nous réellement à produire de l’ordre ou, au contraire, sommes nous engagés, volens nolens, dans une production de chaos à grande échelle ? Peut-il y avoir un ordre néo-libéral ou bien ce dernier concept est-il si radicalement étranger à la notion d’ordre qu’il ne peut que produire du chaos ? Cette question est loin d’être académique. De la réponse que nous lui apporterons dépendra le sort de l’Afghanistan mais aussi, d’une certaine manière, le nôtre.
Sommes-nous en train de répéter les erreurs des Soviétiques ?
Ce n’est pas un mystère que la guerre a pris pour les forces de l’OTAN une mauvaise tournure. Ceci nous est confirmé de manière quasiment quotidienne par l’allongement sinistre de la liste des pertes humaines. Encore faut-il signaler que, dans ces pertes, nos ministres et nos journalistes ont le bon goût de ne pas ajouter celles de la population civile qui sont, et de loin, nettement plus considérables.
La montée en puissance des Talibans, l’insécurité qui règne dans les villes, et ce alors que, au départ, elles étaient relativement sures, sont ici autant de signes indéniables d’une dégradation de la situation sur le terrain. Il faut y ajouter la déstabilisation du Pakistan, dont les « zones tribales » ont été un refuge pour ces mêmes Talibans et qui, aujourd’hui doit faire face à une double offensive de ces derniers, la première sur le terrain directement militaire et la seconde, peut-être plus dangereuse encore, qui a pris la forme d’une pénétration des administrations et des forces de sécurité. Dans un pays brutalement fragilisé par la crise économique depuis 2008, et confronté au reflux des capitaux en provenance du Golfe, la combinaison de l’insécurité économique et de l’insécurité politique pose un redoutable double défi.
L’OTAN est entrée en Afghanistan, à la suite des Américains, escomptant une guerre courte qui serait suivie d’une période d’opérations de maintien de l’ordre. Si, effectivement, les forces des Talibans n’ont pu empêcher les Américains et les Forces de l’OTAN de se saisir des principales villes, c’est dès ce moment qu’une grave erreur a été commise. En poussant Hamid Karzaï au pouvoir, les Américains se sont peut-être assurés de la fiabilité du gouvernement de Kaboul, mais certainement pas de sa légitimité. Les accords passés avec divers chefs de guerre ont certes permis une avancée rapide des troupes de la coalition, mais au prix d’une fragmentation du pouvoir. Confiant dans des accords qu’ils ont signés avec le commandement militaire, ces chefs de guerre n’ont pas perdu de temps pour renforcer leur pouvoir en leurs fiefs. La corruption éhontée du gouvernement central, qui trouve son origine dans la famille du Président et qui a été favorisée au départ par les Américains qui y ont vu un moyen simple de s’assurer des fidélités, n’a fait que renforcer le manque de légitimité du gouvernement en place à Kaboul. La consternante mascarade de l’élection présidentielle, qui a vu Hamid Karzaï déclaré vainqueur par défaut, son concurrent s’étant retiré devant l’ampleur des fraudes, ne vient pas redorer le blason de ce pouvoir.
On connaît la suite des événements. La corruption est donc devenue endémique, aboutissant à une dilution de l’aide et à son inefficacité. On estime aujourd’hui que 20% de l’aide internationale atteint ses destinataires. Les infrastructures, à l’exception de celles qui ont un intérêt militaire, sont toujours en ruines. La politique de la Banque Mondiale, qui a poussé à la privatisation de terres en propriété collective villageoise (car dépendant des systèmes d’irrigation) a provoqué un effondrement des cultures tant vivrières que commerciales. Cette catastrophe s’est accompagnée de la reprise de la culture du pavot, qui avait été sérieusement limitée par les Talibans. Ce qui avait d’ailleurs été un des très rares gestes positifs qu’ils aient faits durant leur période au pouvoir.
Dès lors s’est mis en place un cercle vicieux infernal. L’appauvrissement de la majorité de la population conduit au recours aux cultures anciennement interdites, ce que favorisent les pouvoirs locaux. Ces derniers reprennent alors le cycle des exactions et du trafic qui leur avaient valu d’être supplantés par les commandants Talibans. La nostalgie pour l’ancien ordre ne fait que croître et entraîne une répression largement aveugle de la part des troupes de l’OTAN, tandis qu’à Kaboul se développe une économie de la rente et de la prédation. Tout cela contribue alors à faire à nouveau le jeu des Talibans, et entraîne de nouvelles attaques des troupes de l’OTAN avec des dommages importants dans les populations civiles. Par ailleurs, poussée au désespoir par les conditions matérielles et l’absence totale de perspectives, la fraction « moderne » de la population ne voit pas d’autres solutions que l’exil et vient grossir le flot qui s’accumule à Calais.
Le fait est que si le régime des Talibans était incroyablement arriéré et sanguinaire, les puissances occidentales ont plongé l’Afghanistan dans un chaos qui s’est avéré, à certains égards, pire encore pour la population, à l’exception de quelques rares microrégions et de quelques privilégiés. La puissance de feu des troupes de l’OTAN s’avère dès lors incapable de gagner la guerre. Dans un certain nombre de cas, elle contribue même aux problèmes évoqués plus haut.
On peut ici faire la comparaison avec la guerre que menèrent les forces soviétiques. L’inadaptation des moyens et des forces a été patente durant toute la première période du conflit. Ceci avait conduit à de lourdes pertes. Le processus d’apprentissage qui s’est alors produit a conduit à accorder une importance particulière aux progrès sociaux de la population civile, du moins dans les parties que les Soviétiques considéraient comme utiles, et à appliquer une politique de la terre brûlée et du combat à outrance dans le reste de l’Afghanistan. On oublie un peu vite que le gouvernement, que les Soviétiques avaient mis en place sur la base d’une partie de leurs partisans locaux, a réussi à survivre trois ans au départ de leurs troupes. Combien de semaines le gouvernement Karzaï tiendrait-il si les Américains et l’OTAN devait quitter soudainement le pays ?
Or, il faut être bien conscient que c’est à cette aune-là qu’il nous faudra mesurer le succès ou l’échec de notre présence. Les conditions de notre départ seront aussi les conditions de notre succès.
Pour l’instant, non seulement avons-nous été dans l’incapacité de sécuriser ne serait-ce qu’une partie de l’Afghanistan, mais nos méthodes de guerre, qui sont en train de ruiner la société afghane ont profondément déstabilisé le Pakistan voisin. Nous voici confrontés à une crise de sécurité globale dans la région, et dans laquelle est impliqué un pays qui dispose de l’arme nucléaire. Ce problème est en réalité bien plus important que celui de l’Iran. Il fait réellement de l’Afghanistan un enjeu stratégique et politique majeur. La nature et les buts de la guerre.
Cette guerre est aussi déterminée par ce que furent, et ce que sont, ses buts. La décision de « libérer » l’Afghanistan de la domination cruelle des talibans a été présentée au monde occidental comme une évidence, que renforçait la complicité de ses derniers dans les attentats du 11 septembre 2001. Mais, rapidement, la réalité de la guerre a divergé de ce qu’elle était censée être.
Si les talibans ont été chassés de Kaboul dans les provinces nombreux sont les chefs de guerre qui furent leurs alliés et qui survivent aujourd’hui, sur la base d’accords passés soit directement avec les Américains soit indirectement par le biais du gouvernement Karzaï. La population de l’Afghanistan a par ailleurs fort peu profité de cette « libération ». Aussi est-on est en droit de se demander si l’on n’a pas sacrifié l’avenir dans la manière dont ont installé un nouveau pouvoir. Au-delà, c’est bien l’esprit même de cette guerre que l’on a trahi en tolérant au mieux une version molle de la dictature des talibans, au pire (dans certaines régions) une reprise à l’identique de cette même dictature, pourvu qu’elle soutienne les forces de l’OTAN. Ainsi peut s’expliquer le manque de vigueur des protestations des pays occidentaux face au trucage des élections présidentielles de 2009. Il contraste fortement avec ce à quoi l’on est habitué par ailleurs, et en particulier quand ces élections se déroulent dans des pays dont les politiques sont contradictoires aux nôtres. Mais, ce faisant, on enfonce encore un peu plus le clou dans le sentiment, aujourd’hui très répandu, que la « démocratie » et les « valeurs occidentales » ne sont que des prétextes. Nous participons ici à une instrumentalisation des valeurs démocratiques dont nous serons, à terme, les premières victimes.
Au-delà, cette politique révèle un dangereux paradoxe : pour protéger nos soldats, nous sommes désormais conduits à pactiser, ou à chercher à pactiser, avec les néo-talibans. Mais nos soldats sont en théorie en Afghanistan pour se défaire de ce régime. Ainsi se révèle une stratégie doublement perdante. Pour les ultras, tout gouvernement ayant l’aval des occidentaux sera illégitime. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les talibans ont rejeté la main tendue par le gouvernement Karzaï. Pour les autres, et qui devraient être nos alliés, à quoi bon s’engager derrière les occidentaux si ces derniers sont prêts à passer des compromis pour obtenir le ralliement des talibans ?
Qui donc aujourd’hui peut croire que nous sommes réellement en Afghanistan pour y défendre les « droits de l’homme » (et ceux des femmes en particulier) ? Ainsi s’inscrit le cercle de la désespérance qui pousse une partie de l’élite intellectuelle afghane dans l’émigration. La politique stupide de notre Ministre de l’Intégration, Éric Besson, vient alors conforter la politique absurde de notre Ministre des Affaires Étrangères, Bernard Kouchner. Le premier veut renvoyer dans leur pays ceux qui ont fuit la situation mise en place par le second. Il leur dénie, contre toute évidence, le statut de réfugiés. Quant au second, l’aveuglement criminel dont il fait preuve quant à la politique américaine, et dont il a déjà donné des exemples que ce soit au Kosovo ou au sujet de l’Irak, le conduit à apporter la caution de la France à une situation chaque jour plus désastreuse.
Cependant, cet écart désormais palpable entre les buts proclamés et la réalité nous révèle aussi la possibilité qu’il y ait des buts de guerre inavoués car inavouables. On peut en dresser une courte liste.
Il y a tout d’abord la volonté américaine de trouver aux hydrocarbures d’Asie Centrale une voie de sortie qui ne soit dépendante ni du bon vouloir des Russes ni des Iraniens. Tel fut, ne l’oublions pas, le sens de la diplomatie américaine du temps du Président Clinton.
Il y a ensuite la volonté de s’installer dans ce qui est l’un des pivots géostratégiques d’une région à haut risque.
Il y a enfin la volonté délibérée de faire une démonstration de puissance à l’usage des voisins, qu’il s’agisse de la Chine ou de l’Iran, et de s’attirer les bonnes grâces de l’Inde.
Disons le tout net, si telles étaient les raisons de la présence de l’OTAN, c’est bien à un échec tout aussi patent que l’on est confronté. La démonstration de force a tourné court. La présence géostratégique est d’ailleurs dépendante largement de cette démonstration de force. Elle est au mieux contestable dans les circonstances actuelles. Quant aux intérêts pétroliers, il est clair aujourd’hui que pour au moins une décennie, si ce n’est plus, nulle compagnie n’investira dans la région, sauf peut-être une compagnie Russe...
Reste donc l’argument qui nous est aujourd’hui présenté. L’Afghanistan est l’un des foyers du terrorisme et cela exige notre présence pour combattre ce dernier. Mais, il n’y a rien de terroriste par nature dans un peuple, et le pouvoir des talibans d’ailleurs ne fut pas la seule source de ce dit terrorisme. La meilleure des réponses au terrorisme serait de permettre à l’Afghanistan d’évoluer vers une situation, si ce n’est de liberté, du moins de progrès social. Il faut alors noter qu’une telle stratégie implique une rupture nette à la fois avec tout ce que compte l’Afghanistan de néo-talibans et aussi avec ce que charrie l’idéologie néo-libérale. Nous n’en prenons pas le chemin.
Faudra-t-il alors s’accommoder de la litanie des pertes, et ce jusqu’au moment où les opinions publiques, à juste titre lassées, nous obligerons à nous retirer ?
Nous voici donc dans une guerre qui ne dit pas son nom, dont les buts sont aujourd’hui suffisamment brouillés et obscurcis pour devenir indéchiffrables, et dont le coût, humain et matériel, ne cesse de monter. Les options qui nous sont offertes ne sont pas illimitées et le temps qui nous est imparti n’est pas indéfiniment extensible. C’est pourquoi les problèmes des alliances, et du fonctionnement de l’Alliance atlantique, sont aujourd’hui posés, même si peu nombreux sont ceux de nos dirigeants politiques qui veulent bien l’admettre. Les alliances.
Il est donc clair désormais qu’il nous faut repenser la question des buts comme celle des alliances. La principale faute du gouvernement français et de son Président actuel ne fut pas de rejoindre le commandement intégré de l’OTAN mais de ne pas avoir usé de ce prétexte pour forcer les Américains à discuter de ces questions, dans notre intérêt comme dans le leur. Nous ne saurons jamais qu’elle eut été la réaction américaine à un ultimatum de Paris : soit nous quittons l’Afghanistan, soit nous rentrons dans le commandement intégré, mais pour cela nous exigeons que soit posée à nouveau la question des alliances et qu’un bilan soit tiré des errements passés. Nous ne le saurons jamais parce qu’une telle alternative n’a pas été présentée à Washington. Pourtant, nul n’est obligé de suivre les bêtises d’autrui. Cette faute, nous la payons au prix du sang.
La première question qu’il nous faudra trancher, et ce dans un proche avenir, est celle d’un élargissement de l’alliance. Pour dire les choses crûment, faut-il pousser encore plus loin l’internationalisation de la guerre, et y intégrer la Russie et la Chine, et peut-être l’Iran ?
Ceci est moins absurde qu’il n’y paraît. La Russie est directement préoccupée par le devenir de l’Afghanistan, que ce soit de manière indirecte pour la sécurité de l’Asie Centrale ou même de manière directe en raison du développement du trafic de drogue sur son territoire en provenance d’Afghanistan. Elle participe dès aujourd’hui à la formation de la police afghane. Elle pourrait contribuer à celle de l’Armée dans les mois à venir. S’il est pour l’heure exclu que la Russie déploie des troupes en Afghanistan (hors les unités de SpetsNaz qui opèrent le long de la frontière du Tadjikistan), sa contribution économique pourrait être relativement importante dans le domaine des infrastructures publiques.
La Chine est, elle aussi, inquiète du développement de l’activisme religieux issu d’Afghanistan, et aujourd’hui du Pakistan, qui se manifeste sur son territoire. Si la Chine a pour l’instant une politique de non-intervention, en particulier dans le domaine militaire, elle pourrait participer plus largement aux opérations de sécurité par le biais de l’Organisation de Coopération et de Sécurité. Quant à l’Iran, son contentieux avec les Talibans est ancien, et avait laissé planer la possibilité d’une intervention iranienne dans ce pays en 1999/2000. On mesure ici toute l’absurdité qu’il y a à vouloir à tout prix construire ce pays en ennemi alors qu’il détient en partie l’une des clés de la sécurité au niveau régional.
Mais, pour élargir l’alliance, il faut alors résoudre d’autres problèmes d’ordre géopolitique. Ils concernent la Russie en premier lieu mais aussi la Chine et surtout l’Iran. Il n’est donc pas possible de traiter la question de l’élargissement de l’alliance en dehors d’une révision de la politique américaine au Moyen-orient pris dans son sens le plus large. Or, si l’arrivée du Président Obama a bien mis fin aux excès de l’administration précédente, nous sommes néanmoins très loin d’une révision globale. Sous la férule d’Hillary Clinton, c’est plus à une adaptation qu’a un véritable changement que les Etats-Unis ont consenti pour ce qui concerne leur politique étrangère.
Pourtant, l’Afghanistan pourrait être l’occasion d’un rapprochement entre l’OTAN et l’OCS, dont la Russie et la Chine sont parties prenantes et où l’Iran a le statut d’observateur. Cette « alliance des Alliances » est très certainement de toutes les possibilités celle qui possède le plus gros potentiel pour une stabilisation de l’ensemble de la région.
Une seconde question qui sera elle aussi à trancher dans un très proche avenir concerne les équilibres dans l’alliance actuelle. Elle est à l’évidence liée à la première, mais elle possède aussi sa dynamique propre. Pour dire les choses brutalement, le scénario de cette guerre ne peut être écrit uniquement, ou même principalement, par les Etats-Unis. Soit ces derniers acceptent que leurs partenaires aient leur mot à dire au plus haut niveau et que la question des buts de guerre soit à nouveau posée, soit l’alliance connaîtra des jours sombres. Comment pourrions-nous rester dans une alliance où notre voix ne serait pas entendue ? Les combats de l’été 2009 ne font en réalité que préfigurer ce qui nous attend en Afghanistan et l’hiver s’annonce sous de biens sombres augures. Ce n’est donc pas faire preuve d’un chauvinisme cocardier que d’affirmer que le débat doit avoir lieu au sein de l’OTAN, et ce pour le bien de tous. Ce n’est pas, non plus, faire preuve du même chauvinisme cocardier que de penser que, si cela ne pouvait être, si les Etats-Unis et leurs clients traditionnels (Grande-Bretagne, Canada) se refusaient à des révisions générales, il nous faudrait en tirer les conséquences quant à notre présence dans l’OTAN.
On peut, à partir de ces deux questions, imaginer trois scénarios pour le futur.
Le premier est donc celui d’un élargissement de l’alliance accompagné d’une révision profonde des buts de guerre. À une montée des effectifs présents sur le terrain répondrait alors un programme beaucoup plus volontariste (et réellement appliqué) de reconstruction de l’Afghanistan faisant la part belle à l’action publique. Ce programme prendrait en charge les infrastructures, mais aussi l’équipement des zones rurales en respectant les logiques collectives qui prédominent dans les villages. Il s’appuierait sur une politique de prix garantis pour les ressources agricoles rendant immédiatement tangibles les effets positifs de cette politique. Il s’agirait alors de rallier les franges de la population afghane qui sont porteuses de modernité à la fois par le développement d’une économie urbaine qui ne soit pas basée sur les rentes de toutes sortes et par une opposition claire aux « ultras » et aux « neo-Talibans ». Le processus de démocratisation serait relancé, ce qui implique très probablement le remplacement d’Hamid Karzaï et de certains de ses alliés. Un tel scénario implique nécessairement une présence durable en Afghanistan, que pourrait garantir « l’alliance des Alliances », mais il offre en définitive le plus de chances de transformer en profondeur les structures sociales de ce pays et de lui fournir le cadre économique et politique d’un gouvernement stable.
Le second scénario est celui de l’enlisement, marqué par la prédominance américaine dans l’alliance et les pathologies qui lui sont liées, que ce soit en matière opérationnelle ou dans le domaine de l’action civile. Les opérations de contre-guérilla ne peuvent aboutir ici qu’à des succès limités et transitoires. Elles sont porteuses d’un lourd passif avec les populations civiles qui, le plus souvent, sont les plus touchées. La structure politique du pays resterait inchangée, et avec elle la corruption et les trafics divers qui découragent une large partie de la population urbaine. L’élargissement, ou l’escalade horizontale, de la guerre apparaît alors comme extrêmement probable. La question de la stabilité du Pakistan sera posée de manière de plus en plus visible, et avec elle celle des armes nucléaires que ce pays détient. Il s’agit, ici, d’un problème bien plus réel et bien plus immédiat que la très hypothétique bombe iranienne.
Le troisième scénario est celui du retrait, opéré soit dans le désordre le plus total soit à la suite d’accords passés avec les « neo-Talibans ». Cette dernière option perd cependant chaque jour de sa crédibilité. Il y a fort à parier que ce retrait se ferait dans la confusion la plus totale, exposant par ailleurs les quelques fractions de la population qui ont exprimé des sympathies pour le nouveau régime à des représailles sanglantes qui feraient gonfler le flot des réfugiés.
Il est d’ailleurs parfaitement possible que l’on passe du second au troisième scénario. Dans le cas d’un retrait qui serait le produit d’un accord passé avec les « neo-Talibans », il faut bien mesurer ce qu’il coûterait aux pays de l’alliance, à la fois sur le plan interne et externe. Le reniement des buts de guerre tels qu’ils ont été formulés pour nos populations s’accompagnerait alors d’une « perte de face » durable et prolongée dans la région. L’intégrisme islamique aurait alors remporté sa première victoire indiscutable, redonnant à ce mouvement toute son agressivité à la fois en Orient et en Europe.
Nous sommes aujourd’hui, il faut bien le dire, calé sur le second scénario. C’est en partie par la faute du gouvernement français qui n’a pas voulu se saisir de l’opportunité que représentait le possible retour de la France dans le commandement intégré de l’OTAN pour obtenir une réouverture du débat sur les buts de guerre. Il est cependant possible que nous évoluions dans le futur vers une variante du premier. On peut espérer que les pressions pour une révision globale de la stratégie de l’OTAN se fassent jour chez les différents membres de cette alliance. On peut même souhaiter, à défaut de pouvoir raisonnablement l’espérer, que ce mouvement soit impulsé à partir de notre pays.
Mais, la probabilité la plus forte reste l’enlisement dans la durée et le basculement, toute honte bue, vers le troisième scénario.
Nul ne peut se satisfaire d’une telle solution. Outre le prix à payer, qui sera considérable tant du point de vue matériel que politique, il y a, bien entendu, le prix moral. Lui aussi sera élevé, qu’il s’agisse des soldats, qui pourront demander à juste titre pourquoi ont-ils combattus et au nom de quoi sont morts leurs camarades, ou des populations des pays du sud confrontés une nouvelle fois aux incohérences de notre action. Qui pourra croire désormais en notre engagement pour la démocratie ?
Pourtant, les seuls malheurs inévitables sont bien ceux que l’on n’a pas voulu éviter et auxquels on s’est résigné. Il n’est pas trop tard pour se donner les moyens, plus politiques que militaires d’ailleurs, de « gagner » la guerre en Afghanistan. Mais, ceci impose que l’on remette en débat et les buts de la guerre, et la méthode que l’on utilise, pour ne pas parler du système d’alliances. Alors que se prépare un hiver dramatique sur le terrain, en aurons-nous le courage ?
Par Jacques Sapir, Directeur d’études à l’EHESS, 4 novembre 2009
Ce texte correspond à la version mise à jour de la postface écrite en juillet dernier au livre du Chef de bataillon (TA) Olivier Entraygues (édit.) Afghanistan 1979-2009, publié avec une préface du Général Druart, commandant la Task-Force Lafayette et un avant-propos du Colonel Baulain, chef de corps du CEPC de l’Armée Française.
Cet ouvrage, qui résulte d’un réel travail collectif mené sous la direction d’Olivier Entraygues, résume l’expérience des différentes forces, y compris l’Armée soviétique, qui ont eu à combattre en Afghanistan. De cet ouvrage, deux tirages ont déjà été faits, pour un total de 2000 exemplaires, et l’on peut espérer qu’il sera bientôt disponible sous une forme révisée pour toutes et tous qui veulent comprendre la situation.
Je veux ici remercier le coordinateur de cet ouvrage de m’avoir donné la liberté de publier cette version améliorée de mon premier texte. Les analyses contenues dans ce livre et dans ma postface ont été tragiquement confirmées par les évolutions, tant militaires que politiques, du début de cet automne. C’est pourquoi il m’a semblé nécessaire de publier une version mise à jour, et de la mettre à la disposition du grand public.
Il va sans dire que j’assume seul la responsabilité des opinions contenues dans le présent texte.












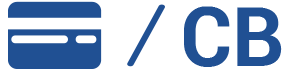
 et
et  !
!

