
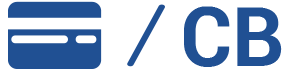
Blague "belge" : la chanson Chaud cacao d’Annie Cordy véhiculerait des stéréotypes sur l’Afrique
17 mars 2021 12:11, par listenerLes indications ci-dessous sont tirées de l’ouvrage de Maurice Delafosse, cité plus haut.
Les verbes sont employés sous une forme simple : infinitif pour le présent ou le futur, pour tous les verbes (sauf « être » qui n’existe pas), précédé du pronom personnel exemple : « moi parler » ;
Certains verbes des autres groupes sont utilisés sous la forme d’un infinitif en remplaçant la terminaison par celle d’un verbe du premier groupe, exemple : « vouler » au lieu de « vouloir », ou parfois en supprimant le "r" final (« parti » au lieu de « partir ») ;
La négation est marquée par le mot « pas » placé après le verbe (« lui parti pas ») ;
Il n’y a pas de genre ni de nombre ;
L’article est supprimé (« son maison ») ou au contraire maintenu de façon permanente comme un préfixe du nom (« son la maison ») ;
Le verbe « gagner » est employé très fréquemment, de même que l’expression « y a » (ou « y en a ») comme particule verbale (pour « il y a » ou « il y en a ») : « moi y a gagné perdu » (signifiant « j’ai perdu ») ; l’expression « moi y’a dit » est caractéristique du français tirailleur ;
Certains mots empruntés au français populaire ou à la terminologie maritime sont fréquemment employés : « mirer » (pour « regarder »), « amarrer » (pour « attacher ») ;
Le mot « là » est employé comme démonstratif (emprunt au créole antillais : ti moun là = cet enfant)
Les prépositions « à » et « de » sont fréquemment supprimées et souvent remplacées par « pour » : « moi parti pour village » (« je vais au village »).
Curieusement, le "petit nègre" a été abandonné sur la simple observation que le français normal était plus simple finalement : "toi y-en a balayer la chambre" est plus long et compliqué que "balais la chambre".

 et
et  !
!