
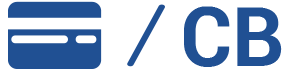
De la société organique à la société de contrat : un cours magistral d’Alain Soral
10 août 2023 18:29, par PaulC’est une bonne chose de rappeler la pertinence de la pensée politique de Rousseau. Ceux qui critiquent cet auteur confondent souvent ses conceptions avec la manière dont certains politiciens de la Révolution française les ont utilisées. Rousseau ne raisonne pas de manière abstraite, contrairement au reproche qui lui est souvent fait. Il s’appuie, d’une part, sur le modèle de la cité romaine antique, d’autre part, sur certains cas politiques de son époque, en particulier la Corse, qui aspirait à devenir une république indépendante au moment où il rédigeait "Le contrat social". Son "Projet de constitution pour la Corse", resté inachevé du fait du rattachement de l’île au royaume de France, est d’ailleurs très éclairant. Il précise certains aspects du "Contrat social". Selon lui, le citoyen libre du contrat politique, loin d’être un homme quelconque, doit avoir des vertus de sobriété, de vigueur physique, de combativité, d’attachement à la liberté propre au producteur agricole et de solidarité. La Corse de cette époque reste imprégnée, selon Rousseau, de romanité. La mentalité du laboureur-soldat n’y a pas disparu. Comme dans le monde romain, le contrat politique de Rousseau se superpose à une structure organique, laquelle ne disparaît pas mais ne constitue pas le cadre politique de la cité. Les révolutionnaires ont fait une interprétation de Rousseau assez particulière, où sa conception fédérative du peuple disparaît. Selon eux, la société du contrat est censée remplacer totalement la société organique. De manière significative, le lecteur du "Contrat social" qu’était Bonaparte, héritier de la centralisation étatique des Jacobins, trouvait que Rousseau n’accordait pas assez d’importance à l’Etat.

 et
et  !
!