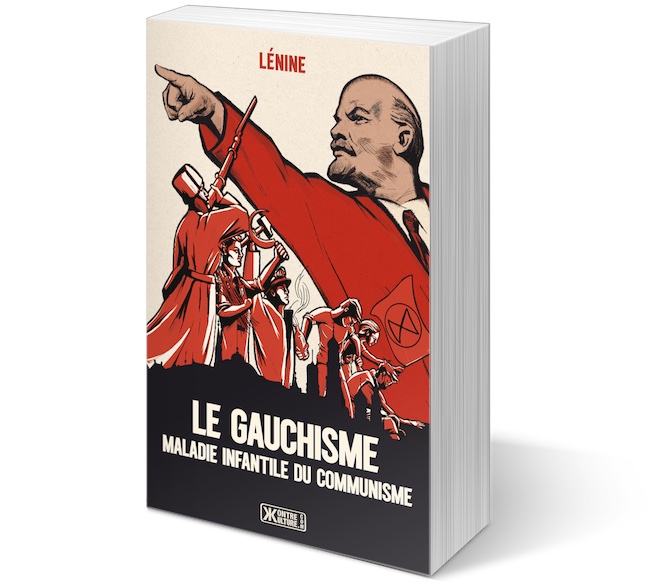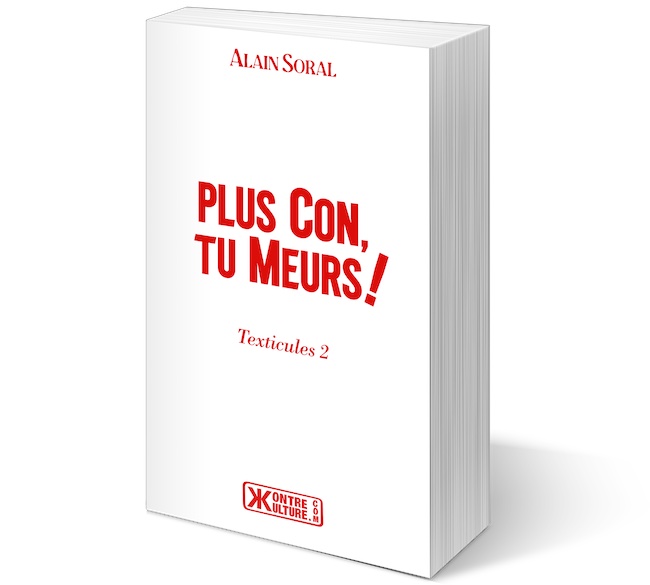Je finis sur ce sujet, car je deviens peut-être un peu lourd (et plus on en dit plus on a de chances de s’égarer et d’émettre des conneries).
Je parlais tout à l’heure des Algériens. C’est un point d’appui pour exposer une idée, établir une analogie (ou une différence), comparer...
Les Algériens voulaient se débarrasser des Français, et ils se sont mis à la tâche. Ils ont réussi en y mettant le prix. Voilà, ça c´est l´histoire. Pour cela les Algériens ont créé le FLN, pas Riposte Laïque. Je m’explique ?
Chez nous (dans des circonstances qui ne sont pas les mêmes, évidemment), nous avons des gens (du type du personnel de Riposte Laïque, mais pas qu´eux) qui veulent se débarrasser des Musulmans, qui parlent de déportation, de remigration, qui prêchent la Reconquista (pour faire simple). Très bien, l’idée en soi me plaît. Je ne suis pas contre, je suis pour. Mais comment on fait ? Nous avons RL, nous n’avons pas le FLN. Différence.
Ces cons de RL et assimilés quand ils parlent de Gaza, des Palestiniens, on voit bien qu´ils n’ont rien compris à rien, mais bon ils veulent empêcher le Grand Remplacement en cours à la maison (tout en le validant ailleurs), et c´est pour ça qu´ils s’excitent en fantasmant sur de la solution à l´israélienne et se délectent de la brutalité et la violence des sionistes.
Je reviens à mon sujet. La Reconquista, je crois qu´elle est nécessaire, mais je pense qu´elle n’est pas possible dans la réalité du moment actuel. En théorie elle serait (peut-être) possible, mais à quel prix ! Il faudrait casser beacoup d´oeufs pour cette omelette. Je pense que les Français, les Européens, ne sont pas mûrs pour une solution radicale, disons-le comme ça, surtout si elle supposerait de la souffrance pour ceux-ci. Et pourtant, pour moi la chose est claire : à la longue ce sera eux ou nous. Nous récupérons notre pays ou on le perd définitivement (avec ou sans la complicité de nos élites, ça c’est une autre affaire).
Certains disent : Le Grand Remplacement est une fantaisie. D’autres (voire les mêmes) disent : La Reconquista est une fantaisie. Ces deux fantaisies opposées font nous rattraper et surprendre tôt ou tard, tout cela se matérialisera un jour sur le terrain des choses réelles. Et je crois plutôt aux chances du Grand Remplacement qu’à une victoire de la Reconquista. Nous n´avons pas le FLN, nous avons RL. Jugez des éléments en place.
Je n’ai pas de solution, je constate une réalité qui crève les yeux.












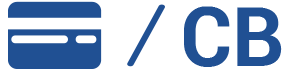
 et
et  !
!