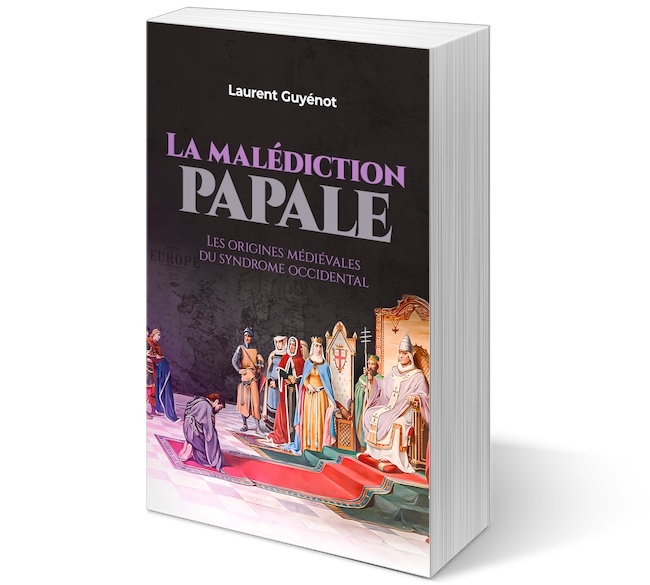« ... certaines communautés gnostiques tirent probablement leurs origines de milieux juifs hétérodoxes. C’est pourquoi l’attitude de la gnose à l’égard du judaïsme et de ses différents courants n’est pas dépourvue d’ambiguïté.
Les écrits gnostiques abondent en commentaires de l’Ancien Testament, spécialement des premiers chapitres de la Genèse. Bien plus, les genres littéraires et les règles exégétiques répondent aux usages juifs de la période du second Temple (515 avant J.-c.-70 après J.-C.). Pourtant le sens de l’interprétation est globalement paradoxal.
Le Dieu d’Israël, créateur du monde et auteur de la Loi, est ravalé au rang d’un Démiurge arrogant et vindicatif, qui garde l’âme humaine captive de la chair et usurpe le culte dû au Dieu inengendré, véritable Père du Tout.
C’est de cette ignorante servitude que le Christ est venu délivrer les hommes.
Mais tandis que les spirituels, qui possèdent en eux l’étincelle divine, ont reçu de lui la gnose de l’absolu, les juifs, aveuglés par la Loi, n’ont rien compris à son message. ».
Extrait de l’Introduction de Jean-Pierre Mahé p. XXIII - Écrits gnostiques - La bibliothèque de Nag Hammadi publiés à La Pléiade - Éd. 2007.
... d’où la dette éternelle et l’idéologie sioniste différemment dénommée selon les époques se transmettant de génération en génération pour leur Démiurge et affidés avec la complicité du Vatican et des protestants.
Cette dette ou devoirs, nous la devons au seul Dieu immanent, ontologique qui nous a prêté de sa Lumière, une Étincelle divine dont la voix est étouffée dès la naissance jusqu’à a mort.
.
Raison pour laquelle, l’expression populaire « rendre son âme* » signifie remettre au Divin, à Dieu, à notre Père, la Source, son âme laquelle contient en substance, après la mort physique les intentions, les pensées, les actions, l’expérience, le déroulé, l’accomplissement de notre existence à chacun, contenues dans la mémoire de l’âme.
Les thuriféraires du seul Démurge Yahvé identifié à la Loi nécessaire à une certaine période historique barbare de l’humanité poursuivent sans relâche par obscurantisme, les aveugle sacrifices et holocauste des nations par des guerres sans fin pour maintenir la pression sur l’humanité.
* s’il faut la rendre, c’est qu’elle nous a été prêtée. Et par qui ? :)
Au Démiurge imposteur périssable ou au Dieu du Tout, immanent, le non-engendré, le Père, la Source Présent dans notre Temple intérieur (nos corps physique, mental, éthérique etc ...)
Répondre à ce message












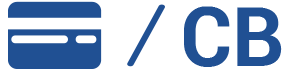
 et
et  !
!