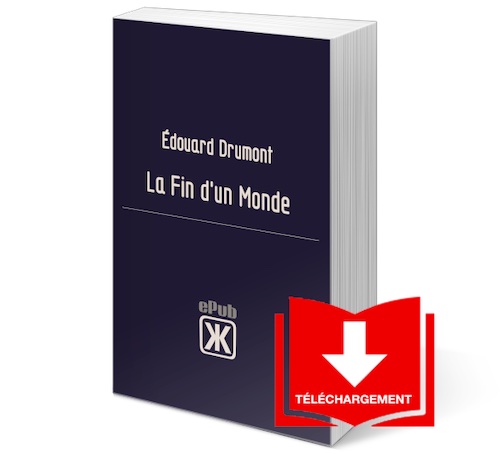Extrait d’Édouard Drumont, Le Testament d’un antisémite, 1891
Les Parisiens ont réélu la plupart des conseillers municipaux convaincus d’avoir trempé dans ces malpropretés. Ils les ont réélus très librement, avec des urnes très surveillées par des représentants de tous les partis, par des gens de comités experts dans toutes les roueries électorales et qu’on ne met pas facilement dedans.
Tout vient se briser contre une indifférence absolue, contre une sorte d’ataraxie, d’impassibilité générale, qui n’est point l’ataraxie stoïque dont parle Proudhon, mais plutôt une inertie maladive, une prostration sur laquelle rien n’agit. […]
Il y a eu trop d’efforts ce dernier siècle, trop de hâte trépidante, trop de connaissances fragmentaires, dispersées, illusoires. Il semble que l’on ait vécu dans un kaléidoscope. Obligée de s’appliquer à la fois aux théories sociales, aux découvertes de la science, aux essors des lettrés, la vision papillote et fatigue. Il faudrait ce regard à facettes des insectes, cet œil-mosaïque dû peut-être à des morcellements infinis de choses, pour comprendre tant de mouvements heurtés, tant de couleurs criardes. […]
La mort gagne le monde par l’insensibilité, par l’anesthésie. Cette anesthésie sociale, que l’on appelle l’ataraxie, envahit les masses, comme sa sœur envahit les êtres. Elle débute d’ici, de là, par plaques qui se rejoignent et couvrent bientôt le corps tout entier. Certaines régions intermédiaires jouissent d’une fausse excitation que l’on retrouve avant tous les désastres. Celui qu’attend la congestion bâtit des projets bienheureux. Nous autres, au bord du gouffre, nous affirmons le Progrès indéfini, une ère joyeuse et libre. Au fond, nous ne croyons même pas à demain, et nous nous en occupons très peu.
On a donné bien des noms à cet état particulier, que chacun constate. Weiss a parlé d’une maladie des moelles, d’un affaiblissement du vis vivendi ; d’autres d’insensibilité volitive, d’aboulie, d’impuissance de la volonté.
Personne, en tout cas, ne conteste la dégénérescence de cette race qui eut jadis une si débordante vitalité.
Il faut ajouter, cependant, que cette dépression intellectuelle, que les Français avouent eux-mêmes, ne se traduit pas chez eux par le pessimisme.
Le pessimisme est particulier aux natures supérieures. Dès qu’on touche aux profondeurs de l’être, qu’on se penche sur l’énigme du monde, qu’on s’unit de cœur à la souffrance de ceux qui nous entourent, il est impossible de ne pas éprouver une impression d’anxiété et d’amertume devant l’impénétrabilité de cet impassible univers, qui s’obstine à ne pas répondre à nos interrogations, à ne rien nous révéler de ses secrets… Les frivoles rient jusqu’à la mort ; les esprits moins légers, ceux qui réfléchissent sur les spectacles que la vie déroule devant eux et qui s’irritent de ce qu’elle leur cache, ne peuvent se défendre de la tristesse qui se dégage de tout… Cor sapientium ubi tristitia…
Les Français modernes n’ont rien de tout cela. Les troublantes théories de Schopenhauer comme les belles désespérances de Tolstoï, vastes et désolées comme des steppes, les laissent parfaitement indifférents. Intellectuellement, c’est trop fort pour eux, trop étendu d’horizon, trop intense de pensée ; cela les obligerait à trop de méditation.
La conception que les Français contemporains ont de la vie n’a d’analogue dans aucun temps, elle est tout à fait particulière à notre époque. Notons tout d’abord que si la vie moderne s’est compliquée au point de vue des faux besoins et des raffinements du bien-être, elle s’est singulièrement simplifiée au point de vue moral ; comme une espèce de peau de chagrin, elle se rétrécit tous les jours sous ce rapport.
Si elle avait toujours le ciel comme finalité et comme but, la vie jadis était, même au point de vue terrestre, chose importante et sérieuse ; elle se rattachait par des racines solides à des traditions de familles habitant depuis des siècles sur un même coin de terre, elle se prolongeait par-delà le tombeau par le désir qu’avaient les plus pauvres de laisser d’eux un bon souvenir, de léguer aux leurs de beaux exemples à suivre, un héritage d’honneur à garder à leur tour.
Tout cela a été élagué peu à peu, et l’on a mis ce qui restait en viager. Pour les privilégiés, pour les fils d’enrichis, la vie est une occasion de faire la fête ; pour les déshérités du sort, pour les forçats du travail, elle est un douloureux et monotone trimage, afin d’arriver à manger à peu près régulièrement et à mourir à l’hôpital. Pour les représentants des classes moyennes, pour ceux qui donnent l’idée la plus juste du pays, pour les bien doués, les bien portants, les bien armés, c’est une bagarre dans laquelle on est tombé on ne sait comment, et au milieu de laquelle il faut tâcher de se débrouiller et de se faire jour à coups de poing.
Il y a évidemment des touches cassées dans le clavier humain, des notes qui ne rendent plus. On ignore également la Gaieté franche des ancêtres et la tendre, la poétique Mélancolie. On ne sait plus ce que c’est que le Bonheur, ce présent des Dieux à quelques privilégiés, ce Bonheur qui avait un caractère presque sacré et dont Bonald disait : « Je salue le Bonheur parce qu’il est rare. » On peut dire même qu’à part peut-être chez quelques mères qui ont perdu leurs enfants, on ne connait plus la Douleur, j’entends la Douleur religieuse et grave d’autrefois. C’est fini et des enthousiasmes ardents et des généreuses angoisses d’un cœur déchiré par le Doute.
Il existe seulement des satisfactions et des embêtements, des chances et des guignons qui dépendent presque tous de circonstances matérielles. Tout cela rentre plus dans l’ordre des accidents, des faits divers, des catastrophes que dans l’ordre des sentiments, et l’âme n’en est affectée que très indirectement par les dérangements et les troubles que l’être physique en éprouve dans les habitudes et le train ordinaire de sa vie.
L’homme du Passé, en un mot, avait de nobles motifs pour vivre ; l’homme d’aujourd’hui a seulement quelques prétextes plausibles pour ne pas se tuer et accomplir jusqu’au bout sa corvée.
Cette corvée, le Français contemporain la subit avec un certain entrain, qui est un don qui lui reste de sa race ; il tâche de gagner le plus possible pour nocer davantage, pour se procurer plus de jouissances matérielles, pour faire honneur à ses affaires.
Le régime moderne a créé, on peut le dire, un type d’être spécial que l’on serait tenté d’appeler le contribuable ; car, en réalité, si on demandait à beaucoup d’hommes de ce temps pourquoi ils sont sur la terre, ils seraient bien embarrassés de répondre et finiraient par vous dire :
– Ma foi, pour faire notre service militaire, pour acquitter nos contributions et pour payer notre terme.
Le gendarme, le percepteur, le propriétaire sont, pour la plupart, la forme visible du Devoir et, dès qu’on est en règle avec eux, on a l’esprit en paix.
Aussi, remarquez-le, ces contributions le Français les paye avec une certaine joie ; il ne se sert pas du tout de ses droits de citoyen pour obtenir la diminution des impôts. Il en est de même du propriétaire : le Français est heureux quand il a rempli ses devoirs envers lui. Chez ce peuple, qu’on prétend livré à toutes les théories subversives, il n’y a pas d’exemple d’assassinat d’un propriétaire. Les insurgés de la Commune, maîtres absolus de Paris, ont tué de vénérables ecclésiastiques qui ne leur avaient fait aucun mal ; ils n’ont tué ni un des propriétaires implacables qui avaient augmenté sans pitié le loyer des pauvres ménages, ni un des huissiers qui avaient saisi jusqu’à la cendre des foyers.
Les Français sont admirablement dressés à toute cette organisation fiscale ; ils sont comme les méharis qui s’agenouillent pour qu’on puisse les charger plus facilement, ou comme les chevaux de renfort d’omnibus qui, leur besogne faite, vont tous seuls rejoindre leur place au bas de la montée et attendent là qu’on les attelle de nouveau.
Ces hommes si dociles à rendre à César ce qui est dû à César se regardent, en revanche, comme absolument affranchis de toute obligation envers Dieu.
Ce qui frappera plus tard l’observateur, quand il étudiera les générations présentes, c’est la facilité avec laquelle un peuple peut se passer de toute religion. Dans les départements qui entourent Paris, il y a des villages où les hommes ne mettent jamais les pieds à l’église. Je ne parle pas ici des hommes affichant des opinions anticléricales. En beaucoup d’endroits la période d’anticléricalisme militant est close. Les paysans et les ouvriers du pays saluent le curé parce que c’est un notable, mais ils n’éprouvent pas une seconde le besoin de penser à Dieu, d’élever leur cœur vers le Créateur, de s’unir par la prière à la Divinité. En dehors des dimanches, ils n’ont aucune notion des fêtes de l’Église et des événements qu’elles commémorent. C’est là tout un ordre de préoccupations radicalement aboli chez eux et, à leur point de vue, ils vivent très bien comme cela.
Quand, par hasard, ils entrent à l’église pour un mariage ou un service quelconque, ils s’y ennuient à avaler leur langue. Ce Sacrifice du Corps et du Sang de Notre Seigneur Jésus-Christ, sous les espèces du pain et du vin, ce drame si magnifiquement émouvant de la Messe, où chaque parole, chaque geste du prêtre a une signification si profonde, les laisse totalement indifférents ; ils ne le comprennent pas plus qu’ils ne comprendraient une cérémonie dans une pagode. Ils sont tout à fait revenus à l’état sauvage, très au-dessous, au point de vue du sentiment religieux, de ce qu’étaient nos pères au moment où le christianisme pénétra dans les Gaules ; pour les ramener, il faudrait les évangéliser à nouveau, il faudrait des apôtres comme saint Denis ou saint Éleuthère, qui aillent prêcher sur les chantiers ou dans les champs.
Ce sera, je le répète, un sujet de stupéfaction pour ceux qui écriront définitivement l’histoire de ce temps, que de voir avec quelle rapidité ce peuple, qui fut si croyant, qui resta si longtemps idéaliste, en est arrivé à être étranger à toute inquiétude sur l’âme, sur le mystère de la destinée, sur le Divin en un mot, à vivre de la vie seule des instincts, dans un matérialisme tranquille qui, chez beaucoup encore une fois, n’a plus rien d’agressif contre les ministres du culte.
Il en est de même, d’ailleurs, pour tout ce qui touche au domaine moral. Je n’ai pas l’intention de déclamer contre la corruption des mœurs, ce qui serait parfaitement inutile ; je veux noter simplement à quel degré sur ce point encore les opinions se sont modifiées en quelques années. Ceux qui appartiennent à ma génération seront incontestablement frappés de l’exactitude de ce constat.
Il y a vingt ans, les mots : un failli, un voleur, un condamné pour escroquerie étaient des mots-épouvantails ; une condamnation pour vol était la mort sociale pour un homme. Aujourd’hui ces termes n’ont plus qu’une importance très secondaire.
Sans doute, on s’écarte encore du voleur classique, couvert de haillons, armé d’un gros bâton, mais ce n’est pas parce qu’il est voleur, c’est parce qu’il est mal mis. Les voleurs habillés comme tout le monde sont les bienvenus partout.












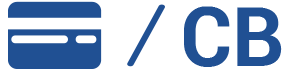
 et
et  !
!