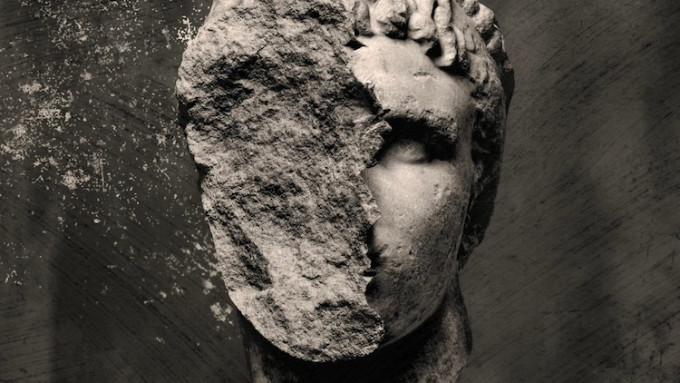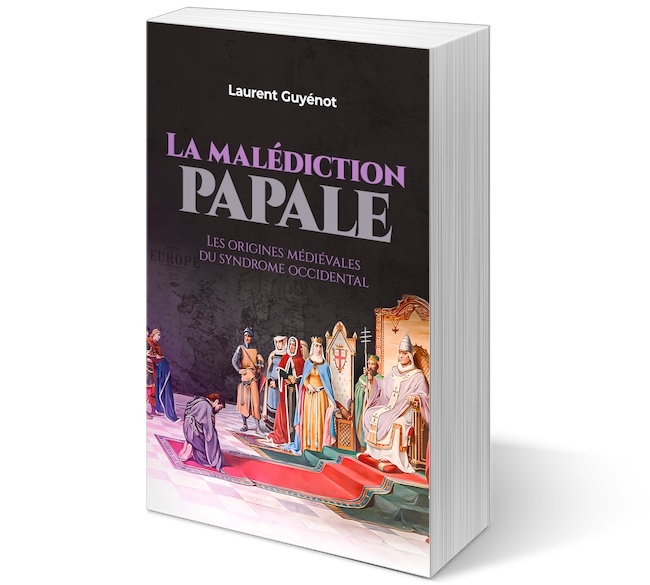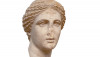Pourquoi sommes-nous chrétiens ? C’est une question historique : pourquoi et comment l’Europe s’est-elle christianisée ? La réponse courte à la question du « pourquoi » est : parce que Constantin et ses héritiers ont décidé que les Romains, puis les Barbares, devaient être chrétiens.
Dire que le christianisme a gagné grâce à une supériorité inhérente est une tautologie darwinienne. Comment savoir si le christianisme était supérieur, mis à part le fait qu’il a gagné ? Peut-être a-t-il gagné parce que les empereurs le jugeaient le mieux adapté au contrôle des masses. Peut-être que le christianisme a gagné simplement parce qu’il était la religion la plus intolérante, la plus meurtrière envers ses concurrents. Le fait qu’Élie ou Jéhu aient éradiqué le baalisme en massacrant tous les prêtres de Baal (1 Rois 18 et 2 Rois 10) prouve-t-il la supériorité du yahwisme sur le baalisme ? Seulement dans un sens darwinien.
Il est même possible que le christianisme ait gagné parce qu’il a été vendu aux Romains par les plus grands colporteurs religieux, les Juifs, comme le cheval de Troie de leur dieu dans la ville païenne. Si tel est le cas, alors le christianisme n’a pas gagné parce qu’il était le meilleur pour nous, mais parce qu’il était le pire.
Si le christianisme a été si manifestement meilleur pour les Romains, alors inversons la question : pourquoi ont-ils résisté si farouchement à leur christianisation ? Malgré l’édit de Thessalonique promulgué par Théodose le Grand en 380, qui interdisait toutes les religions à l’exception du christianisme nicéen (et du judaïsme), son petit-fils Théodose II déplorait 58 ans plus tard, un siècle après la mort de Constantin, que tant de personnes résistaient encore au baptême, peu convaincues que ce vaccin spirituel était pour leur bien : « Les mille terreurs des lois qui ont été promulguées et la menace de l’exil ne les retiennent pas ! » [1] La christianisation des villes romaines (la campagne est une autre affaire) ne fut achevée que sous Justinien (527-565), soit à l’issue de deux siècles de violente coercition.
Interdiction des sacrifices et définancement des cultes païens
Par l’édit de Milan (313), sous prétexte de tolérance religieuse, Constantin le Grand introduisit l’intolérance religieuse dans l’Empire romain, en légalisant puis en parrainant la religion la plus radicalement intolérante. L’historien ecclésiastique Sozomen écrit (Histoire ecclésiastique, II, 5) :
« Il semblait nécessaire à l’empereur [Constantin] d’enseigner aux gouverneurs à supprimer leurs rites de culte superstitieux. Il pensait que cela serait facile à accomplir s’il pouvait leur faire mépriser leurs temples et les images qu’ils contenaient. Pour mener à bien ce projet, il n’eut pas besoin d’aide militaire, car des chrétiens attachés au palais allèrent de ville en ville avec des lettres impériales. Les gens du peuple furent incités à rester passif par la crainte que, s’ils résistaient à ces édits, eux-mêmes, leurs enfants et leurs femmes seraient exposés au mal. »
Outre le pillage arbitraire des temples qui commença en 331, et qui « enrichit considérablement le trésor impérial de métaux précieux » (Ramsay MacMullen) [2], deux mesures légales furent particulièrement préjudiciables aux pratiques religieuses non chrétiennes : l’interdiction des sacrifices d’animaux et la suppression du financement des cultes publics. Elles ont commencé sous les trois fils de Constantin, mais ont pris une tournure plus sévère après la brève « restauration païenne » de son neveu Julien (361-363), soit sous Valentinien, son frère et ses deux fils (364-392), puis sous son gendre Théodose et ses héritiers (379-457).
Constantin avait interdit que le clergé chrétien soit « contraint » de « célébrer » des sacrifices lors de cérémonies publiques. Sous ses fils, plusieurs édits interdirent totalement les sacrifices d’animaux [3]. Il s’agissait là d’un coup porté au mode de vie romain. Les chrétiens ont souvent condamné les sacrifices d’animaux comme étant cruels, primitifs et, bien sûr, sataniques. Mais il est important de comprendre que, dans le monde antique, ôter la vie d’un animal n’était jamais une question purement laïque. Charles Freeman écrit à propos des Grecs :
« Le sacrifice était au cœur de presque tous les rituels. Un animal, un bœuf, un mouton, une chèvre ou un cochon, était présenté aux dieux, puis tué, brûlé et mangé par la communauté. Les sacrifices n’étaient pas une activité aberrante ou cruelle, mais une manière sophistiquée de faire face à la nécessité de tuer des animaux pour se nourrir. En fait, les rituels entourant le sacrifice suggèrent que les Grecs éprouvaient un certain malaise à tuer des animaux qu’ils avaient eux-mêmes élevés. On créait ainsi l’illusion qu’un animal allait volontairement à la mort et, avant qu’il ne soit tué, tous les participants lui jetaient une poignée d’orge, comme si la communauté tout entière acceptait la responsabilité de sa mort. » [4]
Il va sans dire que les sacrifices d’animaux n’étaient pas des démonstrations de spiritualité ascétique. À l’époque romaine, ils étaient souvent des démonstrations ostentatoires de richesse et de prodigalité, car l’offrande d’animaux apportait prestige et popularité. Les philosophes les trouvaient répugnants. Mais l’« idée » du sacrifice n’était pas en soi un signe de cruauté ou de matérialisme. C’était un principe fondamental et universel de la vie civilisée. Tout banquet, toute fête, toute occasion de partager un repas à base de viande impliquait une invocation rituelle aux dieux, de sorte que l’interdiction des sacrifices d’animaux était une atteinte directe au tissu social.
La vie religieuse publique comprenait des temples, des prêtres, des fêtes, des sacrifices et des œuvres charitables permettant de nourrir et divertir le peuple. L’État romain était autrefois le principal sponsor des grands cultes, car depuis Octave Auguste, explique Michael Gaddis, « les empereurs considéraient que leur devoir premier était de préserver la pax deorum, l’ancien accord selon lequel les dieux assuraient la paix, la sécurité et la prospérité de l’humanité en échange d’un culte et de sacrifices appropriés » [5]. C’est pourquoi l’empereur était le pontifex maximus, le prêtre en chef, qui supervisait tous les cultes religieux. Mais le dieu chrétien est un dieu jaloux, et sous Gratien (367-384) et Théodose (379-395), l’État se désengagea entièrement des cultes païens, leur retirant tout financement public avant de les interdire purement et simplement [6]. Un rescrit d’Honorius, fils de Théodose, envoyé à Carthage en 415, ordonne que « conformément à la constitution du saint Gratien [...] toutes les terres attribuées par la fausse doctrine des anciens à leurs rituels sacrés soient rattachées à la propriété de notre trésor privé », le décret s’appliquant « à toutes les régions situées dans notre monde » [7]. Les dons privés pouvaient compenser dans une certaine mesure la suppression des fonds publics. Les riches avaient toujours financé la construction et la réparation des temples ainsi que d’autres travaux publics. Cependant, il était entendu que le soutien de l’État était indispensable à l’efficacité des cultes publics, à Rome comme dans d’autres villes.
Discrimination et opportunisme
L’aristocratie sénatoriale a joué « un rôle central dans la christianisation de l’Empire », explique Michele Salzman dans The Making of a Christian Aristocracy, d’autant plus que « les Romains n’avaient jamais séparé le profane du sacré. Pendant des siècles, les mêmes hommes qui occupaient les plus hautes fonctions de l’État détenaient également les plus importantes fonctions sacerdotales dans les cultes d’État ». Le christianisme n’avait que peu d’attrait pour cette classe, malgré des accommodements tels que la transformation de la nobilitas en vertu chrétienne par Jérôme. Mais l’ancienne aristocratie romaine (36 000 personnes environ selon l’estimation de Salzman), bien qu’immensément riche, avait perdu une grande partie de son pouvoir politique à la fin du IIIe siècle au profit des equites (chevaliers), de la noblesse provinciale, des militaires et des bureaucrates de carrière [8] Toutes ces personnes se disputaient les nominations impériales et étaient très sensibles à la discrimination religieuse. « Au moment même où la dynastie constantinienne proclamait sa nouvelle allégeance religieuse, écrit Peter Heather, les propriétaires terriens de l’Empire faisaient la queue pour obtenir des postes dans une bureaucratie impériale en pleine expansion. » Par conséquent, « les structures du système impérial, et en particulier la manière précise dont elles façonnaient la concurrence entre les membres de l’élite propriétaire terrienne, ont joué un rôle crucial dans le processus [de conversion] ».
« La grande majorité estimait qu’elle n’avait d’autre choix que de se conformer d’une manière ou d’une autre au nouveau culte impérial qui balayait l’Empire au IVe siècle. L’empereur était prêt à tolérer une dissidence soigneusement modérée, mais même cela risquait de permettre à un concurrent converti bien connecté d’utiliser les rouages de la vie publique pour vous nuire. À moins d’être prêt à s’opposer ouvertement, comme l’ont fait certaines minorités, il fallait alors trouver un compromis, qu’il soit réel, faux ou entre les deux. La rapidité avec laquelle beaucoup se sont convertis est en soi une indication forte que, pour beaucoup, il ne s’agissait pas de convictions religieuses profondes. » [9]
Les années 360, sous Gratien, ont marqué un tournant dans la discrimination à l’égard des non-chrétiens dans la fonction publique, et en 408 l’empereur d’Occident Honorius a décrété que les non-chrétiens ne pouvaient plus servir dans l’administration impériale.
Même les évêchés étaient convoités par les opportunistes, car les évêques étaient « rapidement assimilés à des fonctionnaires civils dans le mandarinat qui administrait l’empire. Leurs églises n’étaient plus des conventicules obscurs, mais des édifices publics de plus en plus somptueux » [10].
Pegasios, évêque d’Ilios (l’ancienne Troie) dans les années 350 et au début des années 360, en est un exemple typique. Il est mentionné dans une lettre écrite par l’empereur Julien (361-363). Peter Heather résume :
« En 362/3, Pegasios, évêque chrétien de sa ville natale, posa sa candidature à un poste dans le nouveau sacerdoce païen que Julien, désormais ouvertement non chrétien, venait de créer. L’empereur écrivit une lettre à ses fonctionnaires à Constantinople pour leur assurer que Pegasios était un candidat approprié pour le poste de prêtre païen. Pegasios avait la réputation d’être un évêque chrétien qui avait détruit des temples païens, ce qui incitait les fonctionnaires à rejeter sa candidature ; l’empereur écrivait pour dissiper leurs doutes. Julien et Pegasios s’étaient rencontrés pour la première fois près de dix ans auparavant [lorsque Julien avait visité Troie].
[…] À son arrivée, il avait été accueilli par l’évêque Pegasios, qu’il ne connaissait pas du tout, qui conduisit Julien dans un temple dédié au héros troyen Hector. Loin d’être détruits, Julien écrivit : “Je constatai que les autels étaient encore allumés, je dirais presque flamboyants, et que la statue d’Hector avait été ointe jusqu’à briller.” Il en fut de même dans un deuxième temple, dédié à Athéna, où Julien remarqua que, contrairement à la plupart des chrétiens, qui considéraient les dieux païens comme des démons, l’évêque Pegasios ne se signait pas et ne sifflait pas pour éloigner les mauvais esprits. “Puis, à la dernière étape de la visite, Pegasios m’accompagna au temple d’Achille et me montra la tombe en bon état, alors que j’avais été informé qu’elle avait également été détruite par lui. Mais il s’en approcha avec une grande révérence... et j’ai entendu dire... qu’il avait également l’habitude d’offrir des prières à Hélios [dans la théologie de Julien, le dieu suprême du soleil] et de l’adorer en secret.” » [11]
Il faut reconnaître que la plupart des évêques étaient des chrétiens fanatiques, qui encourageaient et appliquaient avec vigueur les lois anti-païennes. Mais Pegasios n’était certainement pas le seul haut fonctionnaire à être resté un païen de conviction derrière un christianisme de façade. De nombreux chrétiens romains de la classe supérieure se sont officiellement convertis, tout en conservant leur mode de vie et leurs intérêts païens. « La conversion, en d’autres termes, est un mot trompeusement simple. [...] La conversion au christianisme avait clairement des significations très différentes pour les Romains du IVe siècle. » [12]
Persécution et criminalisation
Après Julien « l’apostat », Valentinien et Valens (364-378) ont intensifié la répression contre les cultes non chrétiens, souvent assimilés à de la sorcellerie. Les intellectuels (philosophes) étaient particulièrement visés. L’historien païen Zosime a écrit dans sa Nouvelle Histoire IV, 14-15, à propos de la partie orientale de l’Empire :
« L’empereur […] soupçonnait tous les philosophes les plus célèbres et autres personnes instruites, ainsi que certains des courtisans les plus distingués, qui étaient accusés de conspiration contre leur souverain. Cela remplit tous les lieux de lamentations ; les prisons étaient pleines de personnes qui ne méritaient pas un tel traitement, et les routes étaient plus encombrées que les villes. […] Toutes les personnes accusées étaient soit mises à mort sans preuve légale, soit condamnées à une amende sous forme de confiscation de leurs biens ; leurs femmes, leurs enfants et les autres personnes à leur charge étaient réduits à l’extrême indigence. […]
Une confusion universelle fut provoquée par ces événements, qui se généralisaient à un tel point que les délateurs, accompagnés de la populace, pénétraient sans retenue dans la maison de n’importe qui, la pillaient de tout ce qu’ils pouvaient trouver et livraient le malheureux propriétaire à ceux qui étaient désignés comme bourreaux, sans leur permettre de se défendre.
Le chef de ces misérables était un homme nommé Festus, que l’empereur, connaissant son expertise dans toutes les formes de cruauté, envoya en Asie comme proconsul, afin qu’aucun érudit ne reste en vie et que son dessein soit accompli. Festus, ne laissant aucun endroit inexploré, tua tous ceux qu’il trouva sans forme de procès et contraignit les autres à fuir leur pays. »
Valens et Valentinien purgèrent l’administration de tous les païens et lancèrent une sévère persécution contre les philosophes non chrétiens, qui furent « presque tous exterminés », à la satisfaction de l’historien chrétien Sozomen (Histoire ecclésiastique, VI, 35). Cette persécution s’intensifia sous Théodose (379-395) :
« Car lorsque l’empereur vit que les habitudes du passé attiraient encore ses sujets vers les cultes de leurs ancêtres et vers les lieux qu’ils vénéraient, il leur interdit d’y entrer au début de son règne [379] et finit par détruire nombre d’entre eux. N’ayant plus de lieux de prière, ils s’habituèrent au fil du temps à fréquenter les églises, car il n’était pas sans danger d’offrir des sacrifices païens, même en secret, puisqu’une loi avait été promulguée qui punissait de mort et de la confiscation de leurs biens ceux qui osaient le faire. » (Sozomène, Histoire ecclésiastique, VII, 20) [13]
L’historien païen Ammien Marcellin raconte une purge à grande échelle à Antioche, visant les intellectuels de la ville, qui vivaient en permanence « avec une épée suspendue au-dessus de leur tête » :
« Les chevalets étaient dressés, et des poids de plomb, des cordes et des fouets étaient prêts. L’air était rempli des cris effroyables de voix sauvages mêlés au cliquetis des chaînes, tandis que les bourreaux, dans l’exécution de leur sinistre tâche, criaient : “Tenez, liez, serrez, encore plus fort.” » (L’Empire romain tardif, XXIX, 23) [14]
L’année 391 fut marquée par la destruction du Serapeum (temple de Sérapis) à Alexandrie. Ce fut « un événement capital », selon Edward Watts (The Final Pagan Generation),
« […] seulement surpassé peut-être par le sac de Rome par les Goths en 410, en termes de l’attention qu’il a suscitée dans les sources contemporaines. De la même manière que le sac de Rome a choqué un empire peu habitué à remettre en question sa supériorité militaire, la disparition du temple de Sérapis à Alexandrie a mis en évidence la vulnérabilité des grands centres de la religion traditionnelle qui semblaient autrefois faire partie intégrante de la vie romaine. » [15]
Lorsque, en 392, l’empereur d’Occident Valentinien II fut retrouvé pendu dans sa résidence de Vienne, en Gaule, un groupe de païens, mené par le préfet de Rome et un général franc, proclama un certain Eugène empereur d’Occident. Théodose, beau-frère de Valentinien, réagit le 8 novembre 392 par une interdiction universelle et complète de toute forme de culte païen, y compris les offrandes d’encens, de vin et même les guirlandes suspendues aux arbres, menaçant les contrevenants de confiscation de leurs biens. Il était même interdit d’honorer les dieux domestiques et les lares en privé. La police impériale pouvait fouiller et saisir les biens des contrevenants. « Que personne n’entre dans les temples, ne regarde les temples, ni ne lève les yeux vers des images façonnées par des mains mortelles, de peur d’être coupable d’un péché divin et humain. » (Code Théodosien, Livre 16, X, 10-11). Selon l’historien païen Zosime, sous Théodose, « les temples des dieux étaient violés partout, et il n’était pas sûr pour quiconque de professer la croyance en l’existence des dieux, et encore moins de lever les yeux vers le ciel et de les adorer » (Nouvelle Histoire, IV, 33). Les forces païennes furent vaincues lors de la bataille du Frigidus en septembre 394, suivie d’une épuration à grande échelle.
Théodose mourut en 395. Sous ses fils Honorius et Arcadius, de nombreux temples furent détruits : le temple d’Artémis à Éphèse, l’une des sept merveilles du monde, fut rasé en 401. À partir de 407, des lois furent adoptées ordonnant la destruction systématique des temples et des sanctuaires situés sur les domaines impériaux. La censure se renforça, au grand soulagement d’Augustin lui-même, qui mentionne qu’après avoir publié ses trois premiers livres, il entendit dire que certains avaient rédigé une réponse…
« … mais qu’ils attendaient le moment propice pour la publier sans danger. […] C’est pourquoi, quiconque se croit heureux parce qu’il a le droit d’injurier, serait bien plus heureux s’il n’avait pas ce droit. » (La Cité de Dieu, livre V, chapitre 26)
En 435, les propriétaires fonciers privés ont reçu l’ordre d’effacer toute trace de paganisme sur leurs terres. Les évêques pouvaient compter sur la participation active de moines fanatiques armés de barres de fer et de pierres, qui « prenaient en main l’application de diverses lois impériales contre les sacrifices païens » (Michael Gaddis) [16]. Ils croyaient que des démons habitaient les statues des divinités, qu’il fallait exorciser en leur crevant les yeux et/ou en marquant leur front d’une croix. Cette violence divine est parfois présentée comme miraculeuse : la Vie de saint Porphyre, évêque de Gaza de 395 à 420, raconte que lorsqu’un groupe de chrétiens portant une croix passa devant une statue d’Aphrodite, « le démon qui habitait la statue, voyant et ne pouvant supporter la vue du signe qui était porté, sortit du marbre dans une grande confusion, renversa la statue et la brisa en plusieurs morceaux » (Vita Porphyrii §61).
Torture et crucifixion
Peter Heather décrit la christianisation et la dépaganisation de l’Empire romain comme l’œuvre d’une minorité d’activistes extrêmement organisés et déterminés, comparables au « modèle d’État à parti unique qui fonctionnait dans l’ancien bloc soviétique » :
« Quelques individus courageux ont toujours résisté aux pressions systémiques visant à les conformer, mais la grande majorité, si elle avait la chance d’avoir le choix, choisissait toujours de rejoindre le parti, car c’était la seule voie possible vers la meilleure vie quotidienne possible pour les moins ambitieux, et surtout pour ceux qui recherchaient la gloire et la fortune. » [17]
À la fin du Ve siècle, peut-être la moitié de la population romaine avait renoncé au paganisme, sous la menace, explique Ramsay MacMullen : « des amendes, des confiscations, de l’exil, de l’emprisonnement, de la flagellation, de la torture, de la décapitation et de la crucifixion » [18].
La pression s’intensifia sous Justinien (527-565) : « Il y eut une grande persécution des païens, et beaucoup perdirent tous leurs biens », écrit le chroniqueur byzantin Jean Malalas. « Une grande terreur s’est emparée de la population […] [avec] un délai de trois mois pour se convertir. » (Chronique, 18) En Anatolie, écrit l’historien Procope, des troupes ont été envoyées pour éradiquer toute trace de paganisme et « contraindre les personnes rencontrées à renoncer à la foi de leurs ancêtres », ce qui a poussé certaines à résister, à s’exiler ou à se suicider ; « et ceux d’entre eux qui avaient décidé de prendre simplement le nom de chrétien pour échapper à leur situation actuelle, furent pour la plupart rapidement arrêtés lors de leurs libations, sacrifices et autres actes impies » (Histoire secrète, XI, 21-23). Sous Tibère II (578-582), en Phénicie, le commandant Théophile « en saisit un grand nombre et les punit selon leur impudence, humilient leur orgueil, les crucifient et les tuent ». Convoqué à Édesse, le grand prêtre d’Antioche se suicida, tandis que ses associés furent torturés pour dénoncer comme leur compagnon d’adoration le vice-préfet Anatolius, qui fut conduit à Constantinople vers 579, torturé et crucifié, selon Jean d’Éphèse (Histoire ecclésiastique III, 27-32). Sous le règne suivant, celui de Maurice (582-602), les païens furent traduits en justice dans toutes les régions et toutes les villes, selon la Chronique de Michel le Syrien. À Carrhae-Harran, l’évêque reçut l’ordre de l’empereur d’instituer une persécution. « Il réussit à convertir certains au christianisme, tandis que beaucoup de ceux qui résistèrent furent découpés et leurs membres suspendus dans la rue principale de la ville. » (Michel le Syrien, Chronique) [19] Quelque trente ans plus tard, l’empire était certes massivement converti, mais tombait par pans entiers sous le contrôles des musulmans.
Pour conclure : l’histoire est un lieu de débat, et l’on peut certes discuter de l’ampleur de la violence qui a été nécessaire pendant deux siècles pour imposer le christianisme aux populations vivant sous l’Empire romain – et donc leur interdire le paganisme. Mais on ne peut nier cette violence. A-t-elle été pour le bien de ces mêmes populations ? C’est une autre question, mais je suggère que la fin et les moyens ne sont jamais indépendants, et que le christianisme contient la violence par laquelle il s’est imposé. C’est pourquoi, une fois le paganisme éradiqué, sa violence ne se tarit pas mais se prolongea en interminables guerres intestines entre l’orthodoxie impériale et une multitudes d’« hérésies ».
*
Bibliographie essentielle
Ramsay MacMullen, Christianizing the Roman Empire (A.D. 100-400), Yale UP, 1984. MacMullen est universellement reconnu comme un pionnier dans l’étude révisionniste de la christianisation de l’Empire romain au cours des deux siècles qui ont suivi Constantin jusqu’à Justinien, documentant sa violence. Il communique ses connaissances exceptionnelles sur le sujet sous une forme narrative très accessible. Je recommande également ses ouvrages Paganism in the Roman Empire, Yale UP, 1981, et Christianity and Paganism in the Fourth to Eighth Centuries, Yale UP, 1997.
Alan Cameron, The Last Pagans of Rome, Oxford University Press, 2011. Cet ouvrage de 878 pages remet en question la perspective ouverte par MacMullen sur la résistance de l’aristocratie romaine. Bien que ses contre-arguments détaillés soient les bienvenus, son exégèse critique des sources païennes semble souvent arbitraire et peu concluante.
Peter Heather, Christendom : The Triumph of a Religion, Penguin, 2023. La présentation la plus récente et, à mon avis, la meilleure de la christianisation de l’empire. Le tableau d’ensemble brossé par Heather est cohérent avec celui de MacMullen, mais bénéficie des dernières recherches (y compris celles de Cameron). Je trouve ses réflexions sur la sociologie et la politique de la conversion très convaincantes. Si vous ne devez lire qu’un seul livre, je vous recommande celui-ci.
Richard Fletcher, The Conversion of Europe : From Paganism to Christianity 371-1386 AD, Fontana Press, 1998. Cet ouvrage se concentre sur la conversion des Barbares à partir de 371, mais apporte également des éclairages sur la christianisation des Romains et la romanisation du christianisme au cours de ce processus. Il est plutôt conservateur dans son évaluation positive du christianisme et du « processus d’acceptation du christianisme ».
Michele R. Salzman, The Making of a Christian Aristocracy : Social and Religious Change in the Western Roman Empire, Harvard University Press, 2009. Cet ouvrage apporte quelques éclaircissements sur le statut, la structure et la mentalité de l’aristocratie romaine. Tout en acceptant le consensus général selon lequel la pression impériale a été le facteur dominant de sa conversion, l’auteur souligne la manière dont les intérêts de classe ont été négociés au cours de ce processus.
Michael Gaddis, There Is No Crime for Those Who Have Christ : Religious Violence in the Christian Roman Empire, University of California Press, 2005. Une ressource utile sur la violence chrétienne à l’égard des païens, bien que manquant de cohérence et de perspective claire.
Catherine Nixey, The Darkening Age : The Christian Destruction of the Classical World, Pan Books, 2017. Un bon livre et un best-seller sur le sujet, mais avec un fort parti pris contre le christianisme et un ton passionné qui nuit souvent à l’objectivité scientifique.












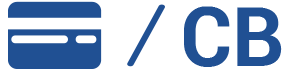
 et
et  !
!