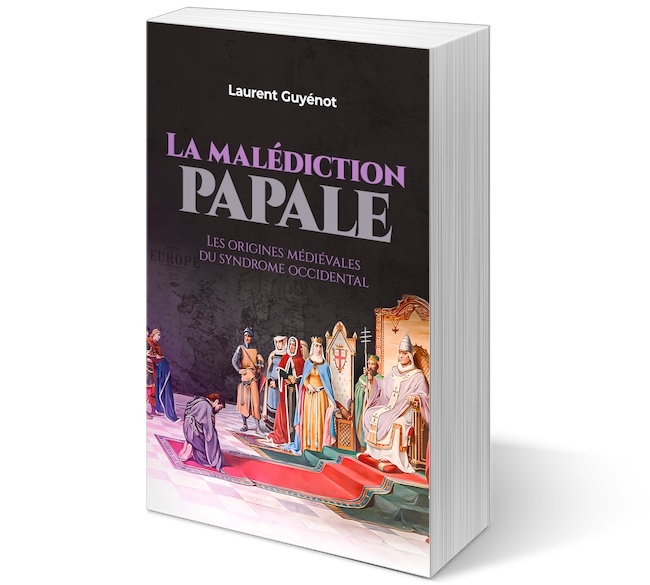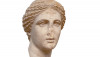« La France fille aînée de l’Église. » L’expression est récente. On n’en connaît pas d’attestation certaine avant le Discours sur la vocation de la nation française prononcé à Notre-Dame de Paris par le père dominicain Henri-Dominique Lacordaire, le 14 février 1841. L’idée, en revanche, est plus ancienne, et exprime une réalité qui l’est aussi : la monarchie française est liée à l’Église de Rome par une alliance particulière, qui résista à la Réforme et perdura jusqu’à la Révolution.
Sur la base de L’Histoire des rois francs de Grégoire de Tours (Livre II, chapitre 1), achevée en 591, le roman national fait remonter cette alliance au baptême de Clovis. Grégoire nous conte que sa femme Clotilde (bizarrement catholique, bien que burgonde), l’enjoignait à croire au Fils de Dieu, mais « il se contentait de lui répondre que ses dieux étaient plus puissants ». Néanmoins, en dernière ressource durant une bataille contre les Alamans, il pria Jésus-Christ : « Si tu daignes m’accorder la victoire sur ces ennemis, […] je croirai en Toi, et je me ferai baptiser en Ton nom. » Aussitôt, les Alamans prirent la fuite. Les historiens placent cet épisode (bataille de Tolbiac) en 496 ou 506. Le récit est une illustration classique de ce qu’on nomme la « théologie de la victoire », qui transforme le Crucifié en dieu guerrier : c’est le schéma de tous les récits de conversion de rois barbares, jusqu’au VIIe siècle (par exemple, la conversion du roi saxon de Northumbrie Edwin en 627 racontée par Bède le Vénérable). Clotilde fit venir l’évêque Remi de Reims, un saint homme réputé avoir ressuscité un mort. Instruit dans la bonne foi, celle de l’empereur du moment et non celle qu’avaient adopté les Goths lorsqu’elle était l’orthodoxie impériale, le roi « confessa qu’il reconnaissait un seul Dieu tout-puissant en trois personnes » et « fut baptisé au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ». Notons en passant que les « Allemands » sont ainsi nommés en français – plutôt que « Germains », comme l’aurait voulu la traditions latine – en souvenir de cette victoire de Clovis contre les Alamans, une confédération germanique d’importance très relative, comparés aux autres Germains nommés Goths, Burgondes, Vandales et Suèves ou Souabes. C’est dire que, depuis ce fondement légendaire, l’identité française se construit avec Rome, contre l’Allemagne.
Pour être précis, ce n’est pas la France (qui n’existe pas encore), mais le roi des Francs qui est présenté dans les sources anciennes comme l’oint de Dieu. Et ce, en dépit de ses nombreux péchés, nous indique Grégoire dans ce passage empreint d’humour noir :
« Un jour, ayant rassemblé ses fidèles, on rapporte qu’il leur dit, en parlant de sa famille qu’il avait lui-même fait périr : "Que je suis malheureux ! Me voilà réduit à l’état d’un voyageur au milieu d’une nation étrangère ; je n’ai pas un seul parent dont, en cas de malheur, je puisse attendre ses secours." Ce n’était pas qu’il fût fâché de la mort de ses parents, mais il parlait ainsi par ruse, pour engager ceux qui l’écoutaient à lui découvrir quelque parent dont il eût ignoré l’existence, afin de le faire tuer. »
Plus que le texte de Grégoire, ambigu sur les véritables raisons de l’ascension de Clovis, c’est le récit du sacre miraculeux de Clovis par Hincmar de Reims (vers 870, soit sous les Carolingiens) qui constitue la légende fondatrice de cette « religion de Reims » qui enveloppe la royauté franque, puis française, d’une sacralité unique dans toute l’Europe. Chez Hincmar, saint Remi est « le nouveau Moïse » tenant à Clovis « le langage de l’ancien Moïse à l’Ancien Peuple de Dieu » :
« Apprenez, mon fils, que le royaume des Francs est prédestiné par Dieu à la défense de l’Église Romaine qui est la seule véritable Église du Christ. Ce royaume sera un jour grand entre tous les royaumes. Il embrassera toutes les limites de l’Empire Romain. Il soumettra tous les peuples à son sceptre. Il durera jusqu’à la fin des temps. Il sera victorieux et prospère tant qu’il sera fidèle à la foi romaine. Mais il sera rudement châtié toutes les fois qu’il sera infidèle à sa vocation. »
Ce qui est formulée ici est une théologie politique puisée dans le Deutéronome et les Livres des Rois, qui assujettit le pouvoir royal au pouvoir sacerdotal. L’onction du roi par l’huile sacrée de la sainte ampoule, le temps fort du rite de Reims, est une adaptation de l’onction de David par le prophète Samuel, qui fit descendre sur le jeune roi « l’esprit de Yahvé » (1Samuel 16,13).
L’équation symbolique entre la France et Israël est encore renforcée par Raban Maur, archevêque de Mayence et contemporain d’Hincmar, qui fait ajouter à saint Remi qu’à la fin des temps, un dernier descendant des rois francs « ira à Jérusalem, sur le mont des Oliviers, déposer sa couronne et son sceptre, et c’est ainsi que finira le Saint Empire romain et chrétien ». Ainsi est préfigurée une sorte de jumelage sacré de Paris et Jérusalem, qui se matérialisera au XIe siècle dans la croisade, initialement prêchée en 1095 par un pape français sur le sol français. C’est à juste titre que la chronique de la première croisade de Guibert de Nogent s’intitule Dei gesta per Francos, « Dieu agit par les Francs » ; les croisés sont en effet avant tout des « Francs », et la langue des États latins du Levant est le français. Parmi les nombreuses versions du sermon d’Urbain II à Clermont, signalons celle de Baudri de Bourgueil :
« Vous qui partez, nous prierons pour vous. [...] Notre devoir est de prier, le vôtre est de combattre les Amalécites. Avec Moïse, nous tendrons sans relâche nos mains vers le ciel pour prier, tandis que vous partirez brandir l’épée, tels des guerriers intrépides, contre Amalek. » [1]
La référence à Amalek, le peuple maudit par Yahvé, dont l’extermination, hommes, femmes et enfants, est présenté comme un devoir si sacré que Saül perdra la royauté pour avoir épargné un seul homme (1Samuel 15), n’est pas nouvelle : Charlemagne y fait allusion dans sa lettre à Léon III (vers 795), se comparant à Josué luttant contre les Amalékites tandis que : « À vous, très saint Père, il appartient, élevant les mains vers Dieu avec Moïse, d’aider par vos prières au succès de nos armes. » (référence à Exode 17:11)
C’est donc une caractéristique remarquable de l’alliance entre la royauté française et la papauté d’être empreinte d’une idéologie vétérotestamentaire, et même d’avoir fortement contribué à renforcer l’importance de l’Ancien Testament dans la catholicité. Il est incontestable que l’esprit de Yahvé, et non celui du Christ, anime la croisade, une entreprise française qui marqua très profondément l’identité nationale. On peut même dire que la France est véritablement née de la croisade, puisque c’est sous la bannière papale que l’Occitanie sera finalement annexée au royaume de France (croisade contre les Albigeois, 1209-1229).
On s’est indigné qu’Éric Zemmour ait intitulé un chapitre de son livre Destin Français (2018) : « Saint Louis, le roi juif ». Mais ce n’est pas sans fondement, tant Louis IX fut obsédé par Jérusalem, qu’il tenta en vain de rejoindre par deux croisades (1248 et 1270), et dont il murmura le nom en expirant à Tunis : « Jérusalem, Jérusalem ! » En 1239, le pape Grégoire IX s’était adressé au roi en ces termes (bulle Dei Filius) :
« Comme autrefois [Dieu] préféra la tribu de Juda à celles des autres fils de Jacob et comme Il la gratifia de bénédictions spéciales, ainsi Il choisit la France, de préférence à toutes les autres nations de la terre, pour la protection de la foi catholique et pour la défense de la liberté religieuse. Pour ce motif, la France est le royaume de Dieu même, les ennemis de la France sont les ennemis du Christ. »
L’écrivain Camille Pascal a tiré de ce texte le titre de son livre, Ainsi Dieu choisit la France. La véritable histoire de la fille aînée de l’Église (2016), dans lequel il se plaît à « renouer avec les joies simples des livres d’images » [2]. Mais il convient de souligner que, lorsque le pape flattait ainsi le roi de France, c’était pour le convaincre de déclarer la guerre à son ennemi, l’empereur Frédéric II Hohenstaufen, « ce roi de pestilence » qui, selon Grégoire IX, « affirme ouvertement que l’homme ne doit croire que ce qui peut être démontré par l’expérience et la raison » [3]. Saint Louis refusa néanmoins de mettre ses troupes au service de la vengeance du pape. C’est donc son frère Charles d’Anjou qui se chargera d’exterminer, sous la bannière papale, la dynastie Hohenstaufen, avec l’ambition d’obtenir du pape la couronne impériale.
La papauté comptait alors sur le royaume de France pour affaiblir l’Empire, dont elle convoitait l’héritage et l’autorité. À la fin du XIIIe siècle, l’Église forme un État tentaculaire international, possédant une bureaucratie sans équivalent, des revenus fonciers immenses et défiscalisés (en plus de la dîme instituée sous Charlemagne), et capable d’imposer ses dictats à tous les princes d’Occident.
Au début du XIVe siècle, les rois de France s’inquiètent de cette puissance et remettent en question leur loyauté filiale envers le Vatican. Menacé d’excommunication pour harcèlement fiscal sur les biens fonciers de l’Église, Philippe le Bel malmène Boniface VIII (attentat d’Anagni, 1303) et installe la papauté à Avignon, qui devient ainsi l’instrument de la diplomatie française. On notera en passant, comme l’indice d’un de ces règlements de compte dont se charge parfois l’histoire, que Guillaume de Nogaret, « l’âme damnée » de Philippe le Bel, qui brutalisa le pape et plus tard orchestra le procès des Templiers, était le petit-fils d’un cathare brûlé par l’Inquisition. (Et comme autre ricochet karmique, on connaît, bien sûr, la rumeur de la vengeance des Templiers contre le Capétien en 1791.)
Lorsque, deux siècles plus tard, le très catholique Charles Quint se voit confier le Saint-Empire (1520- 1558), portant avec lui tous les espoirs de la papauté contre le schisme protestant, François Ier n’hésite pas à s’allier au sultan contre l’empereur. Car quels que soient devenus les intérêts de l’Église, la France conservera comme principe premier de sa politique étrangère ce qu’elle a tout d’abord appris de la papauté : « Tenir sous main les affaires d’Allemagne en aussi grande difficulté qu’il se pourra », selon le mot d’Henri II (1547-1557).
C’est en application de ce principe qu’on vit la France s’allier aux protestants contre les Habsbourg catholiques sous Louis XIII, mais cette fois, selon Richelieu, c’était également « pour le bien de l’Église et la chrétienté », puisque catholique ou pas, le Saint-Empire reste le grand rival de l’ordre européen voulu par Rome. L’historien catholique français Jacques Bainville se félicitait de « cette conspiration des ennemis d’un pouvoir stable et fort en Allemagne », « chef-d’œuvre politique du XVIIe siècle français qui couronnait les peines et les labeurs de plusieurs générations et marquait l’apogée de la France », à l’issue de laquelle l’Allemagne fut « hachée en menus morceaux, disloquée, décomposée » [4].
On voit donc que l’alliance entre l’État français et Rome traverse des crises, mais persiste néanmoins dans l’intérêt commun des deux parties : les rois de France veulent une Église « gallicane », mais pas de rupture avec le pape comme cela fut le cas pour l’Église anglicane. Et en 1685, par la révocation de l’édit de Nantes, Louis XIV renonce au pluralisme religieux dans lequel son grand-père avait engagé le pays. C’est un grand moment de l’histoire de « la France fille aînée de l’Église », qui déclenche en fait, selon l’analyse d’Hugo Bruno, le « premier déclin français ».
Un siècle plus tard, la Révolution française est, dans une certaine mesure, le contre-coup de la révocation. La Révolution est en effet moins dirigée contre la royauté que contre son alliance exclusive avec la papauté, perçue, notamment par Robespierre, comme l’ingérence d’un pouvoir étranger et abusif. C’est donc à la fois par la Constitution civile du clergé (1790) et par le régicide (1793), que la France rompt définitivement avec son passé de « fille aînée de l’Église » et se convertit à « nos ancêtres les Gaulois ».
Le fantôme de cette alliance continue néanmoins de hanter nos consciences républicaines. Deux France idéales, deux romans nationaux s’accusent mutuellement dans une perpétuelle guerre civile des mémoires, soit une forme de « haine de soi » : d’un côté la France claironnante des droits de l’homme née en 1789, de l’autre la nostalgie de l’Ancien Régime adossé à l’Ancien Testament.
Cette compétition prend d’emblée la forme d’une rivalité mimétique, comme l’a bien vu Camille Pascal : « La République s’est enracinée, et a pu s’installer en France, parce qu’elle s’est glissée dans le discours messianique qui avait été construit par l’Église catholique pendant des siècles. » Des expressions comme « vocation universelle de la France » ou « France, terre des droits de l’homme » sont la traduction laïque de la mission divine de la France [5]. La France est désormais choisie pour éclairer le monde de la nouvelle trinité qui s’est révélée à elle : Liberté, Égalité, Fraternité. Dans un discours qu’il fait imprimer en avril 1791, Robespierre remercie « l’éternelle Providence » qui a appelé les Français, « seuls depuis l’origine du monde, à rétablir sur la terre l’empire de la Justice et de la Liberté » [6]. Ainsi, tout en renonçant à son héritage comme fille aînée de l’Église, la France a conservé son complexe de peuple élu – qu’elle aura par ailleurs transmis aux États-Unis d’Amérique, nés sous la bonne étoile des Lumières.
On comprend bien la rancune de l’Église d’avant Vatican II envers la République. Et l’on compatit éventuellement avec le pape Pie X, qui en réaction à la loi française de séparation de l’Église et de l’État (1905), fit cette célèbre prophétie :
« Fils de France qui gémissez sous la persécution, sachez-le, le peuple qui a fait alliance avec Dieu aux fonts baptismaux de Reims, se repentira et retournera à sa première vocation [...]. Les fautes ne resteront pas impunies, mais elle ne périra jamais, la Fille de tant de mérites, de tant de soupirs, de tant de larmes ! »
De cette période date l’ouvrage en trois tomes de Monseigneur Henri Delassus, La Conjuration antichrétienne (1910), où il est dit que :
« Tout le mouvement imprimé à la chrétienté par la Renaissance, la Réforme et la Révolution est un effort satanique pour arracher l’homme à l’ordre surnaturel établi par Dieu à l’origine et restauré par Notre-Seigneur Jésus-Christ au milieu des temps, et le confiner dans le naturalisme. » [7]
Un siècle plus tard, ce discours n’a pas changé chez les catholiques sédévacantistes (du latin sede vacante, « le siège [étant] vacant »), et Pierre Hillard voit encore « les trois grands R » (Renaissance, Réforme, Révolution) comme les bulldozers détruisant le monde issu de la Révélation – bulldozer judéo-maçonnique dans le troisième cas [8]. On aime aussi lire, dans ces chaumières traditionalistes, le pseudo-Marquis de la Franquerie (André Lesage de son vrai nom) :
« Dieu avait jeté Son dévolu sur notre pays et choisi notre peuple pour succéder au peuple juif et remplir, pendant l’ère chrétienne, la mission divine qui avait été assignée à ce dernier sous l’Ancien Testament. » [9]
Dans une telle perspective judéo-catholique, comment reprocher au pape François sa déclaration : « À l’intérieur de chaque chrétien se trouve un juif. » [10]












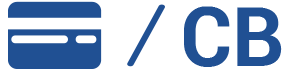
 et
et  !
!