« l’antiracisme médiatique est une stratégie de substitution de la gauche après l’abandon du socialisme théorique et concret »
Remarque d’E&R à l’usage des lecteurs : tous les thèmes abordés et défendus ici par Julien Landfried sont des copiés-collés des thèses théorisées et défendues par Alain Soral dés 2002, jusqu’à l’"Observatoire du communautarisme" lui-même, dont Alain Soral fut l’instigateur...
Contre le communautarisme, entretien de Julien Landfried, Utopie critique, n°42, 4ème trimestre 2007 (octobre), pages 39 à 45 Dans cet entretien à la revue Utopie critique, Julien Landfried (directeur de l’Observatoire du communautarisme) explicite la thèse de son essai "Contre le communautarisme" (Armand Colin, 2007) et le sens du passage d’une société politiquement organisée par la lutte de classes à une société organisée autour des minorités victimaires. Il se livre ici à une déconstruction critique de l’antiracisme médiatico-associatif et au rôle de substitution joué par l’immigrationnisme militant pour la gauche, suite au choix surplombant d’abandon des références socialistes traditionnelles.
Utopie critique : Pourquoi avoir écrit cet essai ?
Julien Landfried : Contre le communautarisme est un essai de défense critique de la philosophie républicaine et de la République comme système politique concret, face à un certain nombre d’offensives qui viennent de loin, mais qui ont pu réapparaître très clairement depuis quelques décennies et en particulier durant le second mandat de Jacques Chirac : lois mémorielles, minorités victimaires, réclamation de politiques de discrimination positive, tentative d’influer sur la politique française au Proche-orient, ethno-régionalismes. Il y a quatre ans, ne l’oublions pas, la Corse a failli sortir du cadre républicain de la loi égale pour tous !
Le livre s’appuie sur le travail de l’Observatoire du communautarisme créé en 2003, d’abord pour rappeler un certain nombre de principes, ensuite pour offrir une monographie de la situation du communautarisme en France, en définissant le plus clairement possible un certain nombre de termes, à commencer bien évidemment par celui de communautarisme.
Dans ce cadre, le livre ne parle pas de communautés, mais d’organisations communautaires qui prétendent parler au nom de leurs communautés et qui ont des stratégies politiques, intellectuelles, médiatiques, financières et autres vis-à-vis des responsables publics. Ce qui est important, à la différence d’un grand nombre de travaux en sciences sociales qui portent de manière très générale sur les communautés, c’est que je parle d’organisations communautaires, qui sont souvent des structures institutionnelles, associations, journaux, groupes de pression, qui ont une histoire dont on peut détailler les différents éléments, qui ont parfois des budgets, des membres, des structures que l’on connaît. Ces organisations communautaires engagées dans des revendications ethniques, religieuses, régionalistes, ou sexuelles, travaillent, en fait, à partir d’une même matrice intellectuelle et politique et ont des éléments de convergence tactique et, au bout du compte, participent selon moi à une mise en destruction de la République comme système politique concret.
Ce qu’analyse aussi mon essai, c’est le rôle des responsables politiques et des médias dans cette configuration, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de dynamique communautariste si des responsables politiques ne disent pas : « nous allons relayer ce que vous dites, nous allons vous financer, constituer telle ou telle structure dont vous ferez partie », ou encore s’il n’y a pas des médias qui, à un moment donné, disent : « vous qui prétendez parler au nom de telle catégorie, nous vous invitons et vous faisons parler parce que nous considérons que vous représentez effectivement la catégorie dont vous vous réclamez. Nous vous donnons en fait la légitimité de représenter la catégorie que vous prétendez représenter. » Il s’agit en réalité d’un dispositif complètement circulaire qui permet à des organisations communautaires d’être consacrées non par leur « communauté » mais pas les politiques et les médias.
Le livre tente aussi de montrer comment des groupes extrêmement minoritaires, y compris au sein des communautés qu’ils prétendent représenter -si tant est que la communauté existe- arrivent très rapidement à des positions de force dans l’espace institutionnel. Je multiplie les exemples : que ce soit le CRIF, le CRAN qui s’est constitué dans une certaine mesure sur le modèle du CRIF, les Indigènes de la République, etc. Le livre ne fait pas l’impasse sur le rôle des organisations communautaires juives dans la définition d’une matrice commune, politique, médiatique et sur comment les autres organisations sont prises à la fois dans un processus de concurrence jalouse, envieuse, et d’imitation vis-à-vis de ces organisations juives. Cela permet d’expliquer, en particulier, le fait que, alors que la plupart des organisations communautaires se construisent sur le modèle juif, un certain nombre des leaders de ces organisations sont animés d’une certaine forme d’antisémitisme. Le communautarisme juif constitue à la fois le modèle théorique et pratique des autres communautarismes, tout en concentrant sur lui haines et ressentiment précisément à cause de sa réussite indéniable.
Les valeurs attribuées à l’esprit des communautés en viennent-elles, plus qu’à s’opposer, à casser l’idée même de justice sociale ?
Julien Landfried : Si on analyse le rôle des médias, il faut voir comment une certaine presse de gauche, à partir des années 1970-80, a décidé que la nation comme nation politique était un problème, en tout cas une configuration politique qui n’avait pas sa préférence. D’autres modes d’organisations politiques, en particulier le multiculturalisme ou le multicommunautarisme politique étaient peu à peu devenues l’objet de leur désir politique. Par exemple, Libération, Le Nouvel Observateur, Politis, Le Monde Diplomatique dans un certain nombre de leurs textes, trahissent leur préférence idéologique cachée, en mettant en avant telle ou telle revendication communautariste. Quand Libération fait sa Une sur la « question noire » en France, le même jour que la première manifestation importante du CRAN, qui est pourtant très faible numériquement, c’est en réalité Libération qui en dit long sur ses préférences idéologiques !. Dans ce cadre-là, c’est la presse de gauche qui tient un rôle déterminant car auparavant c’était elle qui, en mettant la question sociale en tête de l’agenda politique, forçait les responsables politiques et médiatiques à se positionner par rapport à elle.
A partir du moment où un certain nombre de journaux décident que l’agenda politique doit être restructuré, la question sociale en fait est dégradée, elle est placée vers le bas de la file d’attente dans la hiérarchie des urgences. Le vrai problème de ces organisations communautaires, c’est l’impact qu’elles ont sur le monde politique, intellectuel ou médiatique : elles perturbent l’agenda politique. Des problèmes essentiels ont ainsi été déclassés par des questions mineures ou illégitimes.
Il suffit de voir comment les grandes organisations communautaires que j’étudie dans le livre sont faiblement représentatives des « communautés » au nom desquelles elles prétendent parler. Le CRAN doit avoir quelques dizaines de cotisants, quand il organise une manifestation, il y a 500 personnes ; les Indigènes de la République ne dépassent pas la trentaine de « polémistes ». Le CRIF qui se prétend représentatif de la « communauté juive de France » ne regroupe réellement que quelques milliers de personnes au mieux. Il y a donc un problème de représentativité, problème qui, par ailleurs, se pose dans toute démarche politique dans la République.
Dès lors, pourquoi critiquer spécifiquement les organisations communautaires ?
Julien Landfried : La question de la représentativité est au cœur des institutions de pouvoirs et de contre-pouvoirs. Si on prend le cas des syndicats, aucun d’entre eux ne peut se prétendre représentatif de tous les salariés. Si tel était le cas, aussitôt, quelqu’un le nierait en affirmant qu’il n’appartient pas à ce syndicat, que ce même syndicat peut compter 500 000 adhérents, mais qu’il y a 20 millions de salariés en France.
Avec le syndicalisme, quel qu’il soit, salarial ou patronal, il y a toujours des gens qui n’y adhèrent pas et ont le droit de le dire, alors qu’avec les organisations communautaires, le processus d’intimidation intellectuelle, qui est à la base du communautarisme, interdit toute contestation. L’intimidation consiste à affirmer que toute critique est l’expression d’une « phobie » et vous voilà « antisémite », « homophobe », « islamophobe », « raciste » ou autre, en butte aux procès ou aux menaces ! Ce qui empêche bien entendu toute constitution d’une forme de contre-pouvoir, en raison de son coût trop élevé (risques de campagne de calomnie et de déstabilisation, polémiques publiques, menaces de procès, etc.). Or, ce sont les contre-pouvoirs qui contribuent à remettre les institutions et les organisations à leur juste place. C’est là que réside la grande différence entre « corporatisme » et « communautarisme ». Le « corporatisme » fonctionne avec de puissants contre-pouvoirs, alors que le « communautarisme » les refuse, à cause de la mise en fonctionnement de ce processus d’intimidation intellectuelle et politique.
Vous montrez clairement dans votre livre que ces organisations communautaires en viennent à diviser la société en mettant en avant des intérêts particuliers.
Julien Landfried : Je ne dis pas que les organisations communautaires ont ces objectifs, je dis que les conséquences de leurs actions en arrivent là. Ce n’est pas tout à fait la même chose. Par exemple, le CRIF a pour objectif essentiel la poursuite de la défense des intérêts israéliens. Les organisations homosexuelles, aujourd’hui, ce qui n’était pas le cas il y a dix ans, ont comme objectifs principaux le mariage homosexuel et l’homoparentalité. Si on prend tel ou tel groupe musulman, ce sera de réclamer la réforme de la loi de 1905 en vue d’un financement public des lieux de culte. Il apparaît clairement que les objectifs de ces organisations communautaires ont pour effet de déclasser la question sociale.
Les organisations communautaires défendent l’idée d’une société fragmentée où le multiculturalisme est au moins hermétique aux autres, quand il n’est pas en concurrence d’ailleurs ?
Julien Landfried : Bien entendu, mais il faut aussi voir que ces cultures fragmentées que portent les organisations communautaires se sont développées depuis plusieurs décennies, dans un contexte de dépréciation de la nation politique, de la nation comme espace historique. Il y a une perte d’estime de soi, dans la société française, qui à mon avis est directement corrélée aux élites. Il y a eu un processus idéologique très lourd de destruction de l’image que le peuple pouvait avoir de lui-même et qui était lié à ce que les intellectuels ou les organisations politiques produisaient comme symboles et représentations de ce même peuple. A partir du moment où, dans les années 1970, le peuple devient un problème pour la gauche intellectuelle, il est tout à fait logique qu’il ne puisse plus y avoir de projection commune.
La représentation du Français, depuis les années 1970, a pris la figure du « beauf » de Cabu, un travailleur blanc, macho, raciste, un plouc inculte. C’est l’image du Français devenue dominante dans les élites culturelles de gauche. Un film marquant, lui aussi des années 1970, Dupont Lajoie, montre un travailleur « blanc » qui est ontologiquement raciste. Il y a un phénomène de substitution qui est apparu dans les années 1980 : on préfère au travailleur français, qui était une figure du peuple, la figure de l’immigré. C’est ce que j’appellerai la xénophilie de substitution. Aujourd’hui on est toujours dans cette configuration idéologique, qui a évolué en « sans-papiérisme », qui n’est rien d’autre qu’une variante de ce déplacement politique, idéologique et affectif. A force de rechercher la fraternité ailleurs, cela me semble surtout signifier que l’on n’a pas tellement envie de la rencontrer dans son pays, avec ses voisins les plus proches : les classes populaires.
Il ne s’agit pas de haine de soi, les élites sont très contentes d’elles. Elles sont animées non pas d’une haine du peuple, mais en tous cas d’un profond mépris pour lui, ce qui a créé un phénomène de distanciation qui me semble en cours d’aggravation.
Ce que vous appellez le « sans-papiérisme » ne recherche pas à relier ce problème avec ceux, plus larges, des travailleurs, chômeurs et autres. Non, c’est devenu un problème particulier, celui de procurer des papiers et ensuite, on ne s’intéresse plus à eux.
Julien Landfried : Les « sans-papiéristes » refusent de voir que l’immigration a un impact sur les conditions de travail et de rémunération des personnes non qualifiées de la classe ouvrière, et qu’elle crée une très forte concurrence sur les plus bas salaires. Evidemment, lorsqu’on a un rapport avec l’immigration qui se résume au personnel domestique ou aux femmes de ménage, et que l’on n’est pas soi-même mis en concurrence sur le marché du travail ou du logement, on ne peut qu’être « sans-papiériste » !
Dans le « sans-papiérisme », il y a, je le répète, un phénomène de substitution. La classe ouvrière est remplacée par les sans-papiers. Le porte-parole de la Ligue communiste révolutionnaire Oliver Besancenot dit d’ailleurs souvent que « les immigrés sont les principales victimes du libéralisme ». Peut-on imaginer aveu plus clair ?
En quoi le républicanisme vous semble-t-il encore adapté ?
Julien Landfried : Pour en revenir à la question républicaine, la thèse du livre est la suivante : le modèle républicain français est, même s’il a des imperfections, un modèle robuste. Il a été pensé de manière particulièrement fine. Les principes républicains peuvent permettre à la société française de poursuivre sa propre histoire. La société française, dans son mode de fonctionnement démographique, est globalement en accord avec ces principes. Si on la compare avec les Etats-Unis, la Grande Bretagne, l’Allemagne, on s’aperçoit que le degré d’ouverture, d’universalisme concret, que l’on peut mesurer par le nombre de mariages mixtes, par la capacité des gens à construire des familles avec des personnes venues d’univers différents, est très élevé. Contrairement à ce que l’on veut nous faire croire, le peuple français est particulièrement anti-raciste, et dans le bon sens du terme, à savoir non « médiatico-associatif » ! Il vit un anti-racisme concret, discret et puissant.
Je défends aussi dans le livre l’idée que l’assimilation fait partie intégrante de l’idéal républicain. Il est consternant de voir à quel point l’idée même d’assimilation est devenu un tabou à gauche, alors que cela a été le cœur de la gauche républicaine pendant des décennies ! Voilà un principe totalement admis par les catégories populaires. Son abandon a été vécu de manière insupportable par elles, et il ne faut pas nécessairement chercher beaucoup plus loin la dynamique qui a poussé le Front National dans les années 80 au moment où le multiculturalisme théorique enterrait l’idée même d’assimilation dans la rhétorique de la gauche.
Le principe de la liberté est lui aussi bien mal en point et je le montre en ce qui concerne la chape de plomb qui empêche de s’exprimer sur les organisations communautaires, relayées par le processus idéologique de « politiquement correct », par les médias, la servilité du monde politique. On en est arrivé à ne pas pouvoir dire les choses comme elles sont. Il y a là un enjeu de reprise d’émancipation et c’est un message que j’envoie au courant républicain : à un moment donné, il faut avoir le courage de dire les choses comme elles sont et cesser de s’abriter derrière l’évocation des principes. La démocratie est, je le rappelle, l’organisation de la conflictualité politique.
La notion d’égalité en droits est elle aussi très mal en point, parce que les courants socialistes, au sens large, l’ont troqué pour l’antiracisme. Mais l’antiracisme n’est pas une politique, c’est une posture morale. Dans une époque où la dynamique est inégalitaire, au plan national comme international, il faut un mouvement politique qui soit en mesure de redire que l’égalité en droits est un objectif politique central.
Pouvez-vous préciser le lien que vous tissez entre le socialisme et l’antiracisme ?
Julien Landfried : En 1983, la gauche a changé de logiciel politique et économique (c’est la fameuse « parenthèse » jamais refermée depuis), et elle a dû par conséquent trouver un prolétariat de substitution. La gauche n’avait plus les moyens de gagner les élections vu la politique qu’elle menait et l’on vit la montée conjointe de l’abstention et du vote en faveur du FN. La gauche a donc été « contrainte », une fois ce choix économique surplombant réalisé, d’élaborer une stratégie de substitution au socialisme : c’est l’invention de l’anti-racisme médiatique. Avant, on parlait de lutte des classes, depuis, c’est « Touche pas à mon pote » ! Pour aller vite, c’est ainsi que cela s’est passé. C’est l’histoire de SOS-racisme qu’il permet de comprendre cette substitution. Paul Yonnet l’a admirablement analysé dans Voyage au centre du malaise français (Gallimard, 1993).
Sos-racisme a évolué : jusqu’au début des années 90, ses positions étaient différentialistes et opposées à l’assimilation. L’association dépeignait une société française en proie à un racisme généralisé et avait pour habitude, par amalgame polémique, de transformer les Juifs en « immigrés » ! C’est ce qui a été appelé par certains observateurs l’« extranéisation des Juifs ».
Aujourd’hui, sans s’en expliquer véritablement, Sos-racisme s’est réconcilié avec l’assimilation. On voit donc que ses positions dérivent et se transforment au gré des rapports de force internes au monde politique et militant. Aujourd’hui, le Mrap ou la LDH, qui sont opposés à Sos-racisme, ont des positions identiques à celle du Sos-racisme d’il y a dix ans !
Ma critique de l’ensemble des associations anti-racistes est assez simple : elles ne produisent absolument rien. Si l’on veut des études sérieuses sur le racisme, mieux vaut s’adresser aux institutions publiques comme la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), les statistiques sont toutes publiques, les rapports publics sont intéressants alors que ceux des associations sont d’une affligeante bêtise. Elles ne vivent que de subventions, n’ont presque pas de cotisants. Si le gouvernement arrêtait de les subventionner, elles disparaîtraient purement et simplement. Il y a un lien très fort entre les associations anti-racistes et les institutions publiques, sur le plan financier et politique, qui illustre parfaitement la fonction écran que jouent les associations antiracistes dans notre société. De nombreux militants de ces associations se retrouvent d’ailleurs dans la classe politique et deviennent des élus, en bénéficiant soit de circonscriptions réservées, soit de places avantageuses lors de scrutins de liste.
Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par « francophobie » ?
Julien Landfried : On ne peut pas comprendre que de nouvelles catégories de « victimes » soient devenues centrales dans le discours public, et en particulier à gauche, si on ne comprend pas que le peuple qui était avant l’objet de l’attention de toute la gauche a complètement disparu de la carte politique et médiatique. Pourquoi ? il apparaît que les élites politiques, syndicales, intellectuelles qui structuraient le mouvement ouvrier, s’est créée une profonde distance avec le peuple au sens large. Cette distance a été aggravée par l’anti-racisme médiatique qui ne conçoit le peuple que de façon négative, qui le déprécie par une relecture de l’histoire nationale qui, en premier lieu, touche le peuple. L’intégralité de l’histoire française, pas seulement la période de colonisation, ou la collaboration vichyste, subit un processus dépréciatif. Une relecture de l’histoire du mouvement ouvrier a subi, là aussi, cette dépréciation en affirmant qu’il a toujours été réactionnaire ! Et en particulier, il n’aurait pas assez été connecté aux luttes « minoritaires ». La francophobie est devenue une idéologie dominante dans une large part des élites, en particulier à gauche.
A cette dernière réalité s’ajoute l’apparition de tout un ensemble de critiques masquées de l’idéal démocratique. Ainsi de la nouvelle allergie au « populisme », qui apparaîtrait étrange à un socialiste du début du siècle qui n’aurait pas eu peur du peuple et ne lui aurait pas trouvé que des vices. Le philosophe et essayiste Jean-Claude Michéa a écrit de très pénétrantes pages à ce sujet. Il est d’ailleurs hautement significatif que les commentateurs autorisés valorisent à ce point la décision de l’ancien président Mitterrand d’abolir la peine de mort, non d’abord en raison du caractère inacceptable de la peine de mort, mais d’abord parce que Mitterrand aurait eu la vertu d’aller contre l’opinion populaire, supposée favorable à la dite peine de mort. Pour la nouvelle intelligentsia, la grandeur d’un responsable politique se mesure désormais à sa capacité à mener des politiques opposées à celles que le peuple souhaiterait voir mener. Ce dispositif intellectuel a été reproduit à l’identique avec les deux référendums sur l’Europe en 1992 et 2005. C’est pourquoi il serait préférable, pour un responsable politique soucieux de justice sociale et de démocratie, de ne pas trop rougir si on le traite de « populiste ». Car ce sera sans doute là la marque qu’il aura chatouillé d’un peu trop près les intérêts des puissants.
Propos recueillis par Florence Gauthier et Gilbert Marquis, le 22 septembre 2007.
Contre le communautarisme, Julien Landfried, Armand Colin, 2007
Source : http://www.communautarisme.net
Contre le communautarisme, entretien de Julien Landfried, Utopie critique, n°42, 4ème trimestre 2007 (octobre), pages 39 à 45 Dans cet entretien à la revue Utopie critique, Julien Landfried (directeur de l’Observatoire du communautarisme) explicite la thèse de son essai "Contre le communautarisme" (Armand Colin, 2007) et le sens du passage d’une société politiquement organisée par la lutte de classes à une société organisée autour des minorités victimaires. Il se livre ici à une déconstruction critique de l’antiracisme médiatico-associatif et au rôle de substitution joué par l’immigrationnisme militant pour la gauche, suite au choix surplombant d’abandon des références socialistes traditionnelles.
Utopie critique : Pourquoi avoir écrit cet essai ?
Julien Landfried : Contre le communautarisme est un essai de défense critique de la philosophie républicaine et de la République comme système politique concret, face à un certain nombre d’offensives qui viennent de loin, mais qui ont pu réapparaître très clairement depuis quelques décennies et en particulier durant le second mandat de Jacques Chirac : lois mémorielles, minorités victimaires, réclamation de politiques de discrimination positive, tentative d’influer sur la politique française au Proche-orient, ethno-régionalismes. Il y a quatre ans, ne l’oublions pas, la Corse a failli sortir du cadre républicain de la loi égale pour tous !
Le livre s’appuie sur le travail de l’Observatoire du communautarisme créé en 2003, d’abord pour rappeler un certain nombre de principes, ensuite pour offrir une monographie de la situation du communautarisme en France, en définissant le plus clairement possible un certain nombre de termes, à commencer bien évidemment par celui de communautarisme.
Dans ce cadre, le livre ne parle pas de communautés, mais d’organisations communautaires qui prétendent parler au nom de leurs communautés et qui ont des stratégies politiques, intellectuelles, médiatiques, financières et autres vis-à-vis des responsables publics. Ce qui est important, à la différence d’un grand nombre de travaux en sciences sociales qui portent de manière très générale sur les communautés, c’est que je parle d’organisations communautaires, qui sont souvent des structures institutionnelles, associations, journaux, groupes de pression, qui ont une histoire dont on peut détailler les différents éléments, qui ont parfois des budgets, des membres, des structures que l’on connaît. Ces organisations communautaires engagées dans des revendications ethniques, religieuses, régionalistes, ou sexuelles, travaillent, en fait, à partir d’une même matrice intellectuelle et politique et ont des éléments de convergence tactique et, au bout du compte, participent selon moi à une mise en destruction de la République comme système politique concret.
Ce qu’analyse aussi mon essai, c’est le rôle des responsables politiques et des médias dans cette configuration, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de dynamique communautariste si des responsables politiques ne disent pas : « nous allons relayer ce que vous dites, nous allons vous financer, constituer telle ou telle structure dont vous ferez partie », ou encore s’il n’y a pas des médias qui, à un moment donné, disent : « vous qui prétendez parler au nom de telle catégorie, nous vous invitons et vous faisons parler parce que nous considérons que vous représentez effectivement la catégorie dont vous vous réclamez. Nous vous donnons en fait la légitimité de représenter la catégorie que vous prétendez représenter. » Il s’agit en réalité d’un dispositif complètement circulaire qui permet à des organisations communautaires d’être consacrées non par leur « communauté » mais pas les politiques et les médias.
Le livre tente aussi de montrer comment des groupes extrêmement minoritaires, y compris au sein des communautés qu’ils prétendent représenter -si tant est que la communauté existe- arrivent très rapidement à des positions de force dans l’espace institutionnel. Je multiplie les exemples : que ce soit le CRIF, le CRAN qui s’est constitué dans une certaine mesure sur le modèle du CRIF, les Indigènes de la République, etc. Le livre ne fait pas l’impasse sur le rôle des organisations communautaires juives dans la définition d’une matrice commune, politique, médiatique et sur comment les autres organisations sont prises à la fois dans un processus de concurrence jalouse, envieuse, et d’imitation vis-à-vis de ces organisations juives. Cela permet d’expliquer, en particulier, le fait que, alors que la plupart des organisations communautaires se construisent sur le modèle juif, un certain nombre des leaders de ces organisations sont animés d’une certaine forme d’antisémitisme. Le communautarisme juif constitue à la fois le modèle théorique et pratique des autres communautarismes, tout en concentrant sur lui haines et ressentiment précisément à cause de sa réussite indéniable.
Les valeurs attribuées à l’esprit des communautés en viennent-elles, plus qu’à s’opposer, à casser l’idée même de justice sociale ?
Julien Landfried : Si on analyse le rôle des médias, il faut voir comment une certaine presse de gauche, à partir des années 1970-80, a décidé que la nation comme nation politique était un problème, en tout cas une configuration politique qui n’avait pas sa préférence. D’autres modes d’organisations politiques, en particulier le multiculturalisme ou le multicommunautarisme politique étaient peu à peu devenues l’objet de leur désir politique. Par exemple, Libération, Le Nouvel Observateur, Politis, Le Monde Diplomatique dans un certain nombre de leurs textes, trahissent leur préférence idéologique cachée, en mettant en avant telle ou telle revendication communautariste. Quand Libération fait sa Une sur la « question noire » en France, le même jour que la première manifestation importante du CRAN, qui est pourtant très faible numériquement, c’est en réalité Libération qui en dit long sur ses préférences idéologiques !. Dans ce cadre-là, c’est la presse de gauche qui tient un rôle déterminant car auparavant c’était elle qui, en mettant la question sociale en tête de l’agenda politique, forçait les responsables politiques et médiatiques à se positionner par rapport à elle.
A partir du moment où un certain nombre de journaux décident que l’agenda politique doit être restructuré, la question sociale en fait est dégradée, elle est placée vers le bas de la file d’attente dans la hiérarchie des urgences. Le vrai problème de ces organisations communautaires, c’est l’impact qu’elles ont sur le monde politique, intellectuel ou médiatique : elles perturbent l’agenda politique. Des problèmes essentiels ont ainsi été déclassés par des questions mineures ou illégitimes.
Il suffit de voir comment les grandes organisations communautaires que j’étudie dans le livre sont faiblement représentatives des « communautés » au nom desquelles elles prétendent parler. Le CRAN doit avoir quelques dizaines de cotisants, quand il organise une manifestation, il y a 500 personnes ; les Indigènes de la République ne dépassent pas la trentaine de « polémistes ». Le CRIF qui se prétend représentatif de la « communauté juive de France » ne regroupe réellement que quelques milliers de personnes au mieux. Il y a donc un problème de représentativité, problème qui, par ailleurs, se pose dans toute démarche politique dans la République.
Dès lors, pourquoi critiquer spécifiquement les organisations communautaires ?
Julien Landfried : La question de la représentativité est au cœur des institutions de pouvoirs et de contre-pouvoirs. Si on prend le cas des syndicats, aucun d’entre eux ne peut se prétendre représentatif de tous les salariés. Si tel était le cas, aussitôt, quelqu’un le nierait en affirmant qu’il n’appartient pas à ce syndicat, que ce même syndicat peut compter 500 000 adhérents, mais qu’il y a 20 millions de salariés en France.
Avec le syndicalisme, quel qu’il soit, salarial ou patronal, il y a toujours des gens qui n’y adhèrent pas et ont le droit de le dire, alors qu’avec les organisations communautaires, le processus d’intimidation intellectuelle, qui est à la base du communautarisme, interdit toute contestation. L’intimidation consiste à affirmer que toute critique est l’expression d’une « phobie » et vous voilà « antisémite », « homophobe », « islamophobe », « raciste » ou autre, en butte aux procès ou aux menaces ! Ce qui empêche bien entendu toute constitution d’une forme de contre-pouvoir, en raison de son coût trop élevé (risques de campagne de calomnie et de déstabilisation, polémiques publiques, menaces de procès, etc.). Or, ce sont les contre-pouvoirs qui contribuent à remettre les institutions et les organisations à leur juste place. C’est là que réside la grande différence entre « corporatisme » et « communautarisme ». Le « corporatisme » fonctionne avec de puissants contre-pouvoirs, alors que le « communautarisme » les refuse, à cause de la mise en fonctionnement de ce processus d’intimidation intellectuelle et politique.
Vous montrez clairement dans votre livre que ces organisations communautaires en viennent à diviser la société en mettant en avant des intérêts particuliers.
Julien Landfried : Je ne dis pas que les organisations communautaires ont ces objectifs, je dis que les conséquences de leurs actions en arrivent là. Ce n’est pas tout à fait la même chose. Par exemple, le CRIF a pour objectif essentiel la poursuite de la défense des intérêts israéliens. Les organisations homosexuelles, aujourd’hui, ce qui n’était pas le cas il y a dix ans, ont comme objectifs principaux le mariage homosexuel et l’homoparentalité. Si on prend tel ou tel groupe musulman, ce sera de réclamer la réforme de la loi de 1905 en vue d’un financement public des lieux de culte. Il apparaît clairement que les objectifs de ces organisations communautaires ont pour effet de déclasser la question sociale.
Les organisations communautaires défendent l’idée d’une société fragmentée où le multiculturalisme est au moins hermétique aux autres, quand il n’est pas en concurrence d’ailleurs ?
Julien Landfried : Bien entendu, mais il faut aussi voir que ces cultures fragmentées que portent les organisations communautaires se sont développées depuis plusieurs décennies, dans un contexte de dépréciation de la nation politique, de la nation comme espace historique. Il y a une perte d’estime de soi, dans la société française, qui à mon avis est directement corrélée aux élites. Il y a eu un processus idéologique très lourd de destruction de l’image que le peuple pouvait avoir de lui-même et qui était lié à ce que les intellectuels ou les organisations politiques produisaient comme symboles et représentations de ce même peuple. A partir du moment où, dans les années 1970, le peuple devient un problème pour la gauche intellectuelle, il est tout à fait logique qu’il ne puisse plus y avoir de projection commune.
La représentation du Français, depuis les années 1970, a pris la figure du « beauf » de Cabu, un travailleur blanc, macho, raciste, un plouc inculte. C’est l’image du Français devenue dominante dans les élites culturelles de gauche. Un film marquant, lui aussi des années 1970, Dupont Lajoie, montre un travailleur « blanc » qui est ontologiquement raciste. Il y a un phénomène de substitution qui est apparu dans les années 1980 : on préfère au travailleur français, qui était une figure du peuple, la figure de l’immigré. C’est ce que j’appellerai la xénophilie de substitution. Aujourd’hui on est toujours dans cette configuration idéologique, qui a évolué en « sans-papiérisme », qui n’est rien d’autre qu’une variante de ce déplacement politique, idéologique et affectif. A force de rechercher la fraternité ailleurs, cela me semble surtout signifier que l’on n’a pas tellement envie de la rencontrer dans son pays, avec ses voisins les plus proches : les classes populaires.
Il ne s’agit pas de haine de soi, les élites sont très contentes d’elles. Elles sont animées non pas d’une haine du peuple, mais en tous cas d’un profond mépris pour lui, ce qui a créé un phénomène de distanciation qui me semble en cours d’aggravation.
Ce que vous appellez le « sans-papiérisme » ne recherche pas à relier ce problème avec ceux, plus larges, des travailleurs, chômeurs et autres. Non, c’est devenu un problème particulier, celui de procurer des papiers et ensuite, on ne s’intéresse plus à eux.
Julien Landfried : Les « sans-papiéristes » refusent de voir que l’immigration a un impact sur les conditions de travail et de rémunération des personnes non qualifiées de la classe ouvrière, et qu’elle crée une très forte concurrence sur les plus bas salaires. Evidemment, lorsqu’on a un rapport avec l’immigration qui se résume au personnel domestique ou aux femmes de ménage, et que l’on n’est pas soi-même mis en concurrence sur le marché du travail ou du logement, on ne peut qu’être « sans-papiériste » !
Dans le « sans-papiérisme », il y a, je le répète, un phénomène de substitution. La classe ouvrière est remplacée par les sans-papiers. Le porte-parole de la Ligue communiste révolutionnaire Oliver Besancenot dit d’ailleurs souvent que « les immigrés sont les principales victimes du libéralisme ». Peut-on imaginer aveu plus clair ?
En quoi le républicanisme vous semble-t-il encore adapté ?
Julien Landfried : Pour en revenir à la question républicaine, la thèse du livre est la suivante : le modèle républicain français est, même s’il a des imperfections, un modèle robuste. Il a été pensé de manière particulièrement fine. Les principes républicains peuvent permettre à la société française de poursuivre sa propre histoire. La société française, dans son mode de fonctionnement démographique, est globalement en accord avec ces principes. Si on la compare avec les Etats-Unis, la Grande Bretagne, l’Allemagne, on s’aperçoit que le degré d’ouverture, d’universalisme concret, que l’on peut mesurer par le nombre de mariages mixtes, par la capacité des gens à construire des familles avec des personnes venues d’univers différents, est très élevé. Contrairement à ce que l’on veut nous faire croire, le peuple français est particulièrement anti-raciste, et dans le bon sens du terme, à savoir non « médiatico-associatif » ! Il vit un anti-racisme concret, discret et puissant.
Je défends aussi dans le livre l’idée que l’assimilation fait partie intégrante de l’idéal républicain. Il est consternant de voir à quel point l’idée même d’assimilation est devenu un tabou à gauche, alors que cela a été le cœur de la gauche républicaine pendant des décennies ! Voilà un principe totalement admis par les catégories populaires. Son abandon a été vécu de manière insupportable par elles, et il ne faut pas nécessairement chercher beaucoup plus loin la dynamique qui a poussé le Front National dans les années 80 au moment où le multiculturalisme théorique enterrait l’idée même d’assimilation dans la rhétorique de la gauche.
Le principe de la liberté est lui aussi bien mal en point et je le montre en ce qui concerne la chape de plomb qui empêche de s’exprimer sur les organisations communautaires, relayées par le processus idéologique de « politiquement correct », par les médias, la servilité du monde politique. On en est arrivé à ne pas pouvoir dire les choses comme elles sont. Il y a là un enjeu de reprise d’émancipation et c’est un message que j’envoie au courant républicain : à un moment donné, il faut avoir le courage de dire les choses comme elles sont et cesser de s’abriter derrière l’évocation des principes. La démocratie est, je le rappelle, l’organisation de la conflictualité politique.
La notion d’égalité en droits est elle aussi très mal en point, parce que les courants socialistes, au sens large, l’ont troqué pour l’antiracisme. Mais l’antiracisme n’est pas une politique, c’est une posture morale. Dans une époque où la dynamique est inégalitaire, au plan national comme international, il faut un mouvement politique qui soit en mesure de redire que l’égalité en droits est un objectif politique central.
Pouvez-vous préciser le lien que vous tissez entre le socialisme et l’antiracisme ?
Julien Landfried : En 1983, la gauche a changé de logiciel politique et économique (c’est la fameuse « parenthèse » jamais refermée depuis), et elle a dû par conséquent trouver un prolétariat de substitution. La gauche n’avait plus les moyens de gagner les élections vu la politique qu’elle menait et l’on vit la montée conjointe de l’abstention et du vote en faveur du FN. La gauche a donc été « contrainte », une fois ce choix économique surplombant réalisé, d’élaborer une stratégie de substitution au socialisme : c’est l’invention de l’anti-racisme médiatique. Avant, on parlait de lutte des classes, depuis, c’est « Touche pas à mon pote » ! Pour aller vite, c’est ainsi que cela s’est passé. C’est l’histoire de SOS-racisme qu’il permet de comprendre cette substitution. Paul Yonnet l’a admirablement analysé dans Voyage au centre du malaise français (Gallimard, 1993).
Sos-racisme a évolué : jusqu’au début des années 90, ses positions étaient différentialistes et opposées à l’assimilation. L’association dépeignait une société française en proie à un racisme généralisé et avait pour habitude, par amalgame polémique, de transformer les Juifs en « immigrés » ! C’est ce qui a été appelé par certains observateurs l’« extranéisation des Juifs ».
Aujourd’hui, sans s’en expliquer véritablement, Sos-racisme s’est réconcilié avec l’assimilation. On voit donc que ses positions dérivent et se transforment au gré des rapports de force internes au monde politique et militant. Aujourd’hui, le Mrap ou la LDH, qui sont opposés à Sos-racisme, ont des positions identiques à celle du Sos-racisme d’il y a dix ans !
Ma critique de l’ensemble des associations anti-racistes est assez simple : elles ne produisent absolument rien. Si l’on veut des études sérieuses sur le racisme, mieux vaut s’adresser aux institutions publiques comme la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), les statistiques sont toutes publiques, les rapports publics sont intéressants alors que ceux des associations sont d’une affligeante bêtise. Elles ne vivent que de subventions, n’ont presque pas de cotisants. Si le gouvernement arrêtait de les subventionner, elles disparaîtraient purement et simplement. Il y a un lien très fort entre les associations anti-racistes et les institutions publiques, sur le plan financier et politique, qui illustre parfaitement la fonction écran que jouent les associations antiracistes dans notre société. De nombreux militants de ces associations se retrouvent d’ailleurs dans la classe politique et deviennent des élus, en bénéficiant soit de circonscriptions réservées, soit de places avantageuses lors de scrutins de liste.
Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par « francophobie » ?
Julien Landfried : On ne peut pas comprendre que de nouvelles catégories de « victimes » soient devenues centrales dans le discours public, et en particulier à gauche, si on ne comprend pas que le peuple qui était avant l’objet de l’attention de toute la gauche a complètement disparu de la carte politique et médiatique. Pourquoi ? il apparaît que les élites politiques, syndicales, intellectuelles qui structuraient le mouvement ouvrier, s’est créée une profonde distance avec le peuple au sens large. Cette distance a été aggravée par l’anti-racisme médiatique qui ne conçoit le peuple que de façon négative, qui le déprécie par une relecture de l’histoire nationale qui, en premier lieu, touche le peuple. L’intégralité de l’histoire française, pas seulement la période de colonisation, ou la collaboration vichyste, subit un processus dépréciatif. Une relecture de l’histoire du mouvement ouvrier a subi, là aussi, cette dépréciation en affirmant qu’il a toujours été réactionnaire ! Et en particulier, il n’aurait pas assez été connecté aux luttes « minoritaires ». La francophobie est devenue une idéologie dominante dans une large part des élites, en particulier à gauche.
A cette dernière réalité s’ajoute l’apparition de tout un ensemble de critiques masquées de l’idéal démocratique. Ainsi de la nouvelle allergie au « populisme », qui apparaîtrait étrange à un socialiste du début du siècle qui n’aurait pas eu peur du peuple et ne lui aurait pas trouvé que des vices. Le philosophe et essayiste Jean-Claude Michéa a écrit de très pénétrantes pages à ce sujet. Il est d’ailleurs hautement significatif que les commentateurs autorisés valorisent à ce point la décision de l’ancien président Mitterrand d’abolir la peine de mort, non d’abord en raison du caractère inacceptable de la peine de mort, mais d’abord parce que Mitterrand aurait eu la vertu d’aller contre l’opinion populaire, supposée favorable à la dite peine de mort. Pour la nouvelle intelligentsia, la grandeur d’un responsable politique se mesure désormais à sa capacité à mener des politiques opposées à celles que le peuple souhaiterait voir mener. Ce dispositif intellectuel a été reproduit à l’identique avec les deux référendums sur l’Europe en 1992 et 2005. C’est pourquoi il serait préférable, pour un responsable politique soucieux de justice sociale et de démocratie, de ne pas trop rougir si on le traite de « populiste ». Car ce sera sans doute là la marque qu’il aura chatouillé d’un peu trop près les intérêts des puissants.
Propos recueillis par Florence Gauthier et Gilbert Marquis, le 22 septembre 2007.
Contre le communautarisme, Julien Landfried, Armand Colin, 2007
Source : http://www.communautarisme.net












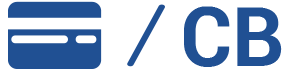
 et
et  !
!

