2 – La politique industrielle de Barack Obama : l’exemple de l’automobile
En complément de l’analyse de la situation américaine sur le plan monétaire et financier présentée dans le JDGD précédent, intéressons-nous à la politique industrielle d’Obama. Il est encore un peu tôt pour formuler un pronostic précis, parce qu’à vrai dire, Obama est en réalité arrivé à la Maison Blanche sans programme clair, mais nous avons au moins un exemple à nous mettre sous la dent, un domaine où l’urgence a obligé Obama à abattre ses cartes : l’automobile.
En effet, c’est officiel, aux USA, la politique industrielle est de retour. Obama a décidé de prendre en main la restructuration du secteur automobile américain (en coma dépassé, après être passé en 15 ans de 75 % à 45 % du marché intérieur). Pour la petite histoire, cela s’est traduit dans un premier temps par un sketch qui, à défaut de régler le problème sur le fond, aura au moins réchauffé le cœur des millions de travailleurs américains licenciés ces derniers mois : l’éviction avec perte et fracas du PDG de General Motors, sur le sort duquel nous ne pleurerons certes pas. On remarquera simplement qu’un président soutenu en sous-main par la Haute Banque aura donc « fait la peau » à un dirigeant de la grande industrie, et l’on observera au passage que certains signaux indiquent, de manière de plus en plus claire qu’en réaction à ce type de conflits, une étrange révolte silencieuse se propage au plus haut niveau de l’appareil d’Etat américain, au fur et à mesure que la crise approfondit les fossés entre les diverses composantes de l’oligarchie US. C’est une des raisons qui font qu’Obama ne pourra peut-être pas très longtemps activer des leviers hiérarchiques opératoires. On se souviendra à ce propos que l’implosion de l’URSS a été due, sur le plan organisationnel, à la multiplication des leviers qui, dans l’appareil d’Etat, ne « répondaient » plus…
Obama, qui a finalement cédé sur l’essentiel aux milieux bancaires, a donc été en revanche assez « dur » avec la haute industrie – du moins dans le seul domaine où, à ce stade, il a à notre connaissance effectivement agi, à savoir l’automobile. GM a reçu 60 jours pour prouver sa viabilité, après quoi la faillite serait constatée. Chrysler a reçu un mois pour boucler un projet d’alliance avec Fiat, faute de quoi l’aide de l’Etat serait suspendue. C’est clair et net : la politique d’Obama, dans l’automobile, sonne le glas du mythique marché autorégulé. Retour aux cartels organisé par l’Etat, et conservés sous sa tutelle. Techniquement, on peut dire en somme qu’Obama met l’Etat américain au service de la Haute Banque, en plaçant sous tutelle une industrie qu’il va piloter dans une optique de rentabilisation financière, coûte que coûte, en dépit du prévisible recul d’un marché devenu largement insolvable.
L’administration Obama analyse en effet les causes de la quasi-faillite de l’industrie américaine comme la conséquence d’erreurs de gestion, en particulier la production de véhicules polluants et gourmands en carburant – une politique absurde favorisée, soit dit en passant, par les règlementations de l’Etat fédéral lui-même. Sans nier la réalité de ces erreurs de gestion, il est frappant que le crédo Obama, à ce stade, semble minimiser délibérément ce qui est, évidemment, la cause principale : à savoir le différentiel de salaire entre les constructeurs américains et les constructeurs étrangers – différentiel observé y compris aux USA, où les travailleurs de l’automobile américaine bénéficiaient, jusqu’ici, de conventions collectives assez favorables. On remarquera qu’en l’occurrence, comme souvent décidément dans la vie « démocratique », la politique qu’Obama semble devoir déployer va donc à l’encontre de son discours de campagne, un discours qui faisait une large place au thème de la « fracture sociale ».
La politique impulsée par Obama risque en fait, plutôt, d’accentuer la crise, parce qu’elle correspond semble-t-il à une approche idéologique connotée. Idéologiquement, Obama n’a pas franchement rompu avec la période précédente. Les questions tabou de l’ère néolibérale resteront-elles, dans l’ère post-libérale Obama, tout aussi tabou ? On peut de plus en plus le craindre. Les causes de l’implosion de l’économie productive américaine sont principalement à rechercher du côté d’un libre-échange inéquitable, eu égard aux différentiels de salaires, et dans une répartition de la valeur ajoutée exagérément favorable au capital, qui a progressivement transformé le marché américain des particuliers en une sorte d’immense poche d’insolvabilité généralisée – tandis que des masses de capital formidables s’accumulaient dans l’économie virtuelle, entraînant un appétit toujours plus grand de retour sur investissement forcément virtuel, en l’absence de croissance réelle de la production.
Tout cela est vrai de l’ensemble de l’économie américaine, et c’est vrai aussi de l’industrie automobile. Le fait que la politique Obama ne traite pour l’instant pas ces problèmes centraux, libre-échange et répartition de la valeur ajoutée, implique que cette politique risque au mieux de ne faire qu’accompagner la crise, et qu’au pire elle pourrait l’accentuer. Nous n’entrerons pas dans le débat « Obama keynésien ou pas », parce que l’exégèse des œuvres de Keynes n’intéresse pas grand-monde. Mais disons que si Obama a lu Keynes, il n’en a apparemment retenu que les pires aspects – du moins si l’on en juge par la politique qu’il semble devoir déployer dans le secteur automobile.
Nous n’entendons pas parler d’une politique obligeant les constructeurs à s’aligner sur des conventions collectives favorables aux travailleurs, pas plus que d’une politique de protectionnisme raisonné. Nous voyons plutôt s’enclencher une nouvelle phase de la démolition systématique des avantages sociaux de la classe ouvrière américaine, au nom d’une « bataille de la compétitivité » à gagner absolument. Officiellement, il s’agit de faire cesser la chute de l’investissement en recherche et développement (avec l’argument écologique, en particulier, pour créer de nouveaux marchés), de corriger l’insuffisante régulation du crédit, de réformer la fiscalité pour en finir avec les distorsions dans la taxation des entreprises, et d’organiser des pôles de spécialisation économique. A aucun moment, il n’est question des vrais sujets qui sont, répétons-le, le libre-échange inéquitable et la répartition de la valeur ajoutée entre capital et travail.
A SUIVRE...
E&R - Michel Drac












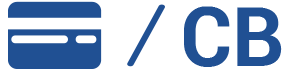
 et
et  !
!

