Mon article « Quand l’imprévisible est certain » a été repris sur bon nombre de sites et de forums, et il m’a valu un courrier abondant. J’ai parcouru les réactions, certaines sont très intéressantes. Je me suis rendu compte, en lisant les intervenants, que beaucoup de points dans mon analyse devaient être affinés. Je me résouds donc à essayer de coucher noir sur blanc les données du problème, pour préciser ma pensée. (article du 5 septembre 2008)
Voici ma thèse : je maintiens que nous allons vers une secousse économique majeure, probablement comparable à 1929. Et je maintiens aussi que si cette secousse est certaine, il est très difficile à ce stade d’en préciser le calendrier et les modalités. Mais j’éprouve, au vu des réactions, le besoin d’approfondir la théorie des cycles économiques, pour mieux cartographier les scénarios possibles.
Qu’est-ce qu’une crise ?
Commençons par analyser plus précisément la notion de crise.
Une crise correspond toujours au passage d’une organisation générale de l’économie-monde à une autre organisation générale. L’examen des évènements passés permet de distinguer deux niveaux dans ce processus :
 les crises mineures ou conjoncturelles, correspondant au point bas des cycles courts du capitalisme, ou cycles de Juglar,
les crises mineures ou conjoncturelles, correspondant au point bas des cycles courts du capitalisme, ou cycles de Juglar,
 les crises majeures ou structurelles, correspondant à certains points bas des cycles longs du capitalisme, ou cycles de Kondratiev.
les crises majeures ou structurelles, correspondant à certains points bas des cycles longs du capitalisme, ou cycles de Kondratiev.
Le mécanisme exposé dans l’article « Quand l’imprévisible est certain » explique les systoles et diastoles de la répartition des richesses. Il est intéressant de comprendre tout d’abord pourquoi ce mouvement n’engendre pas de crises permanentes, mais au contraire une alternance de phases de croissance et de récession.
La dérive inégalitaire du capitalisme produit une dilatation de l’économie, tant que le développement de la production réelle contrebalance la concentration croissante des richesses. Ce développement de la production réelle est induit par l’accroissement de la productivité, rendu possible par le développement technologique et la substitution du capital au travail.
Un exemple : imaginons une économie ne comportant que quatre acteurs, deux travailleurs et deux employeurs. En phase A courte du cycle de Juglar, les employeurs profitent d’une innovation technologique pour accroître les rendements. Grâce aux investissements consentis par les employeurs, et les travailleurs produisent plus en travaillant autant. Les salaires augmentent, mais moins vite que la production (il faut bien que les employeurs retirent un profit de leurs investissements). Les travailleurs utilisent l’argent supplémentaire pour consommer davantage, tandis que les employeurs accumulent les dividendes.
Arrive le moment où les employeurs ont accumulé tellement de dividendes qu’il leur faut investir à nouveau. Seulement, problème : comme les travailleurs n’ont pas suffisamment épargné (puisqu’ils ont consommé), ils ne peuvent plus acheter les produits issus de l’accroissement de la production. Donc lorsque les employeurs investissent à nouveau, ils se retrouvent avec des capacités de production inutilisées, donc des investissements non rentables.
Commence la phase B courte du cycle de Juglar. Il faut détruire du signe monétaire pour relancer la machine, et pour cela la méthode est simple : un des deux employeurs (celui qui a fait les moins bons choix d’investissement) doit faire faillite, ou se laisser racheter à bas prix par son concurrent. Dans l’opération, une partie de la valeur boursière est détruite. La quantité de signe monétaire diminue à travers la révision à la baisse des actifs, donc la valeur intrinsèque du signe est renforcée, donc les salaires sont indirectement augmentés à nouveau. Cette augmentation n’est pas toujours perceptible en données brutes, car elle ne doit pas être comprise au regard de la mesure physique de la production, mais plutôt au regard du rapport entre les besoins croissants des travailleurs et leur capacité à dégager une part de dépenses non contraintes. Cependant, augmentation il y a, mécaniquement, dès lors que les revenus du travail croissent à nouveau plus vite que ceux du capital, pénalisés par l’absence de débouchés.
Arrive donc le moment où un nouveau point d’équilibre est trouvé. Le pouvoir d’achat des travailleurs progresse de manière invisible mais réelle, et donc le marché croît à nouveau, et donc l’employeur survivant peut procéder à de nouveaux investissements, exploitant les percées technologiques plus avant. Ainsi, la machine est relancée : on repasse en phase A courte.
Bien sûr, dans la réalité, les mécanismes sont infiniment plus complexes : les employeurs doivent recourir à des emprunts auprès de banques qui ont centralisé le signe monétaire en excès, et la destruction de signe passe donc par un processus beaucoup plus sophistiqué qu’une simple contraction des actifs boursiers. Mais à ce stade, restons-en là : phase A courte, croissance de la production supérieure à la dérive inégalitaire du capitalisme ; phase B courte, croissance de production inférieure à la dérive inégalitaire, donc nécessité de détruire du signe monétaire.
L’histoire économique depuis la révolution industrielle enseigne que ce mécanisme de cycles courts, dits cycle de Juglar, obéit à un rythme général d’un peu moins d’une décennie. Depuis 30 ans, nous avons vu quatre cycles de Juglar : 1979-1987, 1987-1993, 1993-2000, 2000-2007.
Aucun des points bas de ces cycles n’a marqué de catastrophe majeure, même si en 1987, nous sommes passés très près d’un accident majeur. A chaque fois, il y a eu une purge, plus ou moins violente, mais au final tout à fait bénéfique. C’est la force du capitalisme d’intégrer dans son fonctionnement structurel les antidotes à ses dérives. C’est cette capacité à alterner phases A courtes et phases B courtes qui explique qu’en dépit de ses dysfonctionnements évidents, le marché reste en temps normal le meilleur régulateur de l’activité économique.
A la différence des cycles de Juglar, qui reviennent avec une régularité de minuterie suisse, les cycles longs, dits cycle de Kondratiev, obéissent à des mécanismes complexes, où technologie, culture, politique et économie interagissent de manière assez imprévisible.
Historiquement, l’économie capitaliste mondialisée a connu jusqu’ici quatre cycles longs complets : 1787-1815 (phase A longue) et 1815-1848 (phase B longue), 1848-1873 (phase A longue) et 1873-1896 (phase B longue), 1896-1929 (phase A prolongée artificiellement par la Première Guerre Mondiale) et 1929-1945 (phase B longue achevée prématurément par la Seconde Guerre Mondiale), 1945-1973 (phase A longue dite « des trente glorieuses ») et 1973-1987 (phase B écourtée artificiellement – nous y reviendrons).
Avant d’aller plus loin, essayons de comprendre à quels mécanismes renvoient les cycles de Kondratiev.
Les phases A longues correspondent à une période de croissance soutenue de la production. Les phases B longues correspondent au contraire à une période de croissance moins soutenue. Tout se passe comme si en phase A longues, les phases A courtes étaient exceptionnellement dynamiques et les phases B courtes exceptionnellement clémentes, alors qu’en phase B longue, c’est l’inverse : les phases A courtes sont peu dynamiques, les phases B courtes franchement désastreuses.
Schumpeter a montré que les phases A longues suivent généralement une « grappe » d’innovations technologiques majeures (le métier à tisser en 1780, qui rendit possible l’exploitation massive par l’Angleterre des ressources en cotons de l’Inde ; le chemin de fer et les progrès fulgurants de la métallurgie à partir de 1848 ; l’économie du pétrole et de l’électricité remplaçant celle du charbon, une fois surmontée la crise des années 30), alors que les phases B commencent quand l’accroissement de productivité rendu possible par ces innovations ne peut plus être prolongé significativement.
La principale critique qu’on peut adresser à la théorie des cycles de Kondratiev et à l’analyse de Schumpeter réside dans l’ignorance où ces auteurs ont largement tenu la question du crédit. Cependant, cette critique ne remet en cause ni les constats de bon sens faits par Kondratiev, ni l’analyse imparable de Schumpeter : il est clair que l’économie capitaliste a obéi historiquement à deux régimes différents, l’un rapide privilégiant les phases A courtes, l’autre lent privilégiant les phases B courtes, et il est non moins clair que l’alternance de ces phases A longues et B longues correspond assez précisément aux grandes innovations technologiques. En fait, on peut penser que si le crédit est abondant en phase A, c’est tout simplement parce que les innovations technologiques rendent l’investissement plus rentable, et donc les détenteurs du capital hésitent moins à investir, alors qu’en phase B, si le crédit est plus rare, c’est parce que la rentabilité marginale du capital diminue, et donc les investisseurs sont plus prudents.
Ces éléments de théorie, très sommaires j’en ai conscience, suffisent malgré tout à faire comprendre la nature de l’époque qui s’achève sous nos yeux : c’est la fin d’une phase A longue artificielle.
Pour comprendre l’évolution récente de l’économie capitaliste occidentale, il faut se souvenir de trois faits structurants :
2°) A la fin des années 70, la révolution informatique modifie la nature même des économies développées. Le second choc pétrolier, en 1979, aurait dû enfoncer les USA dans la stagflation. Or, ce n’est pas ce qui s’est passé : un nouveau moteur technologique prend le relais de l’économie pétrole-électricité entrée en phase B. Cependant, ce moteur ne fonctionne pas « normalement ». Il n’induit pas de croissance réelle de la production primaire et secondaire. Le développement de l’économie virtuelle (micro-ordinateurs, nouvelles technologies de l’information, explosion des activités tertiaires pures) est sans impact réel sur la production industrielle et agricole, base de l’économie.
Ainsi, depuis trente ans, l’économie occidentale fonctionne sur un schéma pervers. Certes, les usines sont de plus en plus performantes. Mais cet accroissement de performance n’est pas décisif, aucune innovation technologique majeure n’est intervenue sur le plan de la production. On aurait donc logiquement dû constater depuis longtemps une phase B longue, avec des phases A courtes médiocres, et des phases B courtes prononcées.
Or, ce n’est pas ce que l’on observe : tout se passe comme si la phase B longue entamée avec le premier choc pétrolier, en 1973, avait pris fin dès le début des années 80.
Comment expliquer ce miracle ? – Tout simplement par la structure du PIB des pays développés, et en premier lieu des USA. En 1972, le PIB des USA se monte à 4.100 milliards de dollars constants 2000. Il est composé à 35 % environ (plusieurs méthodes de redressement des prix) par les secteurs primaire et secondaire (1450 milliards de dollars 2000). En 2007, le PIB américain se monte à 11.000 milliards de dollars constants 2000, donc 2,75 fois plus. Mais les secteurs primaire et secondaire ne pèsent plus que 20 % du PIB des USA (2250 milliards de dollars). Par conséquent, sur la période qui va de 1972 à 2007, le taux de croissance moyen du PIB USA en dollars constants a été de 3 %, mais celui de la production n’a été que de 1,2 %.
Tout est dit. Une croissance à 3 % correspond à une phase A longue – c’est l’illusion dans laquelle l’Occident vit depuis une génération. A l’inverse, une croissance à 1,2 % correspond à une phase B longue – c’est la réalité de l’économie occidentale depuis 30 ans.
Conclusion : les USA se sont donné l’illusion d’une phase A prolongée en développant énormément les activités de service, activités de flux qui génèrent des revenus mais pas de production stricto sensu, alors qu’ils étaient en réalité entrés dans une phase B longue, sur le plan de la réalité de la production – et ce qui est vrai des USA l’est aussi de l’ensemble des économies développées de l’hémisphère occidental, à des degrés divers – palme d’or de l’économie désindustrialisée : la Grande-Bretagne ; médaille du mérite industriel : l’Allemagne.
3°) A partir de 1987, l’Union Soviétique implose et la Chine s’ouvre. C’est l’origine de la forte croissance américaine des années Clinton/Bush, forte croissance tirée pour l’essentiel par la consommation.
Comment la consommation peut-elle fabriquer de la croissance ? – Réponse : en fabriquant de la fausse croissance.
Les USA partent, dans les années 70, avec une position extérieure nette largement bénéficiaire. Progressivement, cette position extérieure se dégrade, jusqu’à devenir extrêmement négative (environ 7.000 milliards de dollars, actuellement). Depuis le tournant du siècle, le montant des investissements américains à l’étranger est plus faible que le montant des investissements étrangers aux USA, et la situation ne cesse de se dégrader. Pour l’instant, la balance des flux de capitaux n’en souffre pas trop, parce que les investissements américains à l’étranger sont principalement des actions, à rendement élevé, alors que les investissements étrangers aux USA sont essentiellement constitués de bons du trésor, à faible rendement. Mais cette situation est absolument malsaine : elle est caractéristique d’un « cœur » du capitalisme en voie d’implosion.
Tout se passe comme si les Américains avaient progressivement vidé leur stock d’actifs pour maintenir l’illusion d’une phase A longue alors que la réalité de la production les plaçait dans une phase B longue. C’est l’augmentation de la production chinoise, et à un degré moindre la conquête des ressources dans l’ancien bloc soviétique, qui expliquent le maintien d’une croissance américaine tirée par la consommation. Les Américains s’endettent à titre personnel, l’Amérique dans son ensemble bascule d’une situation de créancier à une situation de débiteur, et les citoyens des Etats-Unis, payés à faire tourner une machine économique artificiellement tertiarisée, consomment de plus en plus, sans produire en conséquence. Résultat : optiquement, le PIB US ne cesse de grimper, parce qu’il y a de plus en plus d’activités de service. Mais en réalité, la base de l’économie US ne progresse plus que très lentement, bien plus lentement que celle de ses concurrents stratégiques – la Chine en premier lieu.
Nous approchons du moment où ce modèle absurde ne pourra plus être pérennisé. Voilà pourquoi je maintiens mon analyse : nous allons au-devant d’une crise majeure – une phase B de Kondratiev, avec basculement du centre de gravité politique de l’économie-monde.
Reprenons l’histoire des cycles économiques longs, pour bien comprendre.
De 1787 environ à 1848 environ, l’Angleterre a connu un formidable bond en avant productif. Le moteur principal était alors le textile. Ayant conquis l’Inde, la Grande-Bretagne imposa à sa colonie principale des tarifs artificiellement bas sur le coton. Cette matière première bon marché permettait de rentabiliser au maximum les nouveaux métiers à tisser, qui décuplaient la force productive des ouvriers britanniques. Les revenus colossaux engendrés par cette industrie permirent à la Grande-Bretagne de triompher de son ennemi héréditaire, la France, malgré le blocus continental ordonné par Napoléon pour maintenir la prééminence française en Europe et affamer financièrement les Anglais. On peut même dire, sans grand risque de se tromper, que les guerres napoléoniennes aidèrent les Anglais, dans la mesure où leur coût énorme détruisit du capital, permettant de contrebalancer la dérive inégalitaire du capitalisme, justifiant la mobilisation économique de la Grande-Bretagne.
A partir de la fin des années 1810, cependant, la première révolution industrielle est achevée. Il n’y a plus d’évolution majeure dans les processus productifs de l’industrie textile. Et ce que Napoléon n’avait pu faire, la réalité de l’infrastructure technologique va le réaliser : l’Angleterre économique déraille. Pendant près de trois décennies, les taux de croissance sont bas, le capital anglais, surabondant, ne trouve pas à s’investir de manière rentable.
Puis arrivent les chemins de fer, à partir des années 1840, et la métallurgie, à partir des années 1850. De nouveaux champs de progrès productif s’ouvrent au capital. Le centre de gravité de l’économie anglaise bascule à l’intérieur de l’Angleterre – vers le nord, vers les mines et les aciéries, vers Manchester.
Comme la mutation se déroule à l’intérieur de la puissance dominante, c’est une mutation sans guerre majeure. L’Angleterre assoit paisiblement sa domination sur le monde, et quand elle fait la guerre, ce n’est pas pour freiner le développement de ses rivaux, mais pour s’ouvrir de nouveaux marchés – la guerre de l’opium, en Chine, par exemple. Les années 1850-1870 voient l’Angleterre triomphante ouvrir à l’Europe la voie du développement industriel à grande échelle, jusqu’à concentrer, à la City de Londres, la moitié des revenus de la planète. Bientôt, la France et l’Allemagne imitent Albion, et le capital dégage, partout, des taux de rendement fabuleux.
A partir des années 1870, le moteur se grippe. Les capacités de production commencent à devenir excédentaires. En 1873, une bulle spéculative implose – en Autriche, d’abord. Cette implosion marque l’ouverture d’une phase B longue. Le capital ne trouve plus à s’investir de manière rentable en Europe. Les phases B courtes sont particulièrement prononcées sur le vieux continent, et à partir de 1890, une stagnation tenace touche la zone anglaise – Grande-Bretagne et Europe du Nord hors Allemagne. Il n’y a pas à proprement parler de récession, plutôt une longue période de marasme.
Pendant ce temps, cependant, un nouveau « cœur » du capitalisme est en train de germer : les Etats-Unis. Si les années 1870 voient l’Europe entrer dans une longue phase B, elles sont aussi, pour l’Amérique, le temps du « boom » économique post-guerre de sécession. Progressivement, les capacités productives de Boston rattrapent celles de Manchester, les aciéries de Pittsburgh copient puis supplantent celles de Birmingham. Certes, à la fin du XX° siècle, l’Angleterre contrôle encore plus du quart de l’économie planétaire. Mais déjà, ce contrôle financier ne traduit plus la réalité de la production. Irrésistiblement, le capital est attiré vers l’Amérique du Nord, qui offre des rendements incomparablement plus élevés que ceux proposés par la Grande-Bretagne.
Quand en 1896, le libre-échange mondialisé s’impose, une fois les dernières résistances françaises balayées, le centre de gravité de l’économie-monde commence à osciller d’un bord à l’autre de l’Atlantique. Le jeu est ouvert : il s’agit de savoir qui va hériter de la position prédominante que Londres, décidément, ne peut conserver. La partie va se jouer pendant une nouvelle phase A longue, avec l’arrivée de nouvelles technologies accroissant les forces productives (nouveaux aciers, chimie de transformation, construction mécanique) et créant de nouveaux marchés (automobiles, aviation, cinéma).
Les règles du jeu sont simples : celui qui saura offrir au capital les meilleurs rendements deviendra la nouvelle puissance dominante, et puisque les rendements dépendent essentiellement des avancées technologiques, le gagnant sera celui qui saura, par la mise en exploitation de ses ressources, concrétiser au mieux lesdites avancées. A ce petit jeu, deux postulants sérieux menacent Londres : la Nouvelle-Angleterre et la Ruhr. Un outsider pointe en troisième position : l’immense Russie, qui vient de s’engager, à pas mesurés, dans l’aventure industrielle, et que finance la France, rentière sous-productive mais réserve de capital.
Au-delà des palinodies diplomatiques, c’est fondamentalement ce grand jeu du capitalisme mondialisé qui explique les deux guerres mondiales. A partir de 1900, la classe dirigeante anglaise a compris que la messe était dite : elle ne dominera pas le XX° siècle comme elle avait dominé le XIX°. Il lui faut désormais s’allier à son ancienne colonie, au potentiel sans commune mesure avec le sien. Ce sera le prix à payer pour préserver les intérêts financiers de la City. Le début du XX° siècle voit s’organiser progressivement un condominium américano-britannique, Boston et Londres unifiant Pittsburgh et Manchester autour des grandes banques d’affaires cosmopolites. En 1913, la fondation de la FED traduira cette imbrication des intérêts financiers américains et anglais, sur le plan organisationnel.
Le problème, c’est que dans le même temps, la Russie se développe à toute vitesse – et vu son gigantesque potentiel, si ce développement est mené à termes, le XX° siècle risque de parler Russe. Autre souci pour la finance anglo-saxonne, et souci encore plus immédiat : l’industrie allemande, appuyée sur un modèle original et très performant, taille des croupières à la Grande-Bretagne, partout dans le monde et particulièrement en Europe.
La suite est connue : c’est la Première Guerre Mondiale, probablement suscitée en sous-main par la City londonienne pour briser l’Allemagne et déstabiliser la Russie. Dix millions d’européens sont morts pour que le XX° siècle parle Anglais.
L’économie qui s’est mise en place, à l’issue de la Première Guerre Mondiale, est centrée sur Boston, avec Londres en pôle désormais secondaire. Les Etats-Unis sont maintenant les créanciers de l’Angleterre, eux qui ont dû, pendant cinquante ans, financer leur croissance en s’ouvrant aux investissements britanniques. Le basculement de l’économie-monde a eu lieu, à l’issue d’une phase A longue particulièrement tumultueuse.
Cette économie entre progressivement en phase B – et les prodromes du retournement structurel se sont d’ailleurs fait sentir dès avant la Première Guerre Mondiale, avec une phase B courte particulièrement violente, déclenchée par la crise de 1913. C’est pourquoi, pendant les années 20, l’Amérique entre en crise interne – l’ancienne économie du charbon tousse, la transition vers la nouvelle économie du pétrole n’est pas achevée. C’est une phase B longue paradoxale, dans la mesure où les progrès technologiques enclenchés à la fin du XX° siècle coexistent avec des formes économiques antérieures. Il y a en quelque sorte interpénétration entre phase A longue, dans certains secteurs en train d’émerger (automobile) et phase B longue dans d’autres secteurs pas encore passés au second plan (charbon, métallurgie). De cette imbrication résultera une période étrange, qui n’est pas sans rappeler nos années 2000 : une fausse phase A longue, plaquée sur une vraie phase B longue. Et alors comme aujourd’hui, l’Amérique utilise le levier de l’endettement, pendant la dernière phase A courte de sa phase B longue, pour générer une prospérité artificielle.
Arrive 1929, la première grande crise affrontée par le nouveau centre étatsunien. Ici, les spécificités de la culture américaine jouent un rôle non négligeable : goût du risque, esprit d’entreprise poussé jusqu’à l’excès, confiance en soi délirante, utilisation de l’endettement comme moyen de se condamner au succès. La crise américaine reflètera cet esprit collectif, sensiblement différent de celui des Anglais – et donc la crise américaine sera différente des crises anglaises du XIX° siècle. Beaucoup plus soudaine parce que longtemps masquée par le recours à la dette, en particulier pendant la dernière phase A courte de la phase B longue, beaucoup plus violente à l’image d’un capitalisme fluide n’opposant aucun obstacle à la dérive inégalitaire, elle sera aussi beaucoup plus courte – tout simplement parce que le formidable potentiel américain, et aussi sans doute le ressort prodigieux de la nation américaine d’alors, rendront possible un rétablissement inattendu.
Au début des années 30, l’Amérique vacille. Confrontée à l’implosion d’un modèle économique spectaculaire mais fragile, elle rapatrie d’énormes masses de capitaux, exportant par contrecoup sa crise partout dans le monde, et plus particulièrement en Allemagne. Le nazisme est la conséquence directe de cette crise, et la Seconde Guerre Mondiale, déclenchée apparemment par l’Allemagne, l’est en réalité par le heurt de l’impérialisme allemand renaissant avec le condominium anglo-américain. Elle résoudra la question au prix de cinquante millions de morts.
L’Amérique a vacillé, mais au prix d’une victoire militaire totale, elle s’est imposée : le transfert du centre de gravité de l’économie-monde est achevé. Après avoir oscillé pendant cinquante ans entre Boston et Londres, il s’est fixé à New York.
Commence alors un nouveau cycle long, un cycle atypique : de 1945 à 1973, une très longue phase A longue, avec des taux de croissance élevés. Puis, de 1973 à 2007, une phase B longue dissimulée (on a vu comment). Ce cycle long atypique a vu se produire un basculement de l’économie-monde vers un nouveau modèle de développement : la virtualisation du capitalisme. A partir des années 70, Los-Angeles commence à concurrencer New York comme centre de gravité. Et à l’occasion de ce basculement, précisément, la phase B longue a été masquée.
Comment interpréter historiquement ce phénomène ?
A mon avis, l’Amérique, à sa manière spectaculaire, a tout simplement répété les mécanismes expérimentés par la Grande-Bretagne pendant la phase B longue 1873-1896. Exactement comme la Grande-Bretagne de la fin du XIX° siècle continuait à dominer le commerce mondial alors que la réalité de la production glissait vers la Nouvelle-Angleterre, l’Amérique de la fin du XX° siècle a dominé optiquement l’économie mondiale, alors que la réalité de la production commençait tout doucement à glisser vers l’Asie. La différence, c’est que l’Amérique, le pays qui se pense comme un spectacle, a dissimulé cette implosion en fabriquant une économie-simulacre, financée par la dette et dissimulée sous la multiplication des activités de service sans valeur ajoutée réelle.
Si cette analyse est juste, nous sommes donc quelque part après 1896, au moment où le nouveau centre de gravité, jadis l’Amérique, aujourd’hui l’Asie, s’apprête à prendre son envol. Au moment aussi où l’ancien centre de gravité, jadis la Grande-Bretagne, aujourd’hui l’Amérique, doit choisir entre collaborer avec la puissance montante, ou faire directement la guerre pour changer le cours du destin.
Mais il y a une grande différence avec la situation qui existait à la fin du XX° siècle en Angleterre. La différence, c’est qu’en Amérique la phase B longue a été dissimulée. En d’autres termes, l’Amérique, et avec elle tout l’Occident, risque maintenant de constater la réalité d’une phase B longue de manière brutale et soudaine – comme si, après 30 ans d’illusion, les faits se vengeaient d’un seul coup.
Cela change beaucoup de choses. Cela veut dire que les règles observées jusqu’ici, telles qu’elles avaient été posées par Schumpeter et Kondratiev, ne sont peut-être plus valables. Peut-être allons-nous assister à une rupture de contexte d’une brutalité inouïe.
Il s’agit de mesurer exactement le chemin parcouru dans le transfert du centre de gravité de l’économie-monde. Si ce chemin est accompli, alors la rupture de contexte peut survenir d’un seul coup.
Voyons cela de plus près.
La réalité de la production
Où en sommes-nous aujourd’hui, de la dynamique de transfert du centre de gravité de l’économie-monde ?
Quelques chiffres.
Le PIB des USA représente actuellement, aux taux de change courants, 24 % du PIB mondial. Le PIB de l’Union Européenne représente, toujours aux taux de change courants, 30 % du PIB mondial. Optiquement, l’Occident pèse encore 54 % de l’économie-monde.
Cependant, ces données optiques sont trompeuses. A parité de pouvoir d’achat, les USA pèsent 20 % du PIB mondial, l’UE 22 %. Ce n’est déjà plus tout à fait la même chose.
Si l’on s’intéresse maintenant à la production (secteurs primaire et secondaire), c’est encore plus net. La production américaine représente 4,1 % du produit brut mondial, la production européenne 6,9 %. Au total : la production primaire et secondaire de l’Occident pèse 11 % de l’économie mondiale.
Passons à l’Asie.
Aux taux de change courants, l’ensemble Chine-Japon-Corée pèse 16 % du PIB mondial. Bien moins que l’Occident, qui pèse 54 %, n’est-ce pas ?
Ouais, sauf que…
Le PIB de la Chine pèse 12,5 % de l’économie mondiale à parité de pouvoir d’achat (6 % aux taux de change courant – ce n’est plus de l’économie, c’est du surréalisme !). La production primaire et secondaire de la Chine pèse quant à elle 7,9 % de l’économie mondiale. Le PIB du Japon pèse 7 % de l’économie mondiale à parité de pouvoir d’achat. La production primaire et secondaire du Japon pèse 2,2 % du PIB mondial. La Corée, quant à elle, compte pour 1,8 % du PIB mondial et 0,8 % de la production.
Conclusion : la production de l’ensemble Chine-Japon-Corée pèse… 11 % de l’économie mondiale. Exactement comme l’Occident.
Sur le plan de la réalité de la production, l’ensemble Chine-Japon-Corée a rattrapé l’ensemble Europe-USA. L’Occident, qui représente trois fois l’économie asiatique sur le plan financier, est en réalité en train de se faire doubler par l’Asie sur le plan des capacités productives. Le basculement latent du centre de gravité de l’économie-monde est avéré.
Vous me direz : voyons, de quoi est faite cette production ? Après tout, ce n’est pas la même chose de fabriquer des fusées spatiales et des jouets en plastique…
D’autres chiffres, donc.
En 2007, l’ensemble Chine-Japon-Corée pesait environ 35 % de l’acier produit dans le monde, l’ensemble USA-UE 28 %. La même année, la triade asiatique produisait 33 % des automobiles fabriquées dans le monde, l’ensemble USA-UE 33 % également. La même année, la triade asiatique livrait 60 % des constructions navales dans le monde, contre 25 % à l’ensemble USA-UE (les Etats-Unis, patrie des liberty ships, ont été purement et simplement rayés de la carte). Les seuls grands domaines industriels où l’Occident prédomine encore sont la construction aéronautique et le nucléaire, mais vu les transferts de technologie récemment négociés par les Chinois contre l’achat de nos Airbus, vu aussi les capacités latentes du Japon en la matière, ce n’est que partie remise…
On dirait bien que les asiatiques savent fabriquer autre chose que des jouets pour enfant, n’est-ce pas ?
Vous me direz : oui, bon, mais enfin, les services, c’est aussi de la recherche. Des capacités créatives. Un niveau technologique en progrès. Tout ramener à la production primaire et secondaire, c’est réducteur.
D’autres données, donc. Certes, en la matière, nous manquons d’éléments de synthèse. Mais les indices, eux, ne manquent pas…
Le Times higher publie chaque année un classement des universités dans le monde. Les 10 premières places sont traditionnellement réservées aux anglo-saxonnes – on n’est jamais mieux servi que par soi-même. Mais remarquons ceci : l’université de Pékin est à la 14 ° place, la meilleure université française, à la 18° place.
Les dépenses de recherche en Chine croissent de 10 % par an. Dans le même temps, les budgets de recherche stagnent ou régressent en Occident.
Il y a environ vingt millions d’étudiants en Chine. Dix fois plus qu’en France, largement deux fois plus qu’aux Etats-Unis.
Vous croyez que ces étudiants n’étudient que le Petit Livre Rouge ? – Les priorités de la recherche chinoise portent, selon le plan quinquennal 2005-2010, sur les biotechnologies et l’industrie spatiale. Ce plan quinquennal précise en outre que l’intégration doit être poussée au plus haut niveau entre l’industrie et les universités, dans le cadre d’une véritable militarisation des filières productives.
Pratiquement, la Chine de 2008 ressemble, pour ce qui concerne la recherche, au Japon des années 60 : un ancien producteur de babioles qui, par la discipline et l’effort, rattrape son retard à toute vitesse – en attendant de tailler des croupières à l’Occident, comme les ingénieurs japonais le font depuis maintenant deux décennies, en robotique en particulier.
Je vous laisse imaginer ce que peut représenter dans l’économie-monde une Chine grande comme dix Japons…
Dans la réalité de la production, tant en matière de capacité que de perspectives de développement, l’Asie est aujourd’hui exactement dans la situation de l’Amérique du Nord de la fin du XIX° siècle, et l’Amérique est dans la situation de l’Angleterre de la même époque. Tôt ou tard, les Américains vont se rendre compte que si les services ajoutent de la valeur aux produits, en dernière analyse, celui qui maîtrise la production physique contrôle de facto le support du service.
Voilà où nous en sommes.
Vers une grande dépression occidentale
Vous comprenez maintenant, ami lecteur, pourquoi je maintiens que nous allons vers une très grande crise.
La configuration que nous venons de balayer n’est pas celle d’une crise conjoncturelle. Nous ne sommes pas seulement à la fin du phase B courte. Nous sommes à la fin d’une phase B longue dissimulée, et nous allons probablement découvrir d’un seul coup l’ampleur de cette phase B longue, lorsque les masques tomberont. C’est la configuration qui a donné naissance aux heurts majeurs du premier XX° siècle, avec l’Occident dans le rôle de l’Angleterre et l’Asie de l’Est dans le rôle de l’Amérique d’alors.
Ce n’est pas un hasard si l’Amérique des années 2000 a répété la bulle des années 20. Fondamentalement, ce sont les mêmes mécanismes qui se sont reproduits : prolongation artificielle d’une phase B courte au sein d’une phase B longue. La différence, c’est que cette fois, l’Amérique n’est pas du tout certaine de conserver le centre de gravité de l’économie-monde sur son sol. Les fondamentaux qui, dans les années 30, restaient favorables à l’île-continent américaine, lui sont cette fois hostiles.
Croyez-vous vraiment que dans cette configuration-là, nous puissions nous en sortir autrement que par une grande crise – c’est-à-dire une période de troubles faisant transition entre deux organisations de l’économie-monde ? – Je ne le crois pas. Ce qui nous attend, ce n’est pas une crise conjoncturelle du type de celles que nous avons traversées en 1987, 1993, 2001. Cette fois, il n’y aura pas de « miracle », pas d’Union Soviétique en voie d’implosion, pas de Chine qui s’ouvre et esclavagise sa population pour opérer l’accumulation primitive du Capital. Pas de mirage de la nouvelle économie, non plus. Et il n’est plus possible de relancer la machine à dettes : pratiquement, on est arrivé au maximum envisageable. Non, ce qui nous attend, c’est une grande crise structurelle – 1929 plutôt que 1873, d’ailleurs, puisque la question du centre de gravité politique de l’économie-monde va être posée directement.
Mais sous quelle forme ? – Cela, il est un peu tôt pour le dire.
Ce sera l’objet d’un prochain article, à publier prochainement et centré sur un angle différent. Cette fois, nous regarderons ce que l’oligarchie américaine peut faire pour changer le cours de l’Histoire.
A suivre, donc…
Michel Drac
Source : http://www.scriptoblog.com
Lire la suite : Quand les élites se muent en hyperclasse
Voici ma thèse : je maintiens que nous allons vers une secousse économique majeure, probablement comparable à 1929. Et je maintiens aussi que si cette secousse est certaine, il est très difficile à ce stade d’en préciser le calendrier et les modalités. Mais j’éprouve, au vu des réactions, le besoin d’approfondir la théorie des cycles économiques, pour mieux cartographier les scénarios possibles.
Qu’est-ce qu’une crise ?
Commençons par analyser plus précisément la notion de crise.
Une crise correspond toujours au passage d’une organisation générale de l’économie-monde à une autre organisation générale. L’examen des évènements passés permet de distinguer deux niveaux dans ce processus :
 les crises mineures ou conjoncturelles, correspondant au point bas des cycles courts du capitalisme, ou cycles de Juglar,
les crises mineures ou conjoncturelles, correspondant au point bas des cycles courts du capitalisme, ou cycles de Juglar,- a) Les cycles de Juglar
Le mécanisme exposé dans l’article « Quand l’imprévisible est certain » explique les systoles et diastoles de la répartition des richesses. Il est intéressant de comprendre tout d’abord pourquoi ce mouvement n’engendre pas de crises permanentes, mais au contraire une alternance de phases de croissance et de récession.
La dérive inégalitaire du capitalisme produit une dilatation de l’économie, tant que le développement de la production réelle contrebalance la concentration croissante des richesses. Ce développement de la production réelle est induit par l’accroissement de la productivité, rendu possible par le développement technologique et la substitution du capital au travail.
Un exemple : imaginons une économie ne comportant que quatre acteurs, deux travailleurs et deux employeurs. En phase A courte du cycle de Juglar, les employeurs profitent d’une innovation technologique pour accroître les rendements. Grâce aux investissements consentis par les employeurs, et les travailleurs produisent plus en travaillant autant. Les salaires augmentent, mais moins vite que la production (il faut bien que les employeurs retirent un profit de leurs investissements). Les travailleurs utilisent l’argent supplémentaire pour consommer davantage, tandis que les employeurs accumulent les dividendes.
Arrive le moment où les employeurs ont accumulé tellement de dividendes qu’il leur faut investir à nouveau. Seulement, problème : comme les travailleurs n’ont pas suffisamment épargné (puisqu’ils ont consommé), ils ne peuvent plus acheter les produits issus de l’accroissement de la production. Donc lorsque les employeurs investissent à nouveau, ils se retrouvent avec des capacités de production inutilisées, donc des investissements non rentables.
Commence la phase B courte du cycle de Juglar. Il faut détruire du signe monétaire pour relancer la machine, et pour cela la méthode est simple : un des deux employeurs (celui qui a fait les moins bons choix d’investissement) doit faire faillite, ou se laisser racheter à bas prix par son concurrent. Dans l’opération, une partie de la valeur boursière est détruite. La quantité de signe monétaire diminue à travers la révision à la baisse des actifs, donc la valeur intrinsèque du signe est renforcée, donc les salaires sont indirectement augmentés à nouveau. Cette augmentation n’est pas toujours perceptible en données brutes, car elle ne doit pas être comprise au regard de la mesure physique de la production, mais plutôt au regard du rapport entre les besoins croissants des travailleurs et leur capacité à dégager une part de dépenses non contraintes. Cependant, augmentation il y a, mécaniquement, dès lors que les revenus du travail croissent à nouveau plus vite que ceux du capital, pénalisés par l’absence de débouchés.
Arrive donc le moment où un nouveau point d’équilibre est trouvé. Le pouvoir d’achat des travailleurs progresse de manière invisible mais réelle, et donc le marché croît à nouveau, et donc l’employeur survivant peut procéder à de nouveaux investissements, exploitant les percées technologiques plus avant. Ainsi, la machine est relancée : on repasse en phase A courte.
Bien sûr, dans la réalité, les mécanismes sont infiniment plus complexes : les employeurs doivent recourir à des emprunts auprès de banques qui ont centralisé le signe monétaire en excès, et la destruction de signe passe donc par un processus beaucoup plus sophistiqué qu’une simple contraction des actifs boursiers. Mais à ce stade, restons-en là : phase A courte, croissance de la production supérieure à la dérive inégalitaire du capitalisme ; phase B courte, croissance de production inférieure à la dérive inégalitaire, donc nécessité de détruire du signe monétaire.
L’histoire économique depuis la révolution industrielle enseigne que ce mécanisme de cycles courts, dits cycle de Juglar, obéit à un rythme général d’un peu moins d’une décennie. Depuis 30 ans, nous avons vu quatre cycles de Juglar : 1979-1987, 1987-1993, 1993-2000, 2000-2007.
Aucun des points bas de ces cycles n’a marqué de catastrophe majeure, même si en 1987, nous sommes passés très près d’un accident majeur. A chaque fois, il y a eu une purge, plus ou moins violente, mais au final tout à fait bénéfique. C’est la force du capitalisme d’intégrer dans son fonctionnement structurel les antidotes à ses dérives. C’est cette capacité à alterner phases A courtes et phases B courtes qui explique qu’en dépit de ses dysfonctionnements évidents, le marché reste en temps normal le meilleur régulateur de l’activité économique.
- b) Les cycles de Kondratiev
A la différence des cycles de Juglar, qui reviennent avec une régularité de minuterie suisse, les cycles longs, dits cycle de Kondratiev, obéissent à des mécanismes complexes, où technologie, culture, politique et économie interagissent de manière assez imprévisible.
Historiquement, l’économie capitaliste mondialisée a connu jusqu’ici quatre cycles longs complets : 1787-1815 (phase A longue) et 1815-1848 (phase B longue), 1848-1873 (phase A longue) et 1873-1896 (phase B longue), 1896-1929 (phase A prolongée artificiellement par la Première Guerre Mondiale) et 1929-1945 (phase B longue achevée prématurément par la Seconde Guerre Mondiale), 1945-1973 (phase A longue dite « des trente glorieuses ») et 1973-1987 (phase B écourtée artificiellement – nous y reviendrons).
Avant d’aller plus loin, essayons de comprendre à quels mécanismes renvoient les cycles de Kondratiev.
Les phases A longues correspondent à une période de croissance soutenue de la production. Les phases B longues correspondent au contraire à une période de croissance moins soutenue. Tout se passe comme si en phase A longues, les phases A courtes étaient exceptionnellement dynamiques et les phases B courtes exceptionnellement clémentes, alors qu’en phase B longue, c’est l’inverse : les phases A courtes sont peu dynamiques, les phases B courtes franchement désastreuses.
Schumpeter a montré que les phases A longues suivent généralement une « grappe » d’innovations technologiques majeures (le métier à tisser en 1780, qui rendit possible l’exploitation massive par l’Angleterre des ressources en cotons de l’Inde ; le chemin de fer et les progrès fulgurants de la métallurgie à partir de 1848 ; l’économie du pétrole et de l’électricité remplaçant celle du charbon, une fois surmontée la crise des années 30), alors que les phases B commencent quand l’accroissement de productivité rendu possible par ces innovations ne peut plus être prolongé significativement.
La principale critique qu’on peut adresser à la théorie des cycles de Kondratiev et à l’analyse de Schumpeter réside dans l’ignorance où ces auteurs ont largement tenu la question du crédit. Cependant, cette critique ne remet en cause ni les constats de bon sens faits par Kondratiev, ni l’analyse imparable de Schumpeter : il est clair que l’économie capitaliste a obéi historiquement à deux régimes différents, l’un rapide privilégiant les phases A courtes, l’autre lent privilégiant les phases B courtes, et il est non moins clair que l’alternance de ces phases A longues et B longues correspond assez précisément aux grandes innovations technologiques. En fait, on peut penser que si le crédit est abondant en phase A, c’est tout simplement parce que les innovations technologiques rendent l’investissement plus rentable, et donc les détenteurs du capital hésitent moins à investir, alors qu’en phase B, si le crédit est plus rare, c’est parce que la rentabilité marginale du capital diminue, et donc les investisseurs sont plus prudents.
Ces éléments de théorie, très sommaires j’en ai conscience, suffisent malgré tout à faire comprendre la nature de l’époque qui s’achève sous nos yeux : c’est la fin d’une phase A longue artificielle.
Pour comprendre l’évolution récente de l’économie capitaliste occidentale, il faut se souvenir de trois faits structurants :
1°) En 1971, les USA décident d’abolir la convertibilité-or du dollar. A partir de cette date, on sort du cadre conceptuel défini par Schumpeter. Les règles de fonctionnement normal du capitalisme sont abolies. Il devient possible de générer du crédit abondant même en l’absence d’innovations technologiques favorisant le retour sur investissement des opérateurs. Dès lors, le basculement de la phase A longue à la phase B longue peut être dissimulé. Normalement, une phase B longue est caractérisée par une faible inflation et une stagnation. Mais avec l’abolition de l’étalon-or, les USA se donnent les moyens de « fabriquer » du dollar artificiellement, et donc le passage en phase B longue peut prendre une forme différente : une forte inflation (ce que l’on verra dans les années 70) et une relative stagnation (ce qui sera, là encore, caractéristique des années 70).
2°) A la fin des années 70, la révolution informatique modifie la nature même des économies développées. Le second choc pétrolier, en 1979, aurait dû enfoncer les USA dans la stagflation. Or, ce n’est pas ce qui s’est passé : un nouveau moteur technologique prend le relais de l’économie pétrole-électricité entrée en phase B. Cependant, ce moteur ne fonctionne pas « normalement ». Il n’induit pas de croissance réelle de la production primaire et secondaire. Le développement de l’économie virtuelle (micro-ordinateurs, nouvelles technologies de l’information, explosion des activités tertiaires pures) est sans impact réel sur la production industrielle et agricole, base de l’économie.
Ainsi, depuis trente ans, l’économie occidentale fonctionne sur un schéma pervers. Certes, les usines sont de plus en plus performantes. Mais cet accroissement de performance n’est pas décisif, aucune innovation technologique majeure n’est intervenue sur le plan de la production. On aurait donc logiquement dû constater depuis longtemps une phase B longue, avec des phases A courtes médiocres, et des phases B courtes prononcées.
Or, ce n’est pas ce que l’on observe : tout se passe comme si la phase B longue entamée avec le premier choc pétrolier, en 1973, avait pris fin dès le début des années 80.
Comment expliquer ce miracle ? – Tout simplement par la structure du PIB des pays développés, et en premier lieu des USA. En 1972, le PIB des USA se monte à 4.100 milliards de dollars constants 2000. Il est composé à 35 % environ (plusieurs méthodes de redressement des prix) par les secteurs primaire et secondaire (1450 milliards de dollars 2000). En 2007, le PIB américain se monte à 11.000 milliards de dollars constants 2000, donc 2,75 fois plus. Mais les secteurs primaire et secondaire ne pèsent plus que 20 % du PIB des USA (2250 milliards de dollars). Par conséquent, sur la période qui va de 1972 à 2007, le taux de croissance moyen du PIB USA en dollars constants a été de 3 %, mais celui de la production n’a été que de 1,2 %.
Tout est dit. Une croissance à 3 % correspond à une phase A longue – c’est l’illusion dans laquelle l’Occident vit depuis une génération. A l’inverse, une croissance à 1,2 % correspond à une phase B longue – c’est la réalité de l’économie occidentale depuis 30 ans.
Conclusion : les USA se sont donné l’illusion d’une phase A prolongée en développant énormément les activités de service, activités de flux qui génèrent des revenus mais pas de production stricto sensu, alors qu’ils étaient en réalité entrés dans une phase B longue, sur le plan de la réalité de la production – et ce qui est vrai des USA l’est aussi de l’ensemble des économies développées de l’hémisphère occidental, à des degrés divers – palme d’or de l’économie désindustrialisée : la Grande-Bretagne ; médaille du mérite industriel : l’Allemagne.
3°) A partir de 1987, l’Union Soviétique implose et la Chine s’ouvre. C’est l’origine de la forte croissance américaine des années Clinton/Bush, forte croissance tirée pour l’essentiel par la consommation.
Comment la consommation peut-elle fabriquer de la croissance ? – Réponse : en fabriquant de la fausse croissance.
Les USA partent, dans les années 70, avec une position extérieure nette largement bénéficiaire. Progressivement, cette position extérieure se dégrade, jusqu’à devenir extrêmement négative (environ 7.000 milliards de dollars, actuellement). Depuis le tournant du siècle, le montant des investissements américains à l’étranger est plus faible que le montant des investissements étrangers aux USA, et la situation ne cesse de se dégrader. Pour l’instant, la balance des flux de capitaux n’en souffre pas trop, parce que les investissements américains à l’étranger sont principalement des actions, à rendement élevé, alors que les investissements étrangers aux USA sont essentiellement constitués de bons du trésor, à faible rendement. Mais cette situation est absolument malsaine : elle est caractéristique d’un « cœur » du capitalisme en voie d’implosion.
Tout se passe comme si les Américains avaient progressivement vidé leur stock d’actifs pour maintenir l’illusion d’une phase A longue alors que la réalité de la production les plaçait dans une phase B longue. C’est l’augmentation de la production chinoise, et à un degré moindre la conquête des ressources dans l’ancien bloc soviétique, qui expliquent le maintien d’une croissance américaine tirée par la consommation. Les Américains s’endettent à titre personnel, l’Amérique dans son ensemble bascule d’une situation de créancier à une situation de débiteur, et les citoyens des Etats-Unis, payés à faire tourner une machine économique artificiellement tertiarisée, consomment de plus en plus, sans produire en conséquence. Résultat : optiquement, le PIB US ne cesse de grimper, parce qu’il y a de plus en plus d’activités de service. Mais en réalité, la base de l’économie US ne progresse plus que très lentement, bien plus lentement que celle de ses concurrents stratégiques – la Chine en premier lieu.
Nous approchons du moment où ce modèle absurde ne pourra plus être pérennisé. Voilà pourquoi je maintiens mon analyse : nous allons au-devant d’une crise majeure – une phase B de Kondratiev, avec basculement du centre de gravité politique de l’économie-monde.
- c) Le basculement du centre de gravité
Reprenons l’histoire des cycles économiques longs, pour bien comprendre.
De 1787 environ à 1848 environ, l’Angleterre a connu un formidable bond en avant productif. Le moteur principal était alors le textile. Ayant conquis l’Inde, la Grande-Bretagne imposa à sa colonie principale des tarifs artificiellement bas sur le coton. Cette matière première bon marché permettait de rentabiliser au maximum les nouveaux métiers à tisser, qui décuplaient la force productive des ouvriers britanniques. Les revenus colossaux engendrés par cette industrie permirent à la Grande-Bretagne de triompher de son ennemi héréditaire, la France, malgré le blocus continental ordonné par Napoléon pour maintenir la prééminence française en Europe et affamer financièrement les Anglais. On peut même dire, sans grand risque de se tromper, que les guerres napoléoniennes aidèrent les Anglais, dans la mesure où leur coût énorme détruisit du capital, permettant de contrebalancer la dérive inégalitaire du capitalisme, justifiant la mobilisation économique de la Grande-Bretagne.
A partir de la fin des années 1810, cependant, la première révolution industrielle est achevée. Il n’y a plus d’évolution majeure dans les processus productifs de l’industrie textile. Et ce que Napoléon n’avait pu faire, la réalité de l’infrastructure technologique va le réaliser : l’Angleterre économique déraille. Pendant près de trois décennies, les taux de croissance sont bas, le capital anglais, surabondant, ne trouve pas à s’investir de manière rentable.
Puis arrivent les chemins de fer, à partir des années 1840, et la métallurgie, à partir des années 1850. De nouveaux champs de progrès productif s’ouvrent au capital. Le centre de gravité de l’économie anglaise bascule à l’intérieur de l’Angleterre – vers le nord, vers les mines et les aciéries, vers Manchester.
Comme la mutation se déroule à l’intérieur de la puissance dominante, c’est une mutation sans guerre majeure. L’Angleterre assoit paisiblement sa domination sur le monde, et quand elle fait la guerre, ce n’est pas pour freiner le développement de ses rivaux, mais pour s’ouvrir de nouveaux marchés – la guerre de l’opium, en Chine, par exemple. Les années 1850-1870 voient l’Angleterre triomphante ouvrir à l’Europe la voie du développement industriel à grande échelle, jusqu’à concentrer, à la City de Londres, la moitié des revenus de la planète. Bientôt, la France et l’Allemagne imitent Albion, et le capital dégage, partout, des taux de rendement fabuleux.
A partir des années 1870, le moteur se grippe. Les capacités de production commencent à devenir excédentaires. En 1873, une bulle spéculative implose – en Autriche, d’abord. Cette implosion marque l’ouverture d’une phase B longue. Le capital ne trouve plus à s’investir de manière rentable en Europe. Les phases B courtes sont particulièrement prononcées sur le vieux continent, et à partir de 1890, une stagnation tenace touche la zone anglaise – Grande-Bretagne et Europe du Nord hors Allemagne. Il n’y a pas à proprement parler de récession, plutôt une longue période de marasme.
Pendant ce temps, cependant, un nouveau « cœur » du capitalisme est en train de germer : les Etats-Unis. Si les années 1870 voient l’Europe entrer dans une longue phase B, elles sont aussi, pour l’Amérique, le temps du « boom » économique post-guerre de sécession. Progressivement, les capacités productives de Boston rattrapent celles de Manchester, les aciéries de Pittsburgh copient puis supplantent celles de Birmingham. Certes, à la fin du XX° siècle, l’Angleterre contrôle encore plus du quart de l’économie planétaire. Mais déjà, ce contrôle financier ne traduit plus la réalité de la production. Irrésistiblement, le capital est attiré vers l’Amérique du Nord, qui offre des rendements incomparablement plus élevés que ceux proposés par la Grande-Bretagne.
Quand en 1896, le libre-échange mondialisé s’impose, une fois les dernières résistances françaises balayées, le centre de gravité de l’économie-monde commence à osciller d’un bord à l’autre de l’Atlantique. Le jeu est ouvert : il s’agit de savoir qui va hériter de la position prédominante que Londres, décidément, ne peut conserver. La partie va se jouer pendant une nouvelle phase A longue, avec l’arrivée de nouvelles technologies accroissant les forces productives (nouveaux aciers, chimie de transformation, construction mécanique) et créant de nouveaux marchés (automobiles, aviation, cinéma).
Les règles du jeu sont simples : celui qui saura offrir au capital les meilleurs rendements deviendra la nouvelle puissance dominante, et puisque les rendements dépendent essentiellement des avancées technologiques, le gagnant sera celui qui saura, par la mise en exploitation de ses ressources, concrétiser au mieux lesdites avancées. A ce petit jeu, deux postulants sérieux menacent Londres : la Nouvelle-Angleterre et la Ruhr. Un outsider pointe en troisième position : l’immense Russie, qui vient de s’engager, à pas mesurés, dans l’aventure industrielle, et que finance la France, rentière sous-productive mais réserve de capital.
Au-delà des palinodies diplomatiques, c’est fondamentalement ce grand jeu du capitalisme mondialisé qui explique les deux guerres mondiales. A partir de 1900, la classe dirigeante anglaise a compris que la messe était dite : elle ne dominera pas le XX° siècle comme elle avait dominé le XIX°. Il lui faut désormais s’allier à son ancienne colonie, au potentiel sans commune mesure avec le sien. Ce sera le prix à payer pour préserver les intérêts financiers de la City. Le début du XX° siècle voit s’organiser progressivement un condominium américano-britannique, Boston et Londres unifiant Pittsburgh et Manchester autour des grandes banques d’affaires cosmopolites. En 1913, la fondation de la FED traduira cette imbrication des intérêts financiers américains et anglais, sur le plan organisationnel.
Le problème, c’est que dans le même temps, la Russie se développe à toute vitesse – et vu son gigantesque potentiel, si ce développement est mené à termes, le XX° siècle risque de parler Russe. Autre souci pour la finance anglo-saxonne, et souci encore plus immédiat : l’industrie allemande, appuyée sur un modèle original et très performant, taille des croupières à la Grande-Bretagne, partout dans le monde et particulièrement en Europe.
La suite est connue : c’est la Première Guerre Mondiale, probablement suscitée en sous-main par la City londonienne pour briser l’Allemagne et déstabiliser la Russie. Dix millions d’européens sont morts pour que le XX° siècle parle Anglais.
L’économie qui s’est mise en place, à l’issue de la Première Guerre Mondiale, est centrée sur Boston, avec Londres en pôle désormais secondaire. Les Etats-Unis sont maintenant les créanciers de l’Angleterre, eux qui ont dû, pendant cinquante ans, financer leur croissance en s’ouvrant aux investissements britanniques. Le basculement de l’économie-monde a eu lieu, à l’issue d’une phase A longue particulièrement tumultueuse.
Cette économie entre progressivement en phase B – et les prodromes du retournement structurel se sont d’ailleurs fait sentir dès avant la Première Guerre Mondiale, avec une phase B courte particulièrement violente, déclenchée par la crise de 1913. C’est pourquoi, pendant les années 20, l’Amérique entre en crise interne – l’ancienne économie du charbon tousse, la transition vers la nouvelle économie du pétrole n’est pas achevée. C’est une phase B longue paradoxale, dans la mesure où les progrès technologiques enclenchés à la fin du XX° siècle coexistent avec des formes économiques antérieures. Il y a en quelque sorte interpénétration entre phase A longue, dans certains secteurs en train d’émerger (automobile) et phase B longue dans d’autres secteurs pas encore passés au second plan (charbon, métallurgie). De cette imbrication résultera une période étrange, qui n’est pas sans rappeler nos années 2000 : une fausse phase A longue, plaquée sur une vraie phase B longue. Et alors comme aujourd’hui, l’Amérique utilise le levier de l’endettement, pendant la dernière phase A courte de sa phase B longue, pour générer une prospérité artificielle.
Arrive 1929, la première grande crise affrontée par le nouveau centre étatsunien. Ici, les spécificités de la culture américaine jouent un rôle non négligeable : goût du risque, esprit d’entreprise poussé jusqu’à l’excès, confiance en soi délirante, utilisation de l’endettement comme moyen de se condamner au succès. La crise américaine reflètera cet esprit collectif, sensiblement différent de celui des Anglais – et donc la crise américaine sera différente des crises anglaises du XIX° siècle. Beaucoup plus soudaine parce que longtemps masquée par le recours à la dette, en particulier pendant la dernière phase A courte de la phase B longue, beaucoup plus violente à l’image d’un capitalisme fluide n’opposant aucun obstacle à la dérive inégalitaire, elle sera aussi beaucoup plus courte – tout simplement parce que le formidable potentiel américain, et aussi sans doute le ressort prodigieux de la nation américaine d’alors, rendront possible un rétablissement inattendu.
Au début des années 30, l’Amérique vacille. Confrontée à l’implosion d’un modèle économique spectaculaire mais fragile, elle rapatrie d’énormes masses de capitaux, exportant par contrecoup sa crise partout dans le monde, et plus particulièrement en Allemagne. Le nazisme est la conséquence directe de cette crise, et la Seconde Guerre Mondiale, déclenchée apparemment par l’Allemagne, l’est en réalité par le heurt de l’impérialisme allemand renaissant avec le condominium anglo-américain. Elle résoudra la question au prix de cinquante millions de morts.
L’Amérique a vacillé, mais au prix d’une victoire militaire totale, elle s’est imposée : le transfert du centre de gravité de l’économie-monde est achevé. Après avoir oscillé pendant cinquante ans entre Boston et Londres, il s’est fixé à New York.
Commence alors un nouveau cycle long, un cycle atypique : de 1945 à 1973, une très longue phase A longue, avec des taux de croissance élevés. Puis, de 1973 à 2007, une phase B longue dissimulée (on a vu comment). Ce cycle long atypique a vu se produire un basculement de l’économie-monde vers un nouveau modèle de développement : la virtualisation du capitalisme. A partir des années 70, Los-Angeles commence à concurrencer New York comme centre de gravité. Et à l’occasion de ce basculement, précisément, la phase B longue a été masquée.
Comment interpréter historiquement ce phénomène ?
A mon avis, l’Amérique, à sa manière spectaculaire, a tout simplement répété les mécanismes expérimentés par la Grande-Bretagne pendant la phase B longue 1873-1896. Exactement comme la Grande-Bretagne de la fin du XIX° siècle continuait à dominer le commerce mondial alors que la réalité de la production glissait vers la Nouvelle-Angleterre, l’Amérique de la fin du XX° siècle a dominé optiquement l’économie mondiale, alors que la réalité de la production commençait tout doucement à glisser vers l’Asie. La différence, c’est que l’Amérique, le pays qui se pense comme un spectacle, a dissimulé cette implosion en fabriquant une économie-simulacre, financée par la dette et dissimulée sous la multiplication des activités de service sans valeur ajoutée réelle.
Si cette analyse est juste, nous sommes donc quelque part après 1896, au moment où le nouveau centre de gravité, jadis l’Amérique, aujourd’hui l’Asie, s’apprête à prendre son envol. Au moment aussi où l’ancien centre de gravité, jadis la Grande-Bretagne, aujourd’hui l’Amérique, doit choisir entre collaborer avec la puissance montante, ou faire directement la guerre pour changer le cours du destin.
Mais il y a une grande différence avec la situation qui existait à la fin du XX° siècle en Angleterre. La différence, c’est qu’en Amérique la phase B longue a été dissimulée. En d’autres termes, l’Amérique, et avec elle tout l’Occident, risque maintenant de constater la réalité d’une phase B longue de manière brutale et soudaine – comme si, après 30 ans d’illusion, les faits se vengeaient d’un seul coup.
Cela change beaucoup de choses. Cela veut dire que les règles observées jusqu’ici, telles qu’elles avaient été posées par Schumpeter et Kondratiev, ne sont peut-être plus valables. Peut-être allons-nous assister à une rupture de contexte d’une brutalité inouïe.
Il s’agit de mesurer exactement le chemin parcouru dans le transfert du centre de gravité de l’économie-monde. Si ce chemin est accompli, alors la rupture de contexte peut survenir d’un seul coup.
Voyons cela de plus près.
La réalité de la production
Où en sommes-nous aujourd’hui, de la dynamique de transfert du centre de gravité de l’économie-monde ?
Quelques chiffres.
Le PIB des USA représente actuellement, aux taux de change courants, 24 % du PIB mondial. Le PIB de l’Union Européenne représente, toujours aux taux de change courants, 30 % du PIB mondial. Optiquement, l’Occident pèse encore 54 % de l’économie-monde.
Cependant, ces données optiques sont trompeuses. A parité de pouvoir d’achat, les USA pèsent 20 % du PIB mondial, l’UE 22 %. Ce n’est déjà plus tout à fait la même chose.
Si l’on s’intéresse maintenant à la production (secteurs primaire et secondaire), c’est encore plus net. La production américaine représente 4,1 % du produit brut mondial, la production européenne 6,9 %. Au total : la production primaire et secondaire de l’Occident pèse 11 % de l’économie mondiale.
Passons à l’Asie.
Aux taux de change courants, l’ensemble Chine-Japon-Corée pèse 16 % du PIB mondial. Bien moins que l’Occident, qui pèse 54 %, n’est-ce pas ?
Ouais, sauf que…
Le PIB de la Chine pèse 12,5 % de l’économie mondiale à parité de pouvoir d’achat (6 % aux taux de change courant – ce n’est plus de l’économie, c’est du surréalisme !). La production primaire et secondaire de la Chine pèse quant à elle 7,9 % de l’économie mondiale. Le PIB du Japon pèse 7 % de l’économie mondiale à parité de pouvoir d’achat. La production primaire et secondaire du Japon pèse 2,2 % du PIB mondial. La Corée, quant à elle, compte pour 1,8 % du PIB mondial et 0,8 % de la production.
Conclusion : la production de l’ensemble Chine-Japon-Corée pèse… 11 % de l’économie mondiale. Exactement comme l’Occident.
Sur le plan de la réalité de la production, l’ensemble Chine-Japon-Corée a rattrapé l’ensemble Europe-USA. L’Occident, qui représente trois fois l’économie asiatique sur le plan financier, est en réalité en train de se faire doubler par l’Asie sur le plan des capacités productives. Le basculement latent du centre de gravité de l’économie-monde est avéré.
Vous me direz : voyons, de quoi est faite cette production ? Après tout, ce n’est pas la même chose de fabriquer des fusées spatiales et des jouets en plastique…
D’autres chiffres, donc.
En 2007, l’ensemble Chine-Japon-Corée pesait environ 35 % de l’acier produit dans le monde, l’ensemble USA-UE 28 %. La même année, la triade asiatique produisait 33 % des automobiles fabriquées dans le monde, l’ensemble USA-UE 33 % également. La même année, la triade asiatique livrait 60 % des constructions navales dans le monde, contre 25 % à l’ensemble USA-UE (les Etats-Unis, patrie des liberty ships, ont été purement et simplement rayés de la carte). Les seuls grands domaines industriels où l’Occident prédomine encore sont la construction aéronautique et le nucléaire, mais vu les transferts de technologie récemment négociés par les Chinois contre l’achat de nos Airbus, vu aussi les capacités latentes du Japon en la matière, ce n’est que partie remise…
On dirait bien que les asiatiques savent fabriquer autre chose que des jouets pour enfant, n’est-ce pas ?
Vous me direz : oui, bon, mais enfin, les services, c’est aussi de la recherche. Des capacités créatives. Un niveau technologique en progrès. Tout ramener à la production primaire et secondaire, c’est réducteur.
D’autres données, donc. Certes, en la matière, nous manquons d’éléments de synthèse. Mais les indices, eux, ne manquent pas…
Le Times higher publie chaque année un classement des universités dans le monde. Les 10 premières places sont traditionnellement réservées aux anglo-saxonnes – on n’est jamais mieux servi que par soi-même. Mais remarquons ceci : l’université de Pékin est à la 14 ° place, la meilleure université française, à la 18° place.
Les dépenses de recherche en Chine croissent de 10 % par an. Dans le même temps, les budgets de recherche stagnent ou régressent en Occident.
Il y a environ vingt millions d’étudiants en Chine. Dix fois plus qu’en France, largement deux fois plus qu’aux Etats-Unis.
Vous croyez que ces étudiants n’étudient que le Petit Livre Rouge ? – Les priorités de la recherche chinoise portent, selon le plan quinquennal 2005-2010, sur les biotechnologies et l’industrie spatiale. Ce plan quinquennal précise en outre que l’intégration doit être poussée au plus haut niveau entre l’industrie et les universités, dans le cadre d’une véritable militarisation des filières productives.
Pratiquement, la Chine de 2008 ressemble, pour ce qui concerne la recherche, au Japon des années 60 : un ancien producteur de babioles qui, par la discipline et l’effort, rattrape son retard à toute vitesse – en attendant de tailler des croupières à l’Occident, comme les ingénieurs japonais le font depuis maintenant deux décennies, en robotique en particulier.
Je vous laisse imaginer ce que peut représenter dans l’économie-monde une Chine grande comme dix Japons…
Dans la réalité de la production, tant en matière de capacité que de perspectives de développement, l’Asie est aujourd’hui exactement dans la situation de l’Amérique du Nord de la fin du XIX° siècle, et l’Amérique est dans la situation de l’Angleterre de la même époque. Tôt ou tard, les Américains vont se rendre compte que si les services ajoutent de la valeur aux produits, en dernière analyse, celui qui maîtrise la production physique contrôle de facto le support du service.
Voilà où nous en sommes.
Vers une grande dépression occidentale
Vous comprenez maintenant, ami lecteur, pourquoi je maintiens que nous allons vers une très grande crise.
La configuration que nous venons de balayer n’est pas celle d’une crise conjoncturelle. Nous ne sommes pas seulement à la fin du phase B courte. Nous sommes à la fin d’une phase B longue dissimulée, et nous allons probablement découvrir d’un seul coup l’ampleur de cette phase B longue, lorsque les masques tomberont. C’est la configuration qui a donné naissance aux heurts majeurs du premier XX° siècle, avec l’Occident dans le rôle de l’Angleterre et l’Asie de l’Est dans le rôle de l’Amérique d’alors.
Ce n’est pas un hasard si l’Amérique des années 2000 a répété la bulle des années 20. Fondamentalement, ce sont les mêmes mécanismes qui se sont reproduits : prolongation artificielle d’une phase B courte au sein d’une phase B longue. La différence, c’est que cette fois, l’Amérique n’est pas du tout certaine de conserver le centre de gravité de l’économie-monde sur son sol. Les fondamentaux qui, dans les années 30, restaient favorables à l’île-continent américaine, lui sont cette fois hostiles.
Croyez-vous vraiment que dans cette configuration-là, nous puissions nous en sortir autrement que par une grande crise – c’est-à-dire une période de troubles faisant transition entre deux organisations de l’économie-monde ? – Je ne le crois pas. Ce qui nous attend, ce n’est pas une crise conjoncturelle du type de celles que nous avons traversées en 1987, 1993, 2001. Cette fois, il n’y aura pas de « miracle », pas d’Union Soviétique en voie d’implosion, pas de Chine qui s’ouvre et esclavagise sa population pour opérer l’accumulation primitive du Capital. Pas de mirage de la nouvelle économie, non plus. Et il n’est plus possible de relancer la machine à dettes : pratiquement, on est arrivé au maximum envisageable. Non, ce qui nous attend, c’est une grande crise structurelle – 1929 plutôt que 1873, d’ailleurs, puisque la question du centre de gravité politique de l’économie-monde va être posée directement.
Mais sous quelle forme ? – Cela, il est un peu tôt pour le dire.
Ce sera l’objet d’un prochain article, à publier prochainement et centré sur un angle différent. Cette fois, nous regarderons ce que l’oligarchie américaine peut faire pour changer le cours de l’Histoire.
A suivre, donc…
Michel Drac
Source : http://www.scriptoblog.com
Lire la suite : Quand les élites se muent en hyperclasse












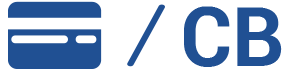
 et
et  !
!
